Un des traits les plus caractéristiques de la Belgique actuelle est assurément d'être un pays de villes.
Il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a dix siècles notre pays ne comptait guère que trois centres urbains, d'origine, romaine et d'importance fort médiocre: Tournai, Tongres et Arlon. Le territoire défriché était occupé par de grands domaines - villae - dont la plupart avaient une contenance de plusieurs centaines d'hectares et qui étaient, avant tout, des centres d'exploitation agricole. Ils appartenaient à de riches propriétaires fonciers et étaient peuplés de paysans, dont l'immense majorité était de condition servile. Ces domaines produisaient à peu près tout ce qui était nécessaire à l'entretien de leurs habitants. Ceux-ci ne devaient donc pas se soucier d'assurer leur ravitaillement par l'achat de produits étrangers au domaine. Ils n'achetaient rien et ne vendaient rien, puisque aussi bien les domaines voisins se trouvaient placés dans des conditions économiques analogues. Partant, ils ne disposaient pas, ou guère, de numéraire; les redevances qu'ils devaient payer au propriétaire du domaine et les dîmes dont ils étaient redevables à l'Eglise, ils les acquittaient en nature; les céréales, les chapons et les oeufs remplaçaient les sous et les deniers.
L'absence de quasi toute circulation de biens, la grande rareté du numéraire et l'autarcie économique du domaine expliquent le manque presque total d'activité marchande en ces siècles reculés. Seuls quelques grands propriétaires fonciers, quelques églises et quelques abbayes transformaient parfois une pièce d'orfèvrerie ou de la vaisselle précieuse en lingots ou en monnaie, afin d'acheter à des marchands occasionnels et itinérants, certains produits rares ou de luxe, nécessaires à la célébration du culte, à l'aménagement du château ou à l'armement du chevalier.
Ce régime économique, qui est celui de l'économie domaniale sans débouchés, supposait un régime social hiérarchisé au sommet, le grand propriétaire, détenteur de droits de justice plus ou moins étendus et dont la fonction essentielle consiste - théoriquement - à assurer, par les armes, la protection des églises et des populations rurales; au bas de l'échelle sociale, la paysannerie. Celle-ci est composée d'individus dont la condition personnelle et réelle varie, certes, à l'infini, mais qui ont tous pour trait distinctif de s'adonner à la culture du sol et de se trouver dans une dépendance plus ou moins étroite vis-à-vis d'un propriétaire-seigneur. Seuls les membres du clergé échappent à ces catégories; le clerc est, en effet, par essence, un homme libre. Mais les églises et les abbayes sont, elles aussi, de grands propriétaires fonciers; elles se sont intégrées dans le régime féodo-seigneurial et elles détiennent généralement des droits régaliens importants.
Une pareille organisation sociale n'est pas favorable, cela va sans dire, à un régime de libre circulation des biens. Et cependant cette circulation n'a jamais cessé d'une manière absolue. Il s'est trouvé, en tous temps, des colporteurs, qui, munis d'une légère pacotille et stimulés par l'apprit du gain, ont erré de château en château, de moutier en moutier, bravant les difficultés des communications et les dangers d'une société sans police où seul régnait, en fait, le droit du plus fort.
A la fin du Xème et dans le courant du XIème siècle, on observe que le nombre de ces marchands itinérants augmente considérablement dans nos régions. Ce phénomène peut s'expliquer par nombre de raisons; les principales sont, sans doute, la sécurité relative que la disparition des pillards normands et hongrois a fait naître, l'accroissement de la population et l'obligation pour une masse de gens que la terre, incomplètement défrichée et mal cultivée, ne peut plus nourrir, de chercher un moyen de subsistance dans l'activité marchande. Qu'on joigne aussi à ces considérations l'action des famines, si nombreuses au haut moyen âge. Lorsque, par suite d'une récolte manquée, une région se trouvait sans subsistance, ce devait être, pour certains individus entreprenants et peu scrupuleux, une tentation bien forte que de la ravitailler au prix fort, en allant quérir au loin les vivres indispensables. C'est alors, sans doute, qu'on a dû voir une foule de serfs fuir leur domaine et nombre de cadets, non pourvus de terre, échapper à l'armature hiérarchisée de la société féodale. C'est parmi ces groupes d'a-sociaux et dans ces milieux d'aventuriers que se sont recrutées les premières générations de marchands que le moyen âge ait connus.
Il est un autre phénomène encore, de caractère externe, qui devait favoriser, à son tour, la naissance et l'extension de la classe marchande. Les Normands n'ont pas été seulement les pillards que chacun sait; dans le bassin de la Baltique, leur pays d'origine, ils se sont, dès le IXème siècle, adonnés à une activité mercantile d'envergure non négligeable. Ils ont créé sur les côtes slaves et germaniques de cette Méditerranée du Nord, toute une série de comptoirs commerciaux; ils ont monopolisé le trafic des marchandises qu'à travers la plaine russe, au réseau hydrographique si favorable, on allait chercher jusqu'à Byzance et jusqu'en Perse; ils ont, enfin, établi un réseau de voies commerciales à travers la péninsule du Jutland et importé dans le bassin de la Mer du Nord, les produits exotiques qui arrivaient autrefois par la Méditerranée, avant que les Arabes n'en aient rendu l'accès, sinon impossible, tout au moins fort malaisé. Ce trafic normand qui aboutissait aux embouchures du Rhin et de la Meuse a doté ces régions d'une activité toute nouvelle; leurs habitants - les Frisons - n'ont eu qu'à remonter les cours de ces fleuves pour pouvoir nouer, avec les populations de l'hinterland rhéno-mosan, des relations économiques fructueuses.
Or, ce courant commercial frison, d'origine maritime et conditionné par le trafic russo-scandinave, est concomitant, dans le temps, avec l'essor commercial, qui, pour les raisons citées plus haut, se développe sur le continent, à la fin du Xème et au début du XIème siècle. C'est dans les bassins du Rhin et de la Meuse que le renouveau économique se manifeste d'abord. Le long de ce dernier cours d'eau apparaissent toute une série d'agglomérations marchandes; ce sont à l'origine, de modestes débarcadères, sièges d'ateliers monétaires, où, autour des maisons en bois et en torchis, autour d'auberges bruyantes et de hangars bourrés de marchandises hétéroclites, s'affairent des marchands, des bateliers, des charretiers, des débardeurs et tous ceux qui ayant, pour une raison quelconque, quitté leur champ, désirent louer leurs bras, leurs services ou leurs capacités. Déjà, sur une échelle infiniment modeste, la ville « tentaculaire » exerce son attrait sur les ruraux que fascine l'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie moins monotone ou d'un travail plus rémunérateur.
De semblables « villes neuves » qu'on a pu, avec raison, comparer aux agglomérations nées en Amérique, autour des puits de pétrole et de placers d'or, s'échelonnent, dès le Xème siècle, à une trentaine de kilomètres l'une de l'autre - l'étape d'un jour - le long du cours moyen de la Meuse. Ce sont Dinant, Namur, Huy, Liège et Maestricht.
En bien des cas, ces places de commerce ne se sont point établies en terrain vierge, mais à proximité d'un centre ecclésiastique ou militaire préexistant. Tel est le cas, notamment, de Liège, dont nous aurons désormais à nous occuper exclusivement ici.
I.
Les classes sociales à Liège avant le XIIIème siècle.
L'agglomération marchande, bourgeoise et laïque de Liège est née à l'ombre d'une autre agglomération, plus ancienne, de caractère domanial, clérical et ecclésiastique. Ce dernier centre, simple hameau à l'époque franque, servait, depuis le début du VIIIème siècle, de résidence aux évêques de Tongres. Ainsi Liège était devenue une « cité », puisque aussi bien la terminologie de l'époque réservait uniquement ce nom aux villes épiscopales.
Ce fait devait avoir, pour toute l'histoire subséquente de la grande ville mosane, les conséquences les plus durables.
Alors qu'en beaucoup d'autres endroits le centre « pré-urbain » consiste en un élément peu important généralement un château ou une abbaye fortifiée qui, par suite même de sa médiocrité et de son caractère économique passif, a été, plus ou moins rapidement englobé dans la ville marchande, à Liège, au contraire, cette agglomération « pré-urbaine » avait déjà pris, au moment où se constitua le quartier marchand, une ampleur et une consistance considérable. Aussi bien l'expression « pré-urbaine » que nous utilisons ici pour sa commodité et aussi parce qu'elle a pris, sous la plume des historiens, un sens quasi technique, n'est-elle, en fait, pas de mise à Liège. Le « bourg » marchand n'annihilera pas la « cité » épiscopale; celle-ci pèsera de tout le poids de ses traditions sur les destinées de celui-là et ce ne sera pas une des moindres caractéristiques de l'histoire politique et sociale de Liège, que la part considérable que le clergé, en tant que tel, prendra toujours aux péripéties qui se dérouleront dans l'enceinte de la Cité Ardente.
L'importance acquise par Liège dès la fin du Xème siècle, elle la doit surtout à Notger (972-1008). Ses prédécesseurs avaient déjà élevé dans leur « capitale », outre le palais épiscopal, la cathédrale Saint-Lambert, l'église paroissiale de la cité Notre-Dame-aux-Fonts et l'église Saint-Servais, trois collégiales dédiées respectivement à saint Pierre, saint Martin et saint Paul. Dès le milieu du Xème siècle la ville épiscopale ne se cantonnait donc plus dans les étroites limites de la Cité proprement dite, resserrée entre le coude de la Meuse, la côte, de Pierreuse et la colline du Publémont. Elle s'étendait déjà sur les pentes et sur la crête de cette dernière, comme l'atteste la construction de Saint-Pierre et surtout de Saint-Martin; d'autre part, dans l'île qui lui faisait face au midi, l'érection de Saint-Paul témoigne déjà d'un peuplement assez important.
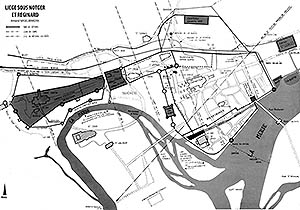
LIEGE SOUS NOTGER ET REGINARD - Nagelmakers
Notger fit, non seulement, reconstruire et agrandir ces églises dues au zèle de ses prédécesseurs, mais il édifia encore trois autres collégiales Sainte-Croix, Saint-Denis et Saint-Jean. Ainsi s'observe parfaitement l'extension de la ville en direction de l'Ouest et du Sud; une notable partie du Publémont et de l'Ile est désormais terre d'église et, dès cette époque, on a dû y construire des maisons pour les chanoines et leurs serviteurs.
La juxtaposition de ces différents centres ecclésiastiques - chaque collégiale se double d'une église paroissiale - devait singulièrement accroître l'importance de la ville épiscopale. On a estimé à un millier, au moins, le nombre des clercs de tout grade qui vivaient dès lors à Liège. Qu'on y joigne deux à trois mille domestiques, artisans, serviteurs, cultivateurs et tenanciers d'église et on comprendra aisément qu'une pareille agglomération, de caractère avant tout ecclésiastique et domanial, devait constituer un puissant pôle d'attraction pour les marchands itinérants de l'époque.
Qui, si ce n'est eux, pouvait, en effet, procurer à ces prêtres et à ces églises l'encens odorant, les tapis d'autel, les aubes de drap ou de lin, les dalmatiques brodées d'or, les ciboires d'argent, les aiguières ciselées, les coussins bariolés, les reliures d'ivoire, les patènes, les étoles, les tapisseries multicolores, les étoffes de soie qui enveloppaient les saintes reliques, sans parler des épices, des drogues et des plantes médicinales? Ce n'étaient évidemment pas les domaines suburbains qui pouvaient fournir ces produits exotiques et ces objets rares que convoitaient toutes les églises au haut moyen âge et ce n'étaient certes pas les artisans domestiques des clercs et chanoines liégeois, qui possédaient l'habileté technique nécessaire pour fabriquer tous les ornements dont s'enorgueillissaient les trésors des collégiales. Plusieurs d'entre eux conservent encore aujourd'hui de somptueuses étoffes de soie byzantines; si elles n'ont pas toutes été apportées du Proche-Orient par des pèlerins ou des croisés, il est séduisant de penser que, tissées dans les gynécées de la ville du Bosphore, elles ont transité à travers l'Ukraine pour être vendues aux foires de Novgorod et aboutir enfin dans la barque d'un marchand frison ou dans le lourd et grinçant chariot qu'un mercator, au hasard de ses voyages, convoyait en terre liégeoise.
Ces marchands ne pouvaient cependant pas, sans trêve, courir les routes et descendre les rivières; il leur fallait un gîte pour l'hivernage. Au Xème siècle Liège offrait toutes les conditions requises pour devenir un gîte semblable. Non seulement le marchand y trouvait, sur place, une clientèle assurée, mais il y pouvait aussi abriter en toute sécurité ses marchandises, ses chariots et toute cette fortune mobilière dont la possession fait de lui un être essentiellement différent du cultivateur.
En effet, Notger avait ceint d'un mur, sinon toute l'agglomération liégeoise, tout au moins ses deux quartiers essentiels: la cité et le Publémont. Appuyée aux parois et aux tours des églises qui s'encastraient parfois dans l'enceinte - celle de Saint-Denis conserve encore aujourd'hui l'aspect d'une forteresse - la muraille dessinait un quadrilatères irrégulier, dont un des angles s'enfonçait dans le coude que formait la Meuse; elle englobait, en appendice, le long et étroit rectangle du Publémont. Le quartier de l'Ile demeurait sans fortifications.
Où donc la colonie marchande allait-elle élire domicile à l'intérieur de cette enceinte? Aucun texte ne nous le dit explicitement, mais un coup d'oeil sur le plan de la ville est susceptible de nous l'apprendre, sans doute possible. C'est toute la moitié Est de la cité, située à droite du Palais, de Saint-Lambert et de Saint-Denis, qui est devenue le quartier de résidence des marchands. C'est là, en effet, qu'on trouve le marché et la halle; c'est là que se construira, plus tard, l'hôtel de ville; c'est là que, le long de la Meuse et au pied même du rempart (Quai sur Meuse, Quai de la Ribuée, Quai de la Golfe) les barques pouvaient aisément être chargées et déchargées; c'est là, enfin, que serpente la rue Neuvice, dont le nom (novus vicus = nouveau quartier) rappelle éloquemment et plus clairement peut-être que ne le pourraient faire des textes, le caractère et l'histoire de cette région urbaine. Peut-être quelques familles de marchands avaient-elles aussi déjà élu domicile dans l'île, aux alentours de l'église Saint-Paul; le vinâve, ou voisinage d'île, leur devrait, dans ce cas, son origine.
Ce n'est pas ici l'endroit de décrire, dans le détail, l'histoire du développement territorial de Liège. Bornons-nous à constater que, dans le cours des XIème et XIIème siècles, la croissance et l'extension de la ville sont dues, avant tout, au dynamisme des classes marchandes. Le quartier du marché dut déborder très tôt en dehors de l'enceinte notgérienne puisque en 1015 on éleva, le long de la route vers Maestricht, à environ quatre cents mètres en dehors de la porte Hasseline, une nouvelle collégiale - celle de Saint-Barthélemy - et que, entre 1025 et 1037, on construisit, en face du novus vicus un pont qui, parce qu'il comptait au moins une douzaine d'arches, prit le nom qu'il a conservé jusqu'à nos jours. Ainsi se trouvait réalisée la jonction avec le quartier d'Outre-Meuse. Peu après de semblables communications reliaient l'île, d'une part, à la cité par la construction du Pont d'île (XIème siècle?), d'autre part, au village d'Avroy par l'achèvement du Pont d'Avroy (avant 1056).
Ainsi donc, dès l'époque de Notger, les deux classes sociales qui étaient appelées à cohabiter dans la cité - le clergé et la bourgeoisie marchande - sont en place. On aimerait à être mieux renseigné sur l'histoire de cette dernière; malheureusement les documents qui la concernent tiennent dans le creux de la main. Liège, au passé si prestigieux, est une ville qui n'a presque pas d'archives pour la période médiévale; ce qui a échappé aux incendies et aux dévastations de l'époque bourguignonne, à la négligence des archivistes de l'Ancien Régime et à la tourmente des révolutions, tient dans huit mètres de rayons
Ce n'est pas que l'historiographie liégeoise ne soit riche pour le, haut moyen âge, mais elle concerne presque exclusivement le monde clérical de la cité. On sait que celle-ci compta, au XIème siècle, de brillantes écoles qui firent de Liège - l'Athènes du Nord comme l'écrit pompeusement un écolâtre! - un des centres d'études les plus réputés de l'Empire et de l'Europe Occidentale. On sait que, parmi les clercs liégeois, il y eut des poètes, des théologiens, des mathématiciens, des musiciens de mérite; on sait aussi le rôle que les évêques de Liège jouèrent à la cour des empereurs et durant la querelle du Sacerdoce et de l'Empire.
Mais sur l'histoire des classes marchandes et artisanes qui vivaient à deux pas de ces églises et de ces écoles réputées, on ne sait presque rien. Les chroniqueurs et annalistes, tous clercs, les ignorèrent et n'estimèrent pas que les faits et gestes de ces hommes méritaient d'être consignés, au même titre que les, récits hagiographiques et les événements religieux. Pourtant il a dû y avoir, entre ces deux éléments de la population, des rapports constants, peut-être des luttes, certainement des heurts et des frictions. On sait, en effet, que l'Eglise, au haut moyen âge, s'est montrée peu favorablement disposée envers la classe marchande; le commerce lui paraissait être une activité illicite et le genre de vie des marchands, aux moeurs souvent rudes et brutales, devait lui déplaire grandement. A la stabilité du régime domanial, d'aspect domestique et, parfois, patriarcal, qui enchaînait l'homme à la terre et l'intégrait dans un réseau pesant, mais protecteur, de liens personnels et réels, les marchands substituaient une conception d'organisation sociale et politique plus libre, plus individualiste, plus souple ou, si l'on veut, plus anarchique.
Mais si l'installation de ces marchands devait susciter bien des occasions de conflits, le prince y trouvait cependant aussi nombre de profits. L'accroissement de la circulation des biens provoquait une augmentation considérable des revenus des tonlieux et autres droits de péage. Les marchands occupaient, d'autre part, un sol qui appartenait à l'église de Saint-Lambert et ils devaient, de ce chef, lui payer des redevances; il est probable, qu'au début, on a voulu assimiler ces redevances aux prestations que fournissaient les serfs et les tenanciers ruraux. Les marchands n'ont certainement pas pu souscrire à pareilles exigences. De même, le droit qui régissait tous ceux qui dépendaient de Saint-Lambert et que les Liégeois aimaient à appeler la loi Charlemagne, ne pouvait convenir à une population qui menait une existence si différente de celle des membres de la familia épiscopale.
Il ne nous est pas possible, vu le manque de place et l'objet même de cet ouvrage, de traiter ici du difficile et complexe problème de l'origine du droit urbain liégeois et de la commune liégeoise. Contentons-nous de souligner quelques faits essentiels pour la compréhension de l'histoire des classes sociales à Liège.
On ignore à quelle date les premières libertés accordées à la population laïque et marchande de Liège, furent consignées par écrit. Il est possible cependant de la fixer approximativement. En 1066 les bourgeois de Huy avaient reçu du prince-évêque une charte, qui est probablement le plus ancien document de ce genre délivré en Europe Occidentale. Or, il n'est pas téméraire de penser que Liège ne dût pas être moins bien loti que sa ville soeur, puisque son évolution économique - quoi qu'on en ait dit - ne retardait sans doute pas beaucoup sur celle de cette dernière. D'autre part, un diplôme accordé par l'empereur Henri V, en 1107, au clergé de la cathédrale, contient certaines stipulations en faveur des laïques liégeois « pour autant qu'ils sont, dit le document, des marchands notoires ». Ne peut-on conclure de là qu'il existait, à cette date, une bourgeoisie organisée et régie par certaines règles juridiques distinctes de celles auxquelles les hommes de l'église de Saint-Lambert étaient assujettis? Ainsi donc, c'est entre 1066 et 1107, et vraisemblablement à un moment plus rapproché de la première de ces dates que de la seconde, que l'agglomération marchande liégeoise a reçu ses premiers privilèges.
A qui était dévolue, à cette époque, l'administration de la ville? Au tribunal des échevins. Il faut entendre par là un groupe de quatorze personnes, présidé par le maïeur; elles sont nommées par l'évêque et recrutées parmi les propriétaires fonciers de la ville et peut-être aussi, dès le XIIème siècle, parmi les marchands les plus riches et les plus considérables de la cité. Ce tribunal public, dont l'origine remonte, peut-être, aux temps carolingiens, s'est donc modifié, quant à sa composition, sous l'influence des nouvelles conditions sociales. Mais si quelques marchands en ont forcé l'entrée, il n'en reste pas moins, dans son principe, une institution princière; il n'est pas l'organe même de la bourgeoisie urbaine et les marchands qui y siègent y sont admis non pas en tant que marchands et bourgeois, mais en tant que propriétaires fonciers puisque très tôt, en effet, des commerçants enrichis ont dû investir leur fortune en terres. La compétence de l'échevinage s'étend à tout le territoire, exception faite des nombreuses immunités ecclésiastiques qui l'émaillent. A cette époque où la notion de la séparation des pouvoirs n'existe pas, ce tribunal exerce, non seulement la juridiction administrative et gracieuse, mais il était aussi compétent en matière civile et criminelle. Il est, dans toute la force du terme, la Loi.
En face des échevins, officiers du prince, juges et administrateurs de la cité, il y a le clergé. Au sein de celui-ci le groupe le plus puissant est constitué par le chapitre de Saint-Lambert; les chanoines de la cathédrale - communément appelés les tréfonciers - sont co-seigneurs de la principauté et forment le conseil du prince. Entre ces deux éléments, les conflits ont été fréquents dès la fin du XIème siècle, car « le Liège laïque relevant des échevins et le Liège ecclésiastique, relevant des tréfonciers, n'ont cessé de se disputer sur les confins de leurs domaines respectifs ».
Les chanoines défendaient un point de vue qui se fondait sur le principe de la personnalité du droit: les habitants de Liège, rattachés par des liens personnels ou réels au clergé, relèvent de la juridiction de celui-ci. Les échevins, au contraire, adoptaient une thèse qui s'appuyait sur le principe de la territorialité du droit: tous les habitants laïques de Liège sont soumis à l'autorité des magistrats civils.
Il serait faux de penser que le prince, parce qu'il était en même temps évêque, soutint nécessairement la cause du clergé. Otbert (1091-1119) n'hésita pas à encourager l'échevinage et, en 1104, au cours d'un conflit entre les bourgeois et le clergé, un contemporain nous apprend que l'évêque « foulant aux pieds le droit civil qui régnait à Liège, changea les lois des ancêtres, annula les coutumes et, afin de pouvoir opprimer plus librement les petits, veillait à se ménager les grands et s'attirait, au moyen de dons et de promesses, les sympathies des plus puissants ».
Qu'est-ce à dire, sinon que l'évêque, tirant de l'évolution sociale à laquelle il assistait les conclusions nécessaires, prit sur lui de favoriser les revendications des marchands, au détriment des droits coutumiers sur lesquels se fondait le clergé. Un pareil texte en dit long, dans sa brièveté un peu confuse, sur l'importance sociale de marchands liégeois. Il est d'ailleurs corroboré par d'autres renseignements contemporains, qui nous montrent ces mêmes hommes, figurant comme témoins aux actes de ce prince et intervenant dans les affaires publiques. Et quant à leur « standing » économique, il n'est pas de moindre importance; ces mêmes marchands qui s'enrichissent dans le commerce des draps et des pelleteries, ainsi que dans l'industrie de la tannerie et dans celle du laiton, trafiquent avec un grand nombre de places de commerce de l'Europe; on les trouve à Londres, en Scandinavie, le long du Rhin et aux mines de cuivre de Goslar, dans le Harz. Ils sont probablement groupés en une association ou gilde.
Bientôt ces mêmes individus désireront avoir un organisme administratif et politique bien à eux. Cette nouvelle étape dans l'histoire constitutionnelle et sociale de la cité mosane fut franchie, d'une manière toute pacifique semble-t-il, entre 1176 et 1184. Les membres de l'échevinage s'adjoignirent douze assesseurs, élus parmi les citoyens de la ville par l'ensemble des bourgeois. Dans le sein de ce conseil de « jurés », l'échevinage choisissait alors deux maîtres, appelés à présider le dit conseil.
Ainsi donc l'échevinage de Liège, qui tient son pouvoir du prince et qui est « la juridiction de la loi », ne s'est pas transformé en une magistrature communale; la bourgeoisie a créé, à côté de lui et en accord avec lui, un organisme nouveau auquel sera réservé le nom de « juridiction des statuts ». Cette dualité caractéristique s'explique, en grande partie, par le fait que, dès le XIIème siècle, trois éléments politiques et sociaux s'affrontent à Liège: le prince-évêque, le chapitre, la bourgeoisie. Cette dernière, en conflit constant avec les tréfonciers, a été obligée, par cela même, de composer avec le prince. Elle n'a pas pu l'évincer, ni en fait ni en droit. Peut-être n'avait-elle pas non plus l'écrasante supériorité économique qu'on lui connaît ailleurs, en Flandre, par exemple.
Quoi qu'il en soit la commune liégeoise n'est pas née, comme c'est souvent le cas dans la France du Nord, d'un mouvement révolutionnaire; elle sera agitée aux XIIIème et XIVème siècles par des troubles très graves, mais ceux-ci - nous le verrons plus loin - s'expliquent par le désir de certaines couches sociales de bourgeois de jouer dans l'administration communale un rôle prépondérant; ces luttes, aux aspects si farouches, n'ont pas pour cause la naissance et l'existence même de la commune. Aussi ces conflits - et c'est là leur originalité - auront-ils tout autant un caractère social qu'un aspect politique.
La création du conseil des jurés a pu s'opérer d'une manière pacifique parce que, dans le cours du XIIème siècle, les princes n'ont cessé de prodiguer leur appui à la bourgeoisie urbaine. Mêlés à tous les événements de la politique internationale, souvent absents du pays, ils ont dû voir d'un bon oeil se constituer un pouvoir que, par l'intermédiaire de l'échevinage et du maïeur, ils se flattaient d'ailleurs de tenir en bride, et qui était susceptible, par ailleurs, de contrebalancer la trop grande puissance du chapitre de Saint-Lambert.
C'est pour se concilier la bourgeoisie qu'un prince-évêque, qu'on identifie traditionnellement avec Albert de Cuyck, mais qui est peut-être, en fait, son prédécesseur Albert de Louvain, lui concéda, à la fin du XIIème siècle, une charte de liberté, célèbre dans les annales de la cité. A vrai dire ce document fameux n'innove guère; il concrétise seulement les conquêtes réalisées par la bourgeoisie depuis plus d'un siècle. II se borne à confirmer les éléments essentiels de la coutume civile liégeoise, il fixe certains points relatifs au ravitaillement de la cité, il dote les bourgeois de garanties en matière d'impôts et de service militaire. C'est à la fois, comme l'a dit G. Kurth, une constitution, un code et un règlement de police, sans être rien de tout cela complètement. La charte proclamait certains principes de liberté personnelle, d'inviolabilité du domicile et des biens qui ont depuis été repris par la Constitution belge de 1831. Mais, comme l'a si justement fait observer l'historien de la cité de Liège au moyen âge « ce droit, il est essentiel de le remarquer, n'est pas celui d'une classe ni d'un parti. Il n'accorde pas de protection spéciale aux intérêts particuliers, et, quand ceux-ci sont en opposition avec l'intérêt commun, il se prononce imperturbablement en faveur de la généralité. Protéger d'une manière égale toute la population qui vit dans l'enceinte de la cité, assurer à tous les Liégeois la pleine jouissance des libertés indispensables à toute population urbaine, tel est son but et il n'en a pas d'autre. Des institutions politiques, la charte ne parle pas; elle les suppose et elle les implique. C'est à la commune qu'elle est donnée cela suffit pour attester l'existence de celle-ci sans qu'il soit besoin de l'affirmer ».
Du milieu du XIème au début du XIIIème siècle, les bourgeois de Liège, participant à l'activité économique intense et internationale propre à tout le pays mosan, ont, peu à peu et sans luttes violentes, conquis tout un ensemble de droits civils qui leur confèrent un statut personnel privilégié dans la cité. Ils sont un élément social actif et progressif.
A côté d'eux le clergé, jaloux de ses immunités qu'il défend avec vigueur, représente, au contraire, un élément conservateur. Il tient sous sa dépendance une classe assez nombreuse de tenanciers et de serviteurs citadins.
Le prince-évêque paraît avoir adopté, dans l'ensemble, une attitude assez bienveillante envers la bourgeoisie qu'il juge et administre par l'intermédiaire de ses échevins. Dans son entourage il convient de signaler l'existence d'un nombre assez considérable d'individus qui, ne jouissant pas originairement de la pleine liberté et chargés primitivement de fonctions domestiques, se sont, petit à petit, élevés dans la hiérarchie sociale, grâce à l'exercice de multiples offices auliques, domaniaux, administratifs ou militaires. C'est parce qu'ils sont chargés d'un ministerium (office, fonction) qu'on les appelle ministériaux (ministeriales) et c'est, parmi eux, que se recrutent les sénéchaux, échansons, panetiers, chambellans et châtelains du prince. En outre celui-ci choisissait aussi certains membres de l'échevinage liégeois parmi ses ministériaux. Un grand nombre d'entre eux résidaient à Liège et y vivaient dans l'entourage immédiat du prince, tels les membres des familles de Pré, de Pont, de la Tour. Nous les verrons, plus tard, se fondre dans la noblesse ou dans le patriciat urbain.
A partir du XIIIème siècle l'histoire sociale de Liège va évoluer selon un rythme très différent de celui du passé. L'activité économique change d'aspect dans le pays mosan; le grand courant économique international qui le traversait se déplace vers Bruges et la Flandre, bientôt aussi, vers le Brabant. Du point de vue politique également la région de Liège perd de son importance européenne parce que les beaux jours de l'Empire sont comptés. Elle va désormais se replier sur elle-même et vivre d'une vie plus locale, mais non moins agitée. Les répercussions de ce fait sur le plan social seront - comme nous le verrons - considérables.
II.
Les historiens des institutions urbaines médiévales ont coutume d'utiliser l'expression « patriciat » pour désigner, dans le sein de la bourgeoisie urbaine, une classe sociale particulièrement éminente par sa richesse et son influence. L'emploi de ce mot, repris à la terminologie de l'histoire ancienne n'implique, cela va sans dire, aucune relation ni aucune identité entre la classe des patriciens romains et l'aristocratie bourgeoise des villes du moyen âge.
On est trop mal renseigné sur la consistance réelle des milieux urbains laïques à Liège pour pouvoir faire entre eux, avant la fin du XIIème siècle, de nécessaires distinctions d'ordre social. L'expression « bourgeoisie marchande » est employée, faute de mieux, pour désigner une classe à l'intérieur de laquelle il y y a dû avoir, en fait, toute une gamme nuancée de conditions sociales. Les écrivains du moyen âge usent du mot marchand (mercator) pour faire allusion à toute espèce d'individu s'adonnant à une activité commerciale ou industrielle, qu'elle soit de petite ou de grande envergure. Et quant au mot « bourgeois » - du latin burgensis - il a, sous la plume des chroniqueurs, non pas un sens social, comme aujourd'hui, mais une signification purement territoriale: les bourgeois sont les habitants laïques du bourg, c'est-à-dire du territoire urbain ceint d'une muraille, ou de ses abords immédiats.
A partir du XIIIème siècle, il devient loisible, grâce à une documentation plus abondante, de substituer à cette vue trop sommaire des choses, une image qui serre de plus près la réalité. On s'aperçoit alors que du sein de la bourgeoisie - sensu lato - émerge une classe de gens riches qui joue un rôle politique important dans la cité. C'est l'aristocratie marchande ou le patriciat urbain.
Quelles sont ses origines? On en dispute; en l'absence d'une étude détaillée sur cet intéressant sujet, nous ne pouvons qu'esquisser ici certaines données du problème. A notre avis ce patriciat a une double origine. Il est constitué, tout d'abord, par des marchands enrichis, en particulier par les descendants de ceux qui, aux XIème et XIIème siècles, s'adonnaient au commerce au long cours; d'autre part, nous pensons aussi que plusieurs lignages patriciens remontent à des familles de ministériaux épiscopaux et de propriétaires fonciers.
L'emploi d'une expression aussi générale que « patriciat » pour désigner un milieu social aux contours nécessairement mal définis peut, avec raison, prêter le flanc à la critique. Il importe donc d'examiner quelles réalités concrètes se cachent derrière ce mot et ce aux différentes époques du moyen âge. Jusqu'au XIIIème siècle il faut entendre par patriciat l'ensemble des lignages ou familles dans le sein desquels sont choisis les échevins. Au XIIIème siècle il se constitue, à côté de ce patriciat, une classe sociale de gens riches qui seront désireux de jouer un rôle politique dans la cité et qui, petit à petit, finiront, à la fin de ce siècle, par se confondre avec le patriciat scabinal. C'est à ces deux milieux sociaux, très différenciés à l'origine, qu'au XIVème siècle on donnera uniformément le nom de patriciat, parce que tous deux s'opposent alors à la classe des artisans. Or, la documentation relative à l'histoire liégeoise ne devient abondante qu'à partir du XIVème siècle, de sorte que toute la terminologie historique dont nous usons encore est reprise à des auteurs qui confondent en un seul mot deux milieux, qu'un siècle plus tôt on ne tenait nullement pour identiques.
De nos jours le prolétariat use du mot « bourgeoisie » pour désigner l'ensemble de tous les possédants; or, il y a une bonne centaine d'années « bourgeoisie » n'était, en fait, qu'une fraction de la classe possédante; elle se distinguait très nettement de l'autre classe possédante, la noblesse, et elle avait un idéal politique très différent de celle-ci. En un siècle la distinction entre les deux milieux s'est fortement atténuée, à telle enseigne que beaucoup de « bourgeois » ont acquis des titres de noblesse, ce qui n'aurait pas manqué d'indigner, il y a cent ans, leurs ancêtres et de faire sourire, il y a cinquante ans, leurs parents. Sans doute, dans le sein de la noblesse et de la bourgeoisie, au sens restreint du mot, on n'a pas encore perdu de nos jours la notion de certaines distinctions à faire entre ces deux milieux, mais le prolétaire d'aujourd'hui qui ne voit en eux que des possédants et qui, bien entendu, ne raisonne ni en historien ni en sociologue, confond les représentants de ces deux couches sociales sous l'appellation unique de bourgeois. De même aux yeux de l'artisan liégeois des XIVème et XVème siècles les « patriciens » ou « grands » ou « nobles » ne forment, quelle que soit leur origine respective, qu'une seule et même classe
Il importe de signaler ici comment une partie de la population marchande de Liège s'est, au cours du XIIIème siècle, transformée en un patriciat d'argent et comment, peu à peu, celui-ci s'est confondu avec le patriciat scabinal.
Les causes de ce phénomène sont d'ordre économique.
A partir du XIIIème siècle le grand commerce international déserte le pays mosan; beaucoup de marchands cessent de voyager de foire en foire; ils restent sur place et vont désormais se préoccuper de faire fructifier la fortune qu'ils doivent au travail de leurs ascendants. De marchands qu'ils étaient, ils deviennent rentiers; d'où les épithètes de fainéants, paresseux, otiosi, que leur décernent les gens des classes populaires. Nombre d'entre eux s'adonnent au commerce de l'argent et la conjoncture économique du moment favorise singulièrement cette activité. Le XIIIème siècle est, en effet, une époque de grands bouleversements monétaires et partant, de profondes transformations sociales. La baisse de la valeur de l'argent et la hausse des prix, conséquences du développement de la fortune mobilière, affectent durement tous ceux qui vivent de revenus fixes, c'est-à-dire particulièrement les nobles. Ceux-ci, en effet, touchent du chef de leurs propriétés foncières, des cens dont le montant a été fixé, une fois pour toutes, par la coutume, depuis plusieurs siècles; or, ces revenus, qui faisaient la fortune de leurs aïeux ne leur permettent plus guère que de vivoter. Pour maintenir leur rang social, les nobles sont acculés à l'obligation d'emprunter.
Or, à qui s'adresser si ce n'est à ces riches marchands liégeois, dont les fortunes cherchent précisément un emploi? Un des plus anciens exemples que l'on puisse citer à ce propos, est celui d'un bourgeois de Liège, appelé Albert et signalé comme prêteur d'argent dès 1138. Et au siècle suivant de pareils faits deviennent très fréquents; on n'en veut pour preuve que les noms portés par certaines familles liégeoises. A une époque où, précisément, les noms de famille font leur apparition, ils consistent souvent en un surnom caractéristique, donné jadis à un individu et stabilisé ensuite dans le chef de ses descendants. Or des noms tels que del Canges, Tirebourse, des Balances (allusion au trébuchet qui servait à peser les espèces d'or et d'argent?), Maille à Maille (nom d'une monnaie), ne peuvent faire qu'allusion à des familles d'opulents changeurs et banquiers.
Ceux-ci, groupés en une gilde ou « frairie » ne trouvaient pas seulement une clientèle assurée auprès des nobles désargentés; les églises et les abbayes qui souffrent aussi de la crise économique parce que leur fortune consiste également en revenus fonciers fixes, sont à leur tour obligées de recourir à l'emprunt. Or on sait l'importance et le nombre des établissements écclésiastiques à Liège et dans le diocèse. En 1254 Guillaume de Ryckel, abbé de Saint-Trond, doit emprunter de fortes sommes au changeur liégeois Jean de Dinant - le frère du fameux Henri de Dinant, dont il sera question plus loin - au taux, nullement excessif pour l'époque, de 48,57 %. En 1251 le pape Innocent IV doit prendre des mesures pour protéger l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne contre les agissements usuraires de certains changeurs de Verdun, de Liège et de Reims. Certes, l'église condamnait l'usure et saint Thomas d'Aquin formulait, précisément à la même époque, sa fameuse théorie sur le prêt à intérêt. Mais, dans la pratique, il existait bien des moyens de côtoyer le droit, et les créanciers des églises ne manquèrent pas d'y recourir souvent.
Ces capitalistes liégeois virent d'un très mauvais oeil l'installation dans la cité de Lombards, c'est-àdire de prêteurs sur gages, d'origine italienne, qui les menaçaient d'une redoutable concurrence. Aussi obtinrent-ils, en 1303 de l'évêque Adolphe de Waldeck l'expulsion des Lombards. Ils finiront cependant, plus tard, par tolérer leur présence dans la ville et le 28 mai 1394 on accordera même le droit de cité complet à six Lombards, en raison des services financiers qu'ils avaient rendus à la ville. Par contre on ne trouve jamais trace, au moyen âge, de Juifs dans la ville mosane, exception faite d'un, médecin, nommé Moïse et cité en 1138.
Mais ce n'est pas seulement le placement d'emprunts qui occupe exclusivement ces manieurs d'argent. Ils investissent aussi une partie de leur fortune en rentes et en terres, ce qui leur permet parfois d'acquérir des seigneuries et il est, par ailleurs, fort probable qu'ils ont aussi financé des exploitations houillères; c'est, en effet, à partir de la fin du XIIème siècle que l'extraction du charbon de terre se répand à Liège et on peut même se demander si celle-ci n'a pas été favorisée par la présence, dans la cité, de capitalistes susceptibles de procurer à cette industrie naissante l'appoint des fonds nécessaires. Ne voit-on pas, par exemple, l'échevin et patricien Thierry de Saint-Servais conclure avec le chapitre de Saint-Lambert un accord, le 15 octobre 1278, en vertu duquel il obtient des terres à Ans afin d'y procéder à l'extraction de la houille? Bien qu'elle ait gardé au moyen âge un caractère strictement local, cette industrie n'en fut pas moins importante; elle est absolument indigène et le mot « houille » lui-même, est un vocable liégeois.
Cependant tous les patriciens n'ont pas, au XIIIème et au XIVème siècle, abandonné complètement le négoce. Parmi les professions commerciales les plus importantes au moyen âge, il en est deux qui, à côté de celle de changeur, ont toujours eu un caractère, en quelque sorte, aristocratique; celles de marchand de draps et de vin. Ce sont là, en effet, des commerces de luxe et qui ont un rayon d'action international; ils exigent des capitaux assez considérables et n'ont pas nécessairement un caractère manuel.
Les « halliers » ou marchands de draps vendaient leur marchandise ainsi que les draps fins de Flandre et la laine d'Angleterre, dans une halle située près du marché dans la rue Sainte-Ursule actuelle. Contrairement à ce que G. Kurth et H. Pirenne ont prétendu, ils exportaient aussi des draps fabriqués à Liège même. Certes la draperie liégeoise n'a jamais eu l'importance et la renommée internationale de celle de la Flandre ou du Brabant, mais que l'on ne perde pas de vue qu'au moment même où la documentation devient abondante - XlIIème siècle - on assiste à la décadence de l'économie mosane. Les textes que nous possédons renseignent donc sur la période finale de cette économie, alors qu'en Flandre et en Artois, le XIIIème siècle voit, en fait, la pleine efflorescence de cette grande industrie. Et malgré cela quelques documents sont là, pleins de signification. Un certain Jean de Liège, marchand notoire, est signalé à Gênes de 1182 à 1201. Les riches archives notariales de cette ville italienne nous ont révélé, tout récemment, l'existence, entre 1200 et 1221 d'un groupe de marchands liégeois qui trafiquaient dans les murs du grand port de la Ligurie et expédiaient les toiles et les draps de Liège dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Sicile et jusqu'en Syrie. L'un d'eux, qui porte le nom caractéristique d'Arnould de la Halle, est installé à demeure à Gênes en 1213. Garnier de Dinant - un ancêtre, sans doute, de Henri de Dinant - et Lambert d'Outre-Meuse, souscrivent en 1191 au testament qu'un de leurs concitoyens rédige à Gênes et dans lequel il stipule d'importants legs en faveur des églises de sa cité natale. Enfin, au XIIIème siècle, particulièrement entre 1242 et 1285, des marchands liégeois - fâcheusement ignorés jusqu'ici, comme on l'a fait remarquer avec pertinence - sont signalés en Angleterre, où ils s'adonnent au commerce de la laine.
Les « viniers » ou marchands de vin en gros se recrutent eux aussi, dans le sein des lignages patriciens. On ne peut perdre de vue, qu'au moyen âge, on buvait beaucoup plus de vin, dans nos régions, qu'aujourd'hui; jusqu'au XIIème siècle, toutefois, le commerce du vin n'a pas dû être fort important à Liège, d'abord parce que les coteaux de la Meuse portaient de nombreux vignobles et surtout parce que presque tous les établissements ecclésiastiques - grands consommateurs de vin - possédaient aussi, dans le Nord de la France, en Rhénanie ou dans la vallée de la Moselle, des vignobles étendus. Mais, à partir du siècle suivant, ces églises se défont de la majeure partie de ces propriétés puisque, grâce à la renaissance du commerce, elles peuvent désormais se procurer, à meilleur compte, des vins importés à Liège par des marchands. Les crus du Rhin et de l'Alsace étaient, primitivement, les plus répandus mais en 1198 le bordeaux fut importé, pour la première fois, à Liège, via Bruges. Quant au bourgogne, s'il ne semble pas encore très apprécié à cette époque, les Liégeois en vinrent, par la suite, à de bien meilleurs sentiments à son égard.
Telles sont donc les principales activités économiques auxquelles s'adonne le patriciat d'argent liégeois. Pour accéder à ce milieu il suffit de jouir d'une fortune importante et de n'être pas, ou plus, un travailleur manuel. Ce patriciat est dont, dans toute la force du terme, une ploutocratie. Comme toutes les ploutocraties elle tend à se confondre avec la noblesse de naissance; beaucoup de patriciens acquièrent, à la fin du XIIIème siècle, la chevalerie ou entrent, par mariage dans des familles nobles. « Tous les riches hommes de Liège, écrit Hemricourt, ont puis cely temps mairieit leurs enfans et astaleis dedans les lignages delle evesquet de Liege, de Brabant, delle conteit de Namur et des pays marchissans ». Faut-il s'étonner de ce que à leur influence sociale et économique, ils aient aussi voulu joindre une réelle puissance politique?
Si tous les bourgeois jouissent maintenant de la plénitude des droits civils, seuls les patriciens possèdent, au XIIIème siècle, des droits politiques. Jusqu'en 1303-1313 c'est eux qui administrent la cité et c'est parmi eux, exclusivement, que se recrutent les échevins, les maîtres et les jurés. Les lignages accaparent toutes les charges scabinales, de sorte que, sur le plan politique, cette ploutocratie devient aussi une oligarchie. Les Saint-Servais, les de Lardier, de Neuvice, de Saint-Martin, d'Hemricourt, de Coir, Surlet - ancêtres du Surlet de Chokier qui fut régent de la Belgique en 1831 - del Cange, d'Ile sont, à tous égards, les vrais maîtres de la cité au XIIIème siècle. Et cela se conçoit aisément puisqu'ils sont, dans une large mesure, les artisans de sa prospérité. Leur crédit est considérable auprès du « commun », ils sont respectés et, peut-être, craints. Leurs fils forment la « jeunesse dorée » de l'époque; c'est parmi ces jeunes gens que se recrutent ces « enfants de France » qui, coiffés d'un chaperon blanc, procèdent, en 1303, à la perception d'un impôt de consommation particulièrement impopulaire et le bon Hemricourt qui s'extasie sur leurs faits et gestes, nous a raconté les avatars d'une jolie fille « folle de son corps » nommée Pâquette, qui s'étant éprise d'un jeune de Lardier, le guettait dans la rue pour se jeter, dès qu'elle le voyait, à ses pieds et lui baiser les mains ou le vêtement.
Mais au début du XIVème siècle cette omnipotence politique et sociale du patriciat liégeois commence à être mise en question. Les gens de métier vont exiger, les armes à la main, une participation au gouvernement de la cité; les luttes et les révolutions qu'ils vont déchaîner provoqueront la décadence politique du patriciat qui, en 1384, finira par être exclu complètement de la représentation dans ces assemblées où il avait trôné jadis en maître incontesté!
Les classes populaires et les corporations de métiers.
A cote du patriciat, il y a aussi la masse de la population laïque liégeoise. On a vu que celle-ci acquiert, dans le cours des XIIème et XIIIème siècles, des droits civils importants; elle constitue donc une classe privilégiée quant au statut personnel de ses membres. Tous sont bourgeois ou « citains » de Liège.
Mais jusqu'au début du XIVème siècle cette masse n'a pas de droits politiques et il est vraisemblable de penser, qu'à l'origine, elle n'a ni réclamé, ni désiré pareils droits. Cela se conçoit aisément: cette population d'artisans, de cultivateurs, d'ouvriers, de serviteurs, se compose d'éléments les plus divers. Descendants d'anciens serfs échappés du domaine, de laboureurs ou d'ouvriers immigrés, de marchands qui ne se sont pas enrichis, cette masse confuse, réunie sur le territoire libre de la commune liégeoise, ne demandait, sans doute, au début, que du travail et du pain. Aussi longtemps que, dans le cadre de l'économie mosane florissante, la conjoncture était telle qu'elle laissait à chacun la possibilité de faire fortune, la population urbaine ne chercha, sans doute, qu'à profiter de ces circonstances. Bien entendu, il n'y eut que peu d'élus pour beaucoup d'appelés, mais le succès qui couronna les efforts de quelques-uns, suffit pour provoquer d'inévitables distinctions d'ordre social, qui devinrent aussi, nous l'avons dit, des distinctions d'ordre politique.
Les « petits » trouvèrent naturel, tout d'abord, d'abandonner au patriciat urbain le soin d'administrer la cité. A la longue cependant, l'indigénat prolongé, l'augmentation de la population, les relations de fait qu'un genre de vie identique crée forcément entre les hommes, peut-être aussi une certaine stabilité économique, ont fini par rapprocher les « petits » les uns des autres et par leur donner la notion d'une évidente solidarité de classe.
Les bases idéologiques nécessaires à l'éclosion de cet esprit de classe ne pouvaient être fournies que par l'Eglise, qui était alors la seule organisation capable de donner aux masses un minimum de sens social. Un prêtre liégeois, soupçonné d'hétérodoxie, Lambert le Bègue, paraît avoir exercé, vers 1175, une certaine influence sur les milieux populaires de sa ville natale; dans un mémoire justificatif qu'il adressa au pape, il souligne le fait « qu'on lui reprochait non seulement son humble extraction, mais aussi le succès que ses prédications rencontraient auprès des tisserands et des pelletiers et non pas auprès des grands, comme si les activités manuelles, nécessaires aux besoins humains, étaient choses honteuses ». Nous ignorons, malheureusement, la portée exacte des discours, teintés sans doute de mysticisme et d'un communisme primitif, que Lambert le Bègue adressait au peuple des travailleurs. God. Kurth qui était, comme on sait, gagné tout entier aux doctrines de la démocratie chrétienne, n'a pas manqué de voir en lui un « Savonarole liégeois »; cela est peut-être excessif, mais il reste cependant que l'enseignement de ce prêtre a dû remuer dans les âmes frustes de ses auditeurs, ces éternelles aspirations à plus de justice et plus d'égalité sociale, qui sommeillent dans tous les coeurs des simples. De pareils types de prêtres ne sont d'ailleurs pas exceptionnels en ces siècles cent ans avant Lambert le Bègue, un de ses précurseurs avait provoqué lui aussi, une vive agitation parmi les tisserands de la cité de Cambrai, ce qui devait finalement le conduire au bûcher.
De cette propagande, menée, sans doute, par son auteur dans un but avant tout religieux, les masses populaires n'ont probablement retenu que l'aspect social. Elle devait forcément faire naître chez elles le souci d'une étroite solidarité, souci qui se traduisit par l'apparition de groupements de métiers ou corporations. Il est donc naturel de penser que ces associations professionnelles ont commencé par être des confréries religieuses; l'ambiance religieuse et cléricale de la Liège médiévale convenait d'ailleurs parfaitement à pareils organismes. Rien n'est plus caractéristique, à cet égard, qu'un document de juillet 1284, relatif aux boulangers de la cité, par lequel ceux-ci s'engagent à ne pas travailler certains jours de fêtes et à célébrer dignement les funérailles des collègues défunts.
L'organisation de ces confréries, en tant que groupements économiques, est-elle un produit de la libre initiative des artisans eux-mêmes ? Est-elle, au contraire, le résultat d'une politique de contrainte de la part du prince, des échevins ou des jurés? On ne sait; les deux hypothèses ne sont peut-être pas exclusives l'une de l'autre.
Les premières corporations n'apparaissent pas, à Liège, avant la fin du XIIIème siècle. Certes, on voit, dès le milieu du XIIIème siècle, le prince prendre des dispositions réglementaires qui visent, notamment, les artisans; en 1252 on détermine le rapport entre le poids et le prix du pain dans la cité et en 1257 est confirmé le règlement donné aux boulangers et aux meuniers de la ville par les maîtres, échevins et jurés. Mais tout cela ne postule pas l'existence de corporations C'est le 4 mai 1288 seulement qu'il est, pour la première fois, fait allusion à un métier, celui des tanneurs. Durant les dernières années du XIIIème siècle et au début du siècle suivant, d'autres groupements semblables s'organisent et apparaissent alors, peu à peu, en pleine lumière. Ils vont jouer désormais dans la cité un rôle politique et militaire de premier plan et sur lequel nous reviendrons fréquemment.
Un métier groupe, en principe, tous les individus s'adonnant à une même activité manuelle et marchande. Il est, généralement, administré par deux « gouverneurs » ou « maîtres » ou « jurés ». La création des corporations a théoriquement, en vue la réalisation de certains desiderata d'ordre économique et social, permettant d'aboutir à un accord de fait entre producteurs et consommateurs. Tout d'abord, le métier veille à ce que ses membres ne produisent ou ne vendent que des objets ou des denrées de bonne qualité. A cette fin, la capacité des travailleurs était surveillée et garantie par diverses mesures: apprentissage, obligation du chef-d'oeuvre, existence d'inspecteurs, serment des membres du métier. D'autre part, et afin d'assurer le gagne-pain de tous les travailleurs, la concurrence, la réclame, les monopoles, les accaparements étaient strictement interdits; étaient réglementées aussi, les heures de travail et la technique.
A la base de l'organisation corporative il y a aussi des principes de charité et de solidarité; les membres d'un même métier s'entraident en cas de maladie, de vieillesse, de décès. La solidarité de l'un vis-à-vis de l'autre et de tous à l'égard du groupe, se manifestait par le boycottage, la grève, l'exclusion et, au besoin, le recours à la force. Enfin, certaines corporations pratiquaient aussi la coopération, tout au moins en matière de production ou de vente; les bouchers et les drapiers avaient une halle; des moulins, des rames, des meules étaient possédés en commun par les tanneurs, brasseurs, drapiers, retondeurs, etc.
Le nombre des métiers ne s'est stabilisé à Liège que vers la fin du XIVème siècle. En 1298 ils étaient douze; en 1308, quinze; en 1331, vingt; vers 1380 enfin, leur effectif se montait à trente-deux et, sauf quelques changements momentanés, imposés à la suite des batailles d'Othée (1408) et de Brusthem (1468), ce chiffre resta immuable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
On classait les trente-deux « bons métiers » - entendez métiers privilégiés - suivant un ordre qui devint traditionnel, de la manière suivante: fèvres (artisans travaillant les métaux, sauf l'or et l'argent), charliers (charrons), cherwiers (laboureurs et maraîchers), meuniers, boulangers, vignerons, bouilleurs, pêcheurs, cuveliers-sclaideurs (fabricants de tonneaux et déchargeurs de vin), porteurs au sac, brasseurs, drapiers, retondeurs, entretailleurs de drap, scohiers (pelletiers), vieux-wariers (fripiers), naiveurs (bateliers), soyeurs (scieurs de long), mairniers (marchands de bois de construction), charpentiers, maçons, couvreurs, corduaniers (bottiers et marchands de chaussurres), corbesiers (cordonniers et savetiers), texheurs (telliers ou tisserands de toile), cureurs-toilier.s (marchands de toiles, lingères, blanchisseurs), harengiers-fruitiers (marchands de poissons et de fruits), mangons (bouchers), tanneurs, chandelons-floqueniers (marchands de chandelles et tapissiers), merciers et orfèvres-selliers.
Il y avait, entre tous ces métiers, d'assez importantes différences sociales, selon qu'ils étaient, d'après l'expression ancienne, « fondés sur labeur ou sur marchandise ». Certains, comme celui des merciers, par exemple, se composaient de marchands-patrons relativement aisés; d'autres, tel celui des bouilleurs, comprenaient des ouvriers dont le genre de vie ressemblait fort à celui des prolétaires d'aujourd'hui. Quelques métiers comptaient dans leur sein les représentants d'un nombre très élevé de spécialités artisanales; ainsi celui des merciers ou, encore, celui des fèvres, qui réunissait les maréchaux, forgerons, cloutiers, couteliers, serruriers, chaudronniers, potiers de cuivre et d'étain, fabricants et marchands de canon et d'armes à feu, fabricants et marchands d'épées, épingliers, fondeurs de cloches, horlogers, etc. Cette compétence étendue explique que, souvent, le métier était divisé en membres ou sections, groupés selon un critère de spécialisation ou de topographie.
La plus complète égalité ne régnait pas entre les métiers; certains, comme ceux des fèvres, des drapiers, des tanneurs, des orfèvres comprenaient des artisans qui, par leur fortune, l'emportaient de loin sur les membres d'autres corporations. La distinction en maîtres, compagnons et apprentis, n'était, au début, que d'ordre professionnels dès le XVème siècle elle devint, dans certains métiers, d'ordre social et les documents ne se font pas faute de distinguer « les pauvres et menus compagnons » des « riches dudit mestiers ».
Aux XIVème et XVème siècles, ces métiers eurent aussi un rôle militaire important et constituèrent l'essentiel des effectifs de l'armée communale liégeoise. Ils faisaient le service de surveillance intérieure dans la cité et devaient, en cas d'alerte, faire le guet sur les murailles; à chaque métier était confiée la garde d'une tour de l'enceinte.
Les corporations dont les réunions générales se tenaient, au XIVème siècle, au Palais, entreprirent, au siècle suivant, de se procurer chacune un local fixe et distinct; un grand nombre de ces maisons se dressaient autour du marché ou en Féronstrée.
De même que dans la plupart des autres villes, les corps de métiers liégeois étaient généralement localisés dans une même rue ou dans un même quartier; les fèvres établis d'abord, comme le nom l'indique, en Féronstrée (rue des Fèvres), s'installèrent ensuite dans la petite île ou Lulay (l'ileau ou l'ulay) et la rue Lulay des fèvres y conserve encore leur souvenir; les tanneurs étaient fixés Outre-Meuse (Quai et rue des Tanneurs); les drapiers avaient élu domicile dans les paroisses de Saint-Georges et de Saint-Jean-Baptiste, dans la rue Hors-Château et dans les ruelles entre Féronstrée et le Quai de la Batte (Impasse des Drapiers, rue sur les Foulons, etc.); les orfèvres habitaient en Gérardrie, les mineurs en Pierreuse et sur les hauteurs de Sainte-Marguerite. Cette localisation facilitait sans doute la surveillance dont les membres des métiers étaient l'objet, et rendait plus aisée aussi la mobilisation de leurs effectifs militaires en cas de besoin.
Parmi les corporations, celle des fèvres occupait le premier rang; ses statuts furent approuvés par le prince en 1331. D'autres associations importantes étaient celle des meuniers, qui datait de la fin du XIIIème siècle, celle des pelletiers, qui reçut un règlement en 1331, mais est probablement plus ancienne, celle des tanneurs dont l'existence est signalée en 1288, celle des houilleurs, qui comptait au milieu du XVème siècle au moins deux mille hommes et avait un caractère plus nettement prolétarien que la plupart des autres, celle enfin des drapiers qui groupait les ouvriers travaillant la laine et autorisés à vendre leurs étoffes dans leur halle en Féronstrée; il faut soigneusement distinguer ces ouvriers, des marchands de draps qui faisaient, pour, la plupart, partie du patriciat urbain, formaient sans doute une gilde, s'adonnaient au commerce au long cours et vendaient les draps étrangers ou la laine qu'ils importaient dans la cité, dans une autre halle aux draps, sise près du marché, sur l'emplacement de la rue Sainte-Ursule actuelle.
Telle était, dans ses grandes lignes, l'organisation des métiers et, partant, de la majeure partie de la population laïque de Liège, à partir de la fin du XIIIème siècle. Ces métiers, organismes exclusivement professionnels au début, vont acquérir, au XIVème siecle, une importance politique considérable du fait que leurs membres vont s'essayer à conquérir sur le patriciat, l'administration de la cité. Les luttes qu'ils mèneront à cette fin, dureront un siècle et se termineront par la victoire du populaire.
IV.
Les premiers conflits sociaux et le role de Henri de Dinant.
Henri de Dinant et Albert de Cuyck
sur la façade néogothique du palais de princes-Evêque
L'émancipation politique et sociale de la classe populaire n'allait pas, au début, être l'oeuvre de cette classe elle-même. Les conflits qui se produisirent à Liège, au XIIIème siècle, n'eurent pas, dans le principe, un caractère social; provoqués par des oppositions entre prince, clergé, échevinage et patriciat - les seules forces qui eussent alors une puissance effective - ils n'acquirent pour ainsi dire que par accident, un autre aspect: la masse populaire, puissance de fait dès cette époque, fut sollicitée, par l'un ou l'autre des adversaires en présence, de prendre part, en sa faveur, au conflit. Son intrusion dans les querelles qui agitaient la cité changea la nature même de celles-ci le problème social vint se greffer sur le problème politique.
C'est dans le sein du patriciat qu'apparurent les premières personnalités qui allaient faire participer la classe populaire à une activité civique.
Au-dessus des toits de chaume des pauvres masures des tisserands et foulons qui s'entassaient dans les misérables venelles comprises entre la rue Hors-Château et la Meuse, on voyait fièrement surgir, en Féronstrée, la belle demeure du riche Louis Surlet. Il appartenait à un lignage patricien qui s'était enrichi dans le commerce des draps et de la laine. Or, en juin 1208 le dit Surlet, se décida, s'il faut en croire Hemricourt, à faire construire, dans le voisinage de son hôtel, une halle où les tisserands auraient loisir d'étaler et de vendre leurs marchandises. Cette initiative provoqua une vive agitation chez les autres drapiers ou « halliers » liégeois, qui disposaient déjà, pour leurs opérations commerciales, d'une halle, sise, comme nous l'avons dit, près du marché.
On s'explique mal les raisons qui poussèrent Louis Surlet à susciter, en matière de vente de drap, une concurrence qui pouvait être dangereuse pour lui et les autres « halliers ». G. Kurth a cru, assez candidement, que notre personnage « paroissien de Saint Jean-Baptiste et vivant au milieu du petit peuple des tisserands et des foulons, s'intéressa à leur laborieuse existence et voulut faire quelque chose pour eux ». Cette vue, par trop ingénue, ne peut naturellement suffire comme « explication ». Il est probable que l'intervention intempestive de Louis Surlet a été provoquée par des dissentiments d'ordre économique et personnel au sein du monde des halliers. Il n'est pas interdit. de penser, qu'en agissant de la sorte, Surlet a voulu, en même temps, s'assurer des avantages commerciaux et conquérir une popularité de bon aloi parmi les masses laborieuses de son voisinage. Espérait-il, par là, intimider ses rivaux et concurrents? II semble bien que oui; le lignage de Saint-Servais ayant tenté d'empêcher, par la force, l'édification de la halle en Féronstrée, Louis Surlet accourt, fait crier publiquement aux charpentiers qu'ils ont à reprendre leur tâche sous peine d'amende et, une fois obéi, leur fait mettre à chacun une couronne de roses sur la tête, coutume qui paraît signifier qu'on honore les ouvriers d'un cadeau.
Cette historiette que rapporte, plus d'un siècle et demi après les événements, le chroniqueur Jacques de Hemricourt, est étrange et décevante. Décevante parce que l'amialiste en dit assez pour piquer notre curiosité et trop peu pour la satisfaire, étrange parce qu'elle est l'écho incontrôlable d'une tradition dans laquelle la légende le dispute à la réalité. Elle nous permet, cependant, d'affirmer deux choses d'abord, que, dès le début du XIIIème siècle il existait des oppositions de clans et de personnes dans le sein du patriciat, ensuite - corollaire de pareille situation - que certains patriciens tâchaient de flatter le peuple des artisans et de se l'attacher. Il y a là un fait propre à tout régime oligarchique qui, comme on sait, verse aisément dans la démagogie.
Mais, d'être ainsi sollicité, le peuple n'allait-il finir, un jour, par réclamer, à son tour, des réformes et une participation au pouvoir? On ne peut que le supposer, avec vraisemblance d'ailleurs. Comment expliquer autrement une concession que lui fit, en 1250, le patriciat? Au mois de novembre de cette année, les échevins, maîtres et jurés de la cité s'engagèrent « eu égard aux clameurs des pauvres gens du commun » à ne plus allouer de subsides à ceux des patriciens qui se feraient armer chevalier. Voilà qui montre éloquemment combien l'alliance était déjà intime entre nobles et bourgeois des lignages et combien aussi les finances communales étaient au service des intérêts de classe du patriciat. Si celui-ci paraît renoncer « volontairement » à cet abus, n'est-ce pas parce que le mécontentement croissant des « pauvres gens du commun » l'y a forcé?
La question financière prenait d'ailleurs une ampleur de plus en plus considérable au fur et à mesure du développement de la cité. Pour se, procurer les ressources nécessaires l'échevinage avait été amené à lever des impôts indirects sur les objets de consommation les plus courants. Ces taxes portèrent le nom de fermeté, parce que, lorsqu'elles furent levées pour la première fois, en 1198, elles servirent à financer l'édification de la nouvelle enceinte urbaine (firmitas = fermeté, fortification). Par la suite, ce nom caractéristique resta attaché à de pareils impôts, même si leur produit devait avoir une destination autre que l'entretien de la muraille de la cité.
Cet impôt frappait tous les habitants de Liège et les échevins entendaient bien y soumettre également le clergé. Or, celui-ci, fort de ses immunités, refusait souvent de s'acquitter; les clercs et leurs serviteurs étaient, comme on sait, soustraits à la juridiction scabinale et leurs maisons, cloîtres et autres propriétés jouissaient du même privilège. C'était là une source d'éternels conflits, de sorte que le clergé fut mêlé, par ce fait même, aux luttes politiques et sociales de la cité.
D'autre part, au milieu du XIIIème siècle régnait à Liège un prince, l'élu Henri III de Gueldre (1247-1274) qui fut, non seulement, comme l'a dit, un peu théâtralement, God. Kurth « un fléau pour le pays et un opprobre pour l'Eglise », mais qui a également tenté d'accroître son autorité princière au détriment de la liberté communale.
A l'encontre de ce qu'on observe dans les villes des autres principautés belges les luttes sociales dont Liège va être le théâtre ont donc mis aux prises, non seulement les éléments laïques de la cité, mais aussi le monde clérical. C'était là une conséquence de la constitution même de l'Etat liégeois.
Deux événements, en apparence assez anodins, qui se produisirent dans le courant de l'année 1253, furent à l'origine d'un conflit qui opposa d'abord le clergé aux échevins, puis le peuple au patriciat et provoqua finalement l'entrée en scène du tribun dont le nom est encore populaire de nos jours à Liège, Henri de Dînant.
Un serviteur d'un chanoine de la collégiale Sainte-Croix ayant eu maille à partir avec un bourgeois de la cité, une rixe s'ensuivit; le bourgeois fut blessé; le domestique du chanoine se réfugia dans une église pour échapper aux poursuites. Mais les échevins, violant le droit d'asile, font saisir le délinquant. Le clergé proteste hautement et lance l'excommunication contre les échevins. Comme ceux-ci refusent de s'incliner, le roi des Romains Guillaume de Hollande, intervient, ordonne une enquête et casse les décisions scabinales.
Nous sommes en 1253, à ce moment de l'histoire de l'Empire connu sous le nom de « Grand Interrègne ». L'Empire germanique est en pleine anarchie et l'autorité centrale en pleine décadence. Le prince que les électeurs élisent comme roi, mais que le pape ne couronne plus comme empereur, est sans pouvoir contre la force des seigneurs et la puissance des villes libres. Le comte Guillaume de Hollande qui a été choisi comme roi en raison même de sa faiblesse, n'est que souverain à titre nominal. L'incident de Liège le prouve surabondamment; le temps des Ottons ou d'un Henri IV était loin! La cité mosane et ses échevins n'accordent visiblement guère d'attention au roi fantôme qui, de Maestricht où il réside provisoirement, les menace de ses foudres de carton. La désaffection à l'égard de l'empire germanique, si craint et respecté encore au siècle précédent, est patente. Il est significatif d'observer que Liège n'a pas, comme tant d'autres villes d'Empire, profité de l'anarchie du grand interrègne, pour s'ériger en ville libre impériale. Visiblement les liens si étroits qui, depuis Notger, l'attachaient au César d'Outre-Rhin sont rompus; tout en veillant à son autonomie, l'Etat liégeois porte, désormais, ses regards vers l'ouest; il va s'intégrer plus étroitement dans la vie politique des principautés des Pays-Bas et il commence aussi, à subir l'attraction et le rayonnement de la France capétienne.
L'intervention du roi n'émut donc guère les échevins, qui se refusèrent à obtempérer ses ordres. Entre eux et le clergé le conflit était ouvert.
Un second incident vint déchaîner la lutte entre les « grands » et les « petits ». Le maïeur du village d'Awans étant venu à Liège, rencontra au marché un de ses ennemis et le tua, puis, nullement inquiété, quitta la ville. Ce meurtre, perpétré pour ainsi dire aux yeux de tous, provoqua une indignation générale parmi le peuple liégeois et lui fournit l'occasion de protester contre le régime de droit pénal alors en vigueur dans la cité. La procédure inquisitoriale n'était pas encore reçue à cette époque et un inculpé pouvait toujours, devant le juge, se justifier par serment, même s'il portait, comme le dit un chroniqueur, « la tête de celui qu'il avait assassiné sous son manteau ».
L'élu Henri de Gueldre, crut devoir profiter de cette circonstance: il convoqua toute la population dans la cour de son palais et s'engagea, en vertu de son pouvoir princier, à réformer l'administration, de la justice afin que désormais « le pauvre et le riche pussent vivre sur un pied d'égalité à l'intérieur de la cité ».
Cette attitude du prince, généreuse en apparence, a, en fait, quelque chose de démagogique. Henri de Gueldre voulait visiblement flatter la masse populaire et l'exciter contre la juridiction des échevins, c'est-à-dire contre le patriciat dont la puissance n'était pas sans lui porter ombrage. Sous couvert de procéder à une réforme justifiée, il veut, profitant de l'émotion qui règne parmi les classes laborieuses, briser l'autorité du patriciat et supprimer les libertés communales pour instaurer un régime de gouvernement personnel, c'est-à-dire arbitraire.
Le peuple, crédule et enthousiaste, était sur le point de souscrire aux propositions du prince lorsqu'un incident fâcheux vint jeter le trouble dans l'assemblée. Un des prêtres présents ayant frappé un homme du peuple, celui-ci court rassembler ses amis; leur intervention provoque le tumulte et bientôt l'émeute gronde autour du palais. L'élu, surpris, est obligé de s'enfuir avec les chanoines; l'excommunication est lancée contre la ville.
Quelques semaines s'écoulent alors, remplies de négociations et d'événements dont le détail nous échappe; finalement un accord est conclu entre l'échevinage et le prince; celui-ci revint à Liège, le 18 novembre 1253.
Ces deux incidents ne méritent de retenir notre attention que parce qu'ils se placent immédiatement avant l'arrivée au pouvoir de Henri de Dinant. On peut donc légitimement se demander s'ils n'ont pas influé sur l'attitude du tribun et s'ils ne sont pas la cause occasionnelle de son intervention. C'est, qu'en, effet, il est fort difficile de donner de celle-ci une explication satisfaisante. Henri de Dinant ne joua - aux dires de nos sources - aucun rôle à l'occasion des deux conflits que nous venons d'évoquer. Son entrée en scène ne se produisit qu'après la conclusion de l'accord du 18 novembre; elle débute par une réforme importante dans le mode de recrutement du magistrat liégeois.
On se souvient qu'à côté de l'échevinage existait aussi à Liège, depuis 1176-1184, un conseil de jurés, présidé par deux maîtres; ces derniers: étaient nommés par les échevins. Or, après les troubles qui marquèrent l'année 1253, le populaire obtint que la désignation des deux maîtres se fît dorénavant, non plus par les échevins, mais par la voie du suffrage universel. En outre, ces deux maîtres seraient désormais tenus de prêter serment au peuple et les échevins durent, par serment également, marquer leur adhésion à ces réformes. Leur réalisation fut l'oeuvre de Henri de Dinant.
Singulière et mystérieuse personnalité que celle de cet agitateur, le premier de cette longue série de tribuns communaux qui, du XIIIème au XVIIIème siècle, jalonnent l'histoire de toutes nos principautés et concrétisent l'amour de nos ancêtres pour l'autonomie urbaine et la liberté civile.
On a cru, durant longtemps, que Henri de Dinant était sorti des rangs du peuple; en réalité il appartenait au patriciat liégeois et vraisemblablement au monde des « halliers » et changeurs. Son nom n'apparaît pour la première fois - dans une charte encore inédite - qu'en octobre 1248 et c'est en mars 1256 qu'il achève sa carrière d'homme politique. Nous ignorons presque tout de ses antécédents, de sa famille, de ses opinions, de son programme. Des chroniqueurs qui rapportent ses faits et gestes, aucun n'est son contemporain; postérieurs d'un siècle à l'époque où vivait Henri de Dinant ils ont probablement jugé l'homme et sa politique avec la mentalité de leur temps et altéré inconsciemment, dans une certaine mesure, sa véritable personnalité. Il entre donc beaucoup d'incertitude, et une large part d'hypothèse dans l'histoire de Henri de Dinant, telle que nous essayerons de la rapporter ici.
Que la famille du tribun ait fait partie du patriciat est chose certaine; mais il est probable que si elle était riche, elle n'appartenait cependant pas à ces lignages qui détenaient alors tous les pouvoirs politiques dans la cité. Il y avait, nous l'avons déjà indiqué, bien des nuances sociales dans le sein de ce patriciat; il est impossible qu'on y ait mis sur le même pied les descendants des vieilles familles et les enrichis qui, grâce à leur fortune, forçaient l'entrée du patriciat. Les premiers monopolisaient les sièges des collèges des échevins et des jurés; aux autres il n'était guère possible, sauf exception, de jouer un rôle politique actif, avant qu'une ou deux générations n'aient fait oublier leur condition de parvenu. Bien des membres de ce patriciat d'argent devaient jalouser le patriciat de naissance et rêver de lui faire pièce sur le plan politique. Tel devait être le cas de Henri de Dinant.
Il comprit que les conflits entre l'échevinage, le clergé et le prince pourraient lui fournir l'occasion de jouer son propre jeu s'il parvenait à s'attacher le peuple. II mit donc tout en oeuvre - intelligence, éloquence, argent - pour se rendre populaire. Le chroniqueur jean de Hocsem l'appelle démagogue et guide du peuple (ductor populi); Jean de Warnant le dénomme l'idole des masses et quant à Jean d'Outremeuse, l'annaliste-romancier dont on ne peut toujours retenir les renseignements, fruits d'une imagination trop ardente, il me paraît avoir, en l'espèce, décrit assez exactement notre héros, qui, dit-il, « faisoit le peuple esleveir contre le sangnour et contre les clers et ilh estoit bien creus... ilh estoit un hons de grant nation, saiges et malitieux; mais ilh fut tant faux et trahitre et convoiteux, qu'ilh ne valoit riens por son envie qu'ilh avoit sour cascun. »
La politique de Henri de Dinant fut donc avant tout dirigée contre l'échevinage et contre le prince; la « révolution » qu'il voulait faire était d'ordre plus politique que sociales. Il est faux de voir en lui un démocrate; il s'est servi du peuple pour combattre l'oligarchie politique d'une partie du patriciat, mais il ne paraît pas avoir visé à la réalisation de réformes sociales. C'était, en tout état de cause, un forte personnalité, un tribun éloquent, un chef aimé du peuple, sans doute aussi un ambitieux, désireux de jouer un rôle dans la vie publique liégeoise. « Hons presumptueux et mult subtilh » déclare Jean d'Outremeuse qui, visiblement, le juge sans indulgence et, peut-être, trop sévèrement.
Comment parvint-il, au lendemain même de l'accord du 18 novembre 1253, à imposer un changement dans le mode d'élection des maîtres? Probablement par le recours à la force populaire; les échevins ayant tenté de s'opposer à la réalisation de la réforme de la maîtrise, Henri de Dinant procède à l'organisation militaire du peuple; par ses soins les habitants de la cité furent répartis en escouades de vingt hommes et chaque escouade fut placée sous le commandement d'un vingtenier. Grâce à cette force armée, le peuple obligea les échevins à s'incliner et à accepter le principe de l'élection des maîtres au suffrage universel; Henri de Dinant fut élevé à la maîtrise dans les dernières semaines de l'année 1253.
Désormais il pouvait agir. Il allait le faire aussitôt. En décembre 1253, Jean d'Avesnes, issu du premier mariage de la comtesse Marguerite de Flandre-Hainaut, vint solliciter l'aide de l'élu de Liège contre sa mère. Henri de Gueldre accueillit sa demande et s'adressa à l'échevinage le priant de mobiliser les milices communales liégeoises. Mais, contre toute attente, Henri de Dinant intervint et s'opposa au départ des troupes, prétendant que celles-ci ne devaient pas défendre une cause étrangère, mais qu'elles n'avaient d'autre obligation que de combattre pour la patrie liégeoise, pour le maintien des droits de l'élu et de l'église de Saint-Lambert. Furieux de cette opposition, l'élu quitta la cité; le roi des Romains eut beau proclamer, par un édit du 8 janvier 1254, qu'en l'occurrence, le service militaire était dû, les Liégeois refusèrent de suivre cet avis et cet ordre et restèrent fidèles au point de vue défendu par le maître de la cité.
Pour pouvoir continuer sa politique de résistance au prince et à l'échevinage il fallait à Henri de Dinant des ressources financières. Il n'hésita donc pas à proposer la levée d'une fermeté ou taxe sur les objets de consommation. Or, cet impôt indirect frappait, de par sa nature même, toutes les classes sociales et notamment le clergé qui prétendait pouvoir s'y soustraire. D'autre part, en vertu d'un accord signé en juillet 1249, Henri de Gueldre avait promis que la fermeté ne serait désormais plus levée que pour une durée de deux ans et que, par la suite on ne procéderait plus à la perception de pareille taxe. Or, l'intervention de Henri de Dinant remettait tout le problème en question; elle lui attira aussitôt l'hostilité du clergé.
Les négociations menées au sujet de cet impôt se déroulèrent dans une atmosphère tumultueuse; un jour que chanoines, bourgeois et échevins étaient réunis pour délibérer à ce propos, l'un de ces derniers se prit de querelle avec Henri de Dinant et le menaça de son couteau. Aussitôt le bruit courut parmi le peuple que son idole venait d'être tuée; il s'ensuivit une émeute. Le prince lança l'excommunication contre la cité et ordonna aux chanoines de se retirer à Namur; les échevins s'exilèrent à leur tour.
Ainsi donc quelques mois à peine après l'accession au pouvoir de Henri de Dinant, une situation révolutionnaire était créée dans la ville; le nouveau maître n'avait pas craint de couper tous les ponts: aux masses populaires qu'il conduisait s'opposait maintenant le bloc formé par l'alliance du prince, de l'échevinage et du clergé. Dans le sein de ce dernier il se trouva cependant quelques dignitaires au chapitre de Saint-Lambert qui jugèrent bon de ne pas lier leur sort à celui du prince et des échevins. Le clergé, en tant que tel, et fort, par ailleurs, de l'appui du pape, n'avait rien à craindre du tribun; il ne pouvait oublier, d'autre part, que l'élu et le corps scabinal avaient, à diverses reprises, tente dans le passé de porter la main sur ses privilèges; il était donc, à ses yeux, souhaitable qu'il y eût, dans la cité, un pouvoir susceptible de contrebalancer leur influence. Une partie du clergé ne vit donc pas sans déplaisir l'autorité croissante de Henri de Dinant. L'alliance qu'au début du siècle suivant le clergé conclura avec le peuple, s'ébauche déjà.
Ce nouvel incident fut le signal de la guerre civile; elle désola la principauté de mai à décembre1254. Henri de Dinant révéla aussitôt ses capacités d'homme politique. Comme le fera un siècle plus tard en Flandre Jacques Van Artevelde, il s'adressa aux villes de la principauté et obtint l'aide de Huy et de Saint-Trond. La communauté des intérêts urbains s'affirme ici pleinement et dans cette entente réalisée par Henri on peut voir à la fois, l'affirmation très nette d'un sentiment de classe et une manifestation de patriotisme liégeois.
Les Liégeois qui prirent, en cette occasion, une large part aux escarmouches, aux sièges et aux pillages qui marquèrent cette guerre, ne paraissent pas encore avoir été organisés, à cette époque, en corporations de métiers; mais il est probable que les luttes soutenues en commun contre le prince favorisèrent le développement d'un sentiment de solidarité chez le peuple de Liège et contribuèrent à mûrir sa capacité politique et civique.
A l'intervention du légat du pape, un accord fut conclu entre les belligérants le 11 décembre 1254; mais ce n'était là qu'une trêve. Henri de Dinant garda la maîtrise et ne renonça pas à la lutte. Celle-ci reprit au printemps de l'année 1255; l'occasion en fut, à nouveau, d'ordre fiscal. Afin de pouvoir payer au prince l'amende que stipulait la paix du 11 décembre, Henri proposa de lever sur les citoyens les plus riches un impôt d'un marc. Les échevins 's'indignèrent, refusèrent d'accepter cette taxe et quittèrent la cité avec bon nombre de leurs amis, membres du patriciat. La mesure prise par Henri de Dinant montre bien que celui-ci avait accentué le caractère démocratique de sa politique. Sans doute n'avait-il pas, au début, envisagé la lutte en fonction des intérêts exclusifs du peuple puisque aussi bien, patricien lui-même, il ne combattait d'abord que l'échevinage et une fraction du patriciat; mais, poussé par la plèbe sur laquelle il s'appuyait, prisonnier, peut-être, de certaines promesses, il en vint, assez vite, à une attitude plus radicale.
Déjà c'est une véritable guerre de classes qui sévit à Liège. Le tribun renoue son alliance avec Huy et Saint-Trond et fait également entrer Dinant dans la confédération des villes. Quant à Henri de Gueldre, il lance l'interdit sur la cité et forme contre elle une ligue féodale: le duc de Brabant, les comtes de Looz, de Gueldre et de Juliers se joignent à lui. Les chevaliers et leurs sergents ravagèrent les campagnes, harcelèrent les troupes des communes, interceptèrent les communications entre les villes et empêchèrent leur ravitaillement. L'élu avait une incontestable supériorité militaire; il força bientôt les villes, alliées des Liégeois, à abandonner la lutte et, sans s'attaquer directement à Liège, que ses remparts protégeaient efficacement, commença le blocus de la cité. Bientôt les vivres manquèrent et la disette affaiblit les défenseurs.
Leur courage n'en fut cependant pas affecté. Une mentalité révolutionnaire et obsidionale s'était emparée de la plèbe; sa rage se tournait surtout contre les patriciens « émigrés » qui guerroyaient dans les rangs de l'armée du prince. Jusqu'à quel point Henri de Dinant tenait-il encore en main les masses turbulentes qu'il avait appelées au combat? Exaspérées et énervées celles-ci se livrèrent à de regrettables excès dans la ville et détruisirent de fond en comble les maisons des patriciens Jacques et Maurice de Saint-Martin; les poutres et les pierres provenant de cette démolition servirent à la construction d'une nouvelle habitation pour Henri de Dinant. Le tribun se rendait ainsi coupable ou, tout au moins, complice, du crime de « bris de maison » que le droit de l'époque punissait très sévèrement et dont la répression était de la compétence exclusive du prince. Celui-ci se hâta de profiter de la circonstance; il vint dresser son camp à Vottem et, après avoir décidé que, par une fiction juridique, le tribunal des échevins pouvait aussi valablement siéger en cet endroit qu'à Liège même, il fit condamner Henri de Dinant comme « briseur de maison ».
Cette sentence fit du tribun un hors la loi et lia plus étroitement encore son sort à celui de la masse populaire, car les amis patriciens qu'il avait conservés jusqu'alors l'abandonnèrent en cette circonstance. La guerre prenait ainsi un caractère nettement social; dans l'un des camps la plèbe urbaine composée en majeure partie d'artisans, dans l'autre, le prince, le patriciat, les possédants et généralement toutes les forces de conservation sociale. On ne peut que souscrire à l'appréciation de Kurth lorsqu'il avance que « sur la fin de sa carrière, Henri se trouva être le chef de la démocratie liégeoise, mais il le fut par la défection de ses anciens partisans qui ne lui laissa que la plèbe pour toute armée ».
L'issue de la lutte n'était, dès lors, plus douteuse: à la fin de l'été de 1255 la famine régnait à Liège et malgré les discours de Henri de Dinant qui, visiblement, n'avait plus la direction des masses, celles-ci réclamaient la capitulation. La paix de Bierset, signée en octobre 1255, mit fin à la guerre: la cité se rendait à merci. Une des portes de l'enceinte - la porte Sainte-Walburge - dut être livrée au prince qui y installa une garnison, chargée de surveiller la ville; toutes les réformes introduites durant le régime de Henri de Dinant - vingtaines, alliance avec les villes liégeoises, élection des maîtres au suffrage universel - furent abolies; des otages furent livrés et une forte amende fut imposée à la cité. Des sanctions furent prises contre les membres du clergé qui s'étaient montrés favorables à la cause populaire et qui n'avaient pas quitté Liège durant la guerre contre le prince. Enfin Henri de Dinant dut s'exiler.
Il est très significatif de constater qu'une fraction du clergé n'avait pas suivi le parti du prince; après la victoire de celui-ci, c'est d'ailleurs ce même clergé qui allait, très rapidement, relever la tête et s'opposer aux mesures arbitraires de l'élu. Afin de payer l'amende infligée à la ville par la paix de Bierset, il fallut recourir à l'impôt; une fermeté fut, à nouveau établie. Mais aussitôt le clergé s'insurgea comme il avait coutume de le faire depuis bien longtemps, chaque fois que ses privilèges fiscaux étaient menacés; le prince dut s'incliner et le 26 février 1256 il faisait défendre la levée de la fermeté qui fut remplacée par un impôt calculé au prorata de la fortune d'un chacun. Cette nouvelle mesure mécontenta la bourgeoisie marchande et quelques partisans de Henri de Dinant jugèrent que le moment était opportun pour faire revenir l'ancien maître dans la cité. Celui-ci accourut aussitôt; le 17 mars 1256 il entrait à Liège, tandis que les échevins et les patriciens se réfugiaient Outre-Meuse. Accompagné d'une foule en armes, le tribun se rendit au marché, mais quelques chanoines de la cathédrale, députés auprès de lui, lui firent voir le caractère désespéré de sa tentative, puisque l'élu seul disposait de la force dans la ville. Henri se rendit à cet avis et dès le lendemain il quitta Liège pour se réfugier à Namur. Après y avoir été l'objet, en avril 1256, d'un attentat qui manqua de réussir, il se retira à Valenciennes où il vécut à la cour de la comtesse Marguerite. Celle-ci ne pouvait oublier que le tribun s'était jadis opposé à ce que des troupes liégeoises prêtassent leur appui à ses ennemis. L'histoire perd, dès lors, toute trace de Henri de Dinant; en 1269 il était décédé et le 10 février de cette année, son fils, Gérard, vivait, sans être inquiété, à Liège.
Des jugements fort divergents ont été portés sur le rôle et la personnalité de Henri de Dinant. Les deux historiens qui, en dernier lieu, ont étudié cette curieuse figure de l'histoire liégeoise, God. Kurth et H. Pirenne, ne s'accordent que sur un seul point: celui de l'origine patricienne du tribun. Pirenne a pensé qu'il poursuivait une politique véritablement démocratique et qu'il a voulu instaurer un ordre nouveau de choses dans la cité en bréant un gouvernement populaire libéré de toute attache avec le patriciat. Le fait que Henri de Dinant était lui-même issu de ce patriciat ne prouverait rien contre cette thèse, car Pirenne, qui voit dans les de Dinant d'importants capitalistes, se demande « si le mouvement démocratique dont Henri a été le chef n'a pas été secondé par une partie au moins de la haute bourgeoisie pour des motifs tout autres que la sincérité des convictions. Ce ne serait pas la première fois », conclut l'éminent historien, « que le capitalisme aurait joué son rôle dans une agitation populaire ».
A ce point de vue, que les documents ne viennent toutefois nullement étayer, s'oppose celui de Kurth qui considère que la tentative de Henri de Dinant n'est pas de nature démocratique, mais qu'elle est dirigée uniquement contre le corps des échevins. C'est également à cette opinion que se rallie M. Eug. Polain. Si Henri a passé pour un démocrate c'est parce que le chroniqueur Jean de Hocsem l'a dit; or Jean de Hocsem écrivait entre 1334 et 1348, à une époque où les luttes sociales battaient leur plein à Liège et où les masses poursuivaient la réalisation d'un programme nettement démocratique. Hocsem a pu, de bonne foi, croire qu'une personnalité qui, de 1253 et 1256, fut à la tête du peuple liégeois dans sa lutte contre l'échevinage et le prince, était, tout comme les agitateurs qu'il avait lui-même sous les yeux, un partisan résolu de la démocratie urbaine.
Cette opinion de Kurth et de M. E. Polain est la plus conforme, dans ses grandes lignes, à la vérité historique, mais elle a besoin d'être nuancée sur plusieurs points; elle ne tient pas compte d'une évolution qui s'est produite dans la politique de Henri de Dinant et qui explique que, ayant commencé par mener la lutte contre l'échevinage, il a finalement, peut-être sans l'avoir désiré, combattu exclusivement pour le triomphe de la démocratie. Qu'on nous permette de résumer ici comment nous nous représentons la carrière de Henri de Dinant.
C'était un riche bourgeois, membre du patriciat, mais non pas des anciens lignages qui détenaient le pouvoir politique à Liège. Intelligent, ambitieux et éloquent, il a désiré jouer un rôle personnel dans la conduite des affaires urbaines, voulu affranchir la bourgeoisie de l'autorité princière et briser, à cette fin, l'oligarchie des échevins. Il paraît aussi avoir tenté la réalisation d'une alliance étroite entre les principales villes liégeoises afin d'opposer à la politique du prince, une politique des bourgeoisies. Pour mener ses projets à bonne fin, il a attiré à lui les masses populaires qui étaient encore exclues de toute participation au pouvoir politique mais qui étaient déjà mûres pour une pareille participation. Il a donc discerné et utilisé un mouvement profond qui cherchait son chef. Son intervention a précipité la lutte entre le peuple et une partie du patriciat qu'appuyait le prince, cependant qu'une fraction du clergé gardait la neutralité. Mais, prisonnier de ceux auxquels il devait son élévation, acculé, petit à petit, à une attitude de plus en plus violente et révolutionnaire, il fut abandonné par les éléments du patriciat qui l'avaient suivi au début et que son radicalisme avait fini par effrayer. De politique qu'il était d'abord son mouvement est devenu social; durant les derniers mois de son administration Henri de Dinant ne peut plus compter que sur l'aide du populaire et, dès lors, il passe pour un démocrate, voire même, comme le dit Hocsem, pour un démagogue. C'est cela qui explique l'importance et la force de la coalition qui se forme contre lui et qui groupe le prince, la noblesse et le patriciat. Il n'aura pas été difficile à ses vainqueurs de transmettre à la postérité une image déformée du tribun et de le faire passer pour un vulgaire agitateur, inspirateur d'une politique démagogique. La lecture des chroniqueurs liégeois du XIVème siècle montre le succès que cette version a rencontré et qu'elle connaîtra d'ailleurs jusqu'au XIXème siècle.
Le programme initial de Henri de Dinant qui consistait, essentiellement, dans l'affranchissement des bourgeoisies urbaines à l'égard du prince et de l'échevinage, n'a rien de démocratique en soi. Sa réalisation a été rendue impossible parce que le tribun a été entraîné vers des buts qu'il ne se proposait pas et qu'il eût sans doute condamnés lui-même, avant que d'accéder au pouvoir. Si, en dernière analyse, on doit constater qu'il a échoué dans son dessein, il n'en reste pas moins une personnalité importante de l'histoire liégeoise, parce qu'en provoquant l'intervention active du peuple en matière politique, il a préparé et rendu possible, ultérieurement, l'avènement de la démocratie dans la cité.
V.
L'avènement du parti populaire.
La défaite de Henri de Dinant allait, pour un assez long temps, mettre fin à toute agitation populaire. Le régime patricien est solidement implanté à Liège durant la deuxième moitié du XIIlème siècle et la meilleure entente paraît avoir régné entre les lignages scabinaux et le conseil des jurés, recruté parmi les marchands les plus notoires de la cité. Contre les forces plébéiennes, que l'intervention de Henri de Dinant avait libérées, tous les possédants avaient fini par faire bloc; l'union se maintint entre eux par crainte d'un nouveau soulèvement populaire.
Seule l'éternelle question de la fermeté ne cesse d'agiter, voire même de troubler la cité. On sait que c'est surtout le clergé qui s'opposait à la perception de cet impôt; ses membres n'allaient-ils pas jusqu'à prétendre « qu'on les égorgeait comme des moutons » parce qu'échevins et jurés s'accordaient à vouloir levers cette taxe sur tous les habitants? Pour se défendre contre pareille prétention, le clergé n'hésita pas à faire appel au peuple. A tort ou à raison, il accuse ceux qui gèrent les finances communales d'abus de toute espèce et la classe populaire n'accueille que trop facilement de telles imputations, d'autant plus que la ville était grevée de lourdes dettes. En 1285 l'alliance se conclut; elle est fondée sur un désir commun de résistance à l'impôt que le peuple appelait la maltôte. Or, si l'on songe que c'est en 1288 que les documents nous signalent, pour la première fois, l'existence d'une corporation de métier, on sera sans doute tenté de croire que c'est à l'occasion de la discussion des problèmes fiscaux et à l'instigation du clergé que les artisans liégeois ont, dans le sein des associations professionnelles, abordé les questions politiques et sociales. Ce fait aura certainement contribué à donner à ces groupements d'ouvriers une orientation nouvelle et à en faire, après quelques lustres, des associations politiques.
L'opposition des artisans, conjuguée avec celle du clergé, obligea les jurés à traiter. Le 7 août 1287 le chapitre et la cité signèrent la paix des Clercs, qui mettait fin à la querelle relative à l'impôt sur les objets de consommation; celui-ci était abrogé et remplacé, pour une durée de dix-huit ans, par une taxe sur la bière, destinée à l'entretien des ponts, chaussées et murs de la ville. Cette paix se compléta par une réforme du droit criminel, consignée dans un document promulgué le 9 octobre de la même année et appelée la « loi muée des bourgeois ». Ses stipulations juridiques ne nous intéressent pas ici, mais au point de vue social il importe de signaler que cette loi tendait à substituer à l'arbitraire d'une législation périmée, un régime d'équilibre entre les divers groupes sociaux de la ville, de telle manière « que le pauvre pût demeurer delez (= à côté de) le riche et le riche delez le pauvre ».
A partir de l'extrême fin du XIIIème siècle on observe que, à côté des problèmes politiques, les questions sociales vont, peu à peu, se poser dans toute leur ampleur. Bien que la documentation dont nous dispsons soit pauvre, fragmentaire et unilatérale, on devine qu'à ce moment une notable partie de la population est travaillée par un intense désir de réformes. Toute une nouvelle couche de citadins aspire à manifester une activité politique trop longtemps comprimée par l'oligarchie patricienne. Celle-ci est d'ailleurs affaiblie parce qu'elle est en proie à de violentes dissensions. En 1297, en effet, avait commencé, entre deux familles nobles de la Hesbave, la guerre dite des Awans et des Waroux. Or, nombre de patriciens s'étaient, dans le cours du XIIIe siècle alliés à des lignages nobles et, d'autre part, certains membres de ces derniers avaient acquis des droits de bourgeoisie dans la cité, à titre d'afforains. La majeure partie du patriciat urbain fut donc entraînée dans cette désastreuse guerre privée, très représentative des moeurs féodales. Dans ce milieu féodal la solidarité de la parentèle ainsi que la notion de la vendetta ou vengeance privée étaient restées très vives. Toutes les familles intéressées au conflit firent appel à leurs parents, à leurs amis, à leurs vassaux et beaucoup de patriciens liégeois donnèrent suite à ces demandes, en raison même des liens personnels ou réels qui les unissaient à des familles nobles des campagnes voisines. La distinction que nous sommes trop aisément tentés de faire aujourd'hui entre patriciat urbain et noblesse rurale, n'avait pas au moyen âge, à Liège, ce caractère rigoureux et tranché qu'on pourrait imaginer.
Chez quelques bourgeois cependant la notion de l'appartenance à un milieu marchand et urbain, l'emporte sur les obligations nées des alliances, contractées avec la noblesse campagnarde et militaire. Rien de plus caractéristique à cet égard que l'attitude prise par le patricien Gérard Surlet, beau-frère du châtelain de Waremme Guillaume II; pour avoir voulu se tenir à l'écart de la guerre il s'attira de Guillaume l'apostrophe suivante « Messires Gerart, chevaliers, seroges, (= beau-frère) je pris vostre sereur, qui chi est, en mariage por estre conforteis (= aidé), en la citeit de Liege et dehors, de vos et de vos amis. » De même, le prudent marchand de vin Thomas de Hemricourt refuse de participer à la lutte parce « que c'estoit uns marchans et qu'il pooit tres mal laissier sa chevanche (= ses affaires) por entreir en ces werre. »
Mais ce n'étaient là qu'exceptions; la majorité du patriciat entra en campagne ou prit parti. Les conséquences de ce fait furent, indirectement, favorables au populaire parce que ces démêlés entre Awans et Waroux furent extrêmement sanglants; ils affaiblirent numériquement le patriciat et causèrent le trépas d'une foule de chevaliers, diminuant ainsi la puissance de l'armée du prince où dominait la cavalerie et augmentant la supériorité des milices urbaines, composées essentiellement de fantassins. Jacques de Hemricourt qui a laissé de ces guerres incessantes une image vivante, sinon toujours objective, conclut son exposé par cette constatation « que toute honneur de chevalerie et de gens d'armes est déclinée et li forche des frankes villes ensachée et augmentée ».
Mais une cause d'ordre économique allait, à son tour, contribuer à envenimer les luttes sociales dans la cité. Dans toute l'Europe Occidentale l'ampleur des transactions commerciales avait pris un essor prodigieux dans le cours du XIIIème siècle; les payements à effectuer de ce chef devenaient donc de plus en plus importants. La société médiévale qui vivait, depuis cinq siècles, sous le régime du monométallisme-argent de fait, dut, sous l'empire de cette cause, créer des signes monétaires nouveaux, qui, sous un volume réduit présentaient une valeur considérable. De là, le recours à la frappe de l'or vers le milieu du XIIIème siècle; des payements stipulés en or sont déjà signalés à Liège en 1242 ou 1243. Le développement du luxe ainsi que l'accroissement des charges administratives et militaires obligaient maintenant les princes à disposer d'un important stock monétaire. Pour faire face à ces nécessités le prince-évêque de Liège, Hugues de Châlons, eut recours, vers 1297, à des mesures d'inflation, que tous les souverains - à commencer par le roi de France Philippe le Bel - ont pratiquées à cette époque et que l'on a souvent considérées, à tort d'ailleurs, comme des opérations de faux monnayage. Il fit frapper des monnaies qui, tout en conservant la valeur nominale des monnaies antérieures, contenaient cependant une quantité moins élevée de métal fin et avaient donc, en fait, une valeur intrinsèque moindre. Il en résulta aussitôt que les débiteurs voulurent s'acquitter au moyen de la monnaie nouvelle, tandis que les créanciers refusaient de l'accepter. C'étaient surtout les patriciens et les membres du clergé qui étaient victimes de cette mutation monétaire puisque la majorité d'entre eux vivaient de rentes ou de revenus fixés coutumièrement. Aussi protestèrent-ils avec violence; une guerre civile éclata et, chose assez étonnante, mais qui montre de quel pouvoir très réel le patriciat disposait encore à cette époque, les masses populaires liégeoises, qui devaient, en principe, bénéficier des mesures monétaires prises par le prince, se déclarèrent en faveur des patriciens. Seuls les artisans de Huy - ville économiquement et socialement plus avancée que Liège - se joignirent au prince, tandis que les membres du patriciat hutois se réfugièrent à Liège et y séjournèrent durant toute la durée des hostilités. Il semble bien qu'en cette occasion les privilégiés de la fortune eurent l'habileté, lorsqu'ils firent valoir leurs griefs contre le prince, de mettre l'accent sur l'aspect politique et non pas économique du différend. Ainsi, ils purent abuser partiellement le populaire, se l'attacher et « la lutte, née autour d'une question d'intérêts matériels, se transforma rapidement et devint, comme sous Henri de Gueldre, la lutte de l'autonomie communale contre le despotisme princier » (G. Kurth.).
Les hostilités se déroulèrent de 1299 à 1301 et mirent aux prises, d'une part, le chapitre, la cité et les bonnes villes liégeoises confédérées - Huy excepté -, d'autre part, le prince, appuyé par le duc de Brabant et le comte de Looz. Mais les massacres commis par les troupes épiscopales provoquèrent dans la principauté un si vif mouvement d'indignation, que le pape Boniface VIII dut intervenir et qu'il se décida à transférer Hugues de Châlons, de Liège au siège de Besançon (mai-août 1301). La cause de l'autonomie urbaine triomphait, mais avec elle la cause du patriciat, car celui-ci qui était encore, à ce moment, le seul détenteur des droits politiques dans la cité, avait réussi à évincer un prince dont la politique monétaire allait à l'encontre de ses intérêts matériels. Or c'est cette politique qui détermina essentiellement le patriciat liégeois, ainsi que celui des autres villes, à entreprendre la lutte contre l'évêque; les artisans de la cité ne paraissent pas s'en être rendu compte et leur manque de perspicacité a sans doute, en l'occurrence, incité les patriciens, ou tout au moins le groupe des échevins et des jurés, à abuser de leur victoire.
Dans les premiers mois de l'année 1303 ils tentèrent un coup de force; on se souvient que, en vertu de la Paix des Clercs du 7 août 1287, la levée de toute fermeté avait été interdite; seule la perception d'un impôt sur la bière avait été consentie par le chapitre pour un terme de dix-huit ans qui venait à échéance en 1305. Or les échevins décidèrent brusquement, en mars ou avril 1303, de percevoir une nouvelle taxe sur les objets de consommation. Cette initiative dut provoquer quelque trouble dans la ville; pour y mettre fin les échevins créèrent une sorte de police, composée de jeunes gens recrutés parmi les fils des patriciens; on leur imposa le port d'un chaperon de couleur uniforme, probablement blanc et on les chargea de procéder à la levée de la maltôte. Ces jeunes gens, prétoriens du régime, se faisaient appeler « enfants de France ».
Ce sobriquet est, d'après Kurth s la première manifestation des sympathies françaises qui devaient, par la suite, se manifester avec tant de vivacité à Liège ». Nous ne croyons pas que cette opinion soit exacte. Il convient, pensons-nous, d'expliquer cette appellation à la lumière des faits de l'histoire générale. L'année 1302 a vu s'accomplir des événements de portée considérable, dans nos principautés. « En cette année, écrit le chroniqueur Hocsem, le parti populaire (populares) se souleva presque partout contre les grands (insignes). En Brabant ce soulèvement fut étouffé, mais en Flandre et à Liège, le populaire l'emporta durant longtemps ». Cette phrase concise, aux allures synthétiques, fait naturellement allusion aux événements qui aboutirent le 11 juillet 1302 à la bataille des Eperons d'Or, bataille où, toujours d'après Hocsem, les chevaliers français furent assommés dans les fossés « comme des boeufs destinés au sacrifice et qu'on massacre sans défense » (sicut boves ad victimam sine defensione mactantur). Mais on sait qu'en Flandre, une notable partie du patriciat et principalement celui de Gand, tenait le parti du roi de France contre le comte et les masses populaires des villes; ces patriciens reçurent de ce chef le nom de Leliaerts ou partisans du lys: la cause du roi capétien était devenue, en Flandre, la cause du patriciat. Or, la répercussion des événements qui se déroulèrent en Flandre eu 1302 fut considérable en dehors des frontières du comté; elle eut certainement son écho à Liège, surtout dans les milieux patriciens, mieux informés que les artisans. Le roi de France devait leur apparaître comme le soutien et le champion du patriciat urbain; de là le sobriquet que prirent ou que reçurent les membres de la garde prétorienne, chargée par les échevins et jurés liégeois, de procéder à la levée de l'impopulaire impôt.
Il est probable que ces jeunes gens, tout infatués de leur naissance et de leur fortune - les fils à papa de l'époque - agirent avec quelque brutalité à l'égard des artisans, puisque aussitôt les bouchers se mirent sous les armes, pour pouvoir vendre leurs viandes à la halle. Jean d'Outremeuse a brodé sur ce fait un épisode, légendaire certes, mais qui, par son caractère dramatique, s'est, durant longtemps, imposé à l'imagination populaire. Un des « enfants de France » ayant voulu se saisir de l'argent qui se trouvait sur l'étal du boucher Gilon Lothuelh, ce dernier, d'un coup de hache bien appliqué, lui trancha la main; un pourceau s'en saisit et l'aurait dévorée si elle ne lui avait pas été arrachée par un certain Hueneais de la Ruelle!
Ce fait-divers qui, est-il besoin de le dire, relève du folklore, est cependant caractéristique; d'avoir été accepté comme vraisemblable, démontre la violence des conflits sociaux qui ont ensanglanté la cité.
L'intervention brutale des « enfants de France » irrita à la fois la masse populaire et le chapitre. A la tête de celui-ci se trouait alors le doyen Jean del Cange, qui, bien que d'origine patricienne, avait avant tout à coeur la défense des privilèges ecclésiastiques. A cette fin, il s'adressa aux artisans; en secret il convoqua chez lui les chefs des métiers de la cité et conclut avec eux une alliance formelle. En présence de ce fait, force fut aux échevins et aux jurés de s'incliner: la fermeté fut supprimée. Mais les artisans ne considérèrent pas l'incident comme clos; ils avaient constaté de quel poids avait été leur intervention dans le conflit; ils se rendirent compte de la force réelle qu'ils représentaient et ils refusèrent d'être traités, désormais, comme un simple appoint dans les luttes entre le chapitre et le patriciat. Ils entendaient bien retirer un bénéfice réel de ce conflit et ils exigèrent des réformes dans l'administration de la cité. Le chapitre, toujours mal disposé à l'égard du patriciat, n'abandonna pas le peuple à son sort en cette circonstance: le 29 avril 1303 était promulguée une convention par laquelle le chapitre promettait aide et assistance aux métiers contre les grands, si ceux-ci s'avisaient encore de vouloir lever la fermeté dans la ville. Dans ce document, heureusement conservé, le chapitre déclare expressément qu'il entend « estre et serons aveck eaux (les métiers) entirement si com bons signeurs et amis ». Ce texte, si intéressant, a encore le mérite de décrire parfaitement les diverses classes sociales qui s'affrontent. Qu'on en juge, en effet « Comme ensi soit ke li maistres, ly eskevins et li grans bourgois de la citeit de Liege et lour enfans et aukunes gens de lour accort, par fais, par dis et par autre manière fesissent semblant ke ilh voloient et entendoient prendre et leveir fermeteit en la citeit de Liege encontre droit, sens, auctoriteit de saigneur et encontre nostre serment et le lour, la communiteit et li mestiers de Liege, par lour pryre, lour conseilh et autre bonne manière ont tant fait et procureit ke li dis eskevins, maistres, borghois de la dite citeit et toutes autres gens de lour accort, se sont relaissiet ( ont renoncé) de la ditte fermeteit a prendre et leveir, et point ne levent. » Ainsi la communauté et les métiers de Liège forment désormais comme une personne morale, dont il ne sera plus permis de faire fi.
Les métiers prirent immédiatement certaines mesures militaires pour appuyer leur action contre le patriciat le 15 et le 16 mai 1303: il est enjoint à leurs membres d' « estre appareilhié de leurs corps et de leurs armures et d'aller tantost (= aussitôt) a baston et au hahay (= cri de guerre) où que ce seroit en la dicte cité... et que chascun homme des mestiers eust ses armes et ses harnas ». Le 20 juillet la Cité promulguait une ordonnance de police interdisant de jeter l'alarme dans la ville, de sonner « le bancloche », d'insulter ou de molester les maîtres, les jurés ou les officiers des métiers et prévoyant aussi la manière dont les métiers doivent se tenir sous les armes. Ces instructions sont intéressantes parce qu'elles nous montrent que la « révolution » de 1303 ne se déroula pas dans une atmosphère très pacifique; elles nous instruisent aussi sur le rôle prépondérant joué, en cette occasion, par les métiers, dont l'organisation militaire est déjà remarquable.
D'autre part, ces métiers ont aussi un programme bien net en matière politique et fiscale; dans une grande assemblée publique tenue à Saint-Barthélemy et où quelques échevins étaient présents, les artisans demandèrent que les quatre concessions suivantes leurs fussent faites: 1°) on ne lèverait plus de fermeté; 2°) on ne vendrait plus de rentes sur la ville sans leur consentement; 3°) on ne les forcerait plus au service militaire arbitraire; 4) on ne fournirait plus de subsides au prince. Les échevins ayant ouï ces revendications, voulurent quitter le « meeting », et se retirer, sans plus, au destroit - nom que portait le siège de la juridiction scabinalle, situé entre le choeur de la cathédrale et la place du Marché. Mais le peuple les poursuivit et lorsque son tumultueux cortège, après avoir déferlé par Féronstrée, déboucha devant le local des échevins, on se saisit de ceux qui y siégeaient, on amena de force ceux qui se cachaient chez eux et on les obligea à souscrire aux demandes du populaire. Ces événements, qui se placent entre le 29 avril et le 15 mai 1305, aboutirent à une réforme du conseil des jurés: au lieu d'être de composition patricienne homogène, il comprendrait, désormais, par moitiés égales, des représentants des métiers et du patriciat. Pour la première fois les artisans avaient donc accès aux magistratures communales.
On a coutume de dater de là le début du régime « démocratique » à Liège. Observons, tout d'abord, que l'emploi de ce vocable prête à confusion, puisque aussi bien son sens varie singulièrement suivant les époques et qu'on ne peut reporter au début du XIVème siècle, nos conceptions modernes en matière politique et sociale. Nous préférerons donc dire que c'est de l'année 1303 que date le début du régime de la représentation populaire à Liège. Henri Pirenne a prétendu dans son « Histoire de Belgique », que cette « révolution » s'est produite sous l'influence des événements qui agitèrent la Flandre en 1302 et qu'il y a un synchronisme incontestable entre le soulèvement des Liégeois et celui des Flamands: Cette opinion du grand historien ne se fonde cependant sur aucun document et ne concorde même pas avec la chronologie, puisque la réforme liégeoise ne se produisit qu'un an environ après la bataille de Courtrai. Sans doute, l'écho de celle-ci parvint-elle sur les rives de la Meuse, comme en témoigne le sobriquet d' « enfants de France », mais que ce fait d'armes ait influencé l'action des métiers, ou même du clergé liégeois, voilà ce que l'on ne voit nulle part. La phrase d'Hocsem, citée plus haut, n'est qu'un renseignement historique de seconde main et non un témoignage personnel, l'auteur n'étant pas contemporain.
God. Kurth a fourni des faits une autre explication qu'il résume en une formule lapidaire: « la démocratie liégeoise a été tenue sur les fonts par le chapitre de Saint-Lambert ». A vrai dire, cette conception de l'éminent savant nous semble révéler une vision trop étroite des choses; sans doute, le mouvement populaire de 1303 a été aidé par le chapitre et c'est même celui-ci qui, tout comme en 1285, a pris l'initiative de faire appel aux métiers. Mais le chapitre a été rapidement débordé, et les événements ont pris, très vite, une tournure qu'il ne pouvait prévoir. Les chanoines n'entendaient se servir du peuple que pour empêcher le patriciat de procéder à la levée de la fermeté; ils ne se souciaient guère de voir s'instaurer un nouveau régime politique dans la cité, et la sympathie, qu'en 1303, ils ont témoignée aux métiers, fut purement occasionnelle. Leur attitude s'inspire uniquement des intérêts du chapitre et ils ne sont, volontairement, pour rien dans les changements qui se produisirent en 1303. N'oublions pas, enfin, que la plupart des renseignements que nous avons sur l'histoire de cet épisode, proviennent de Hocsem qui, chanoine de Saint-Lambert lui-même, a une naturelle tendance à grandir et à glorifier le rôle du chapitre. Il nous paraît donc excessif de prétendre que c'est ce dernier qui a tenu la « démocratie » liégeoise sur les fonts baptismaux.
En fait, celle-ci n'était plus, au début du XIVème siècle, un chétif nouveau-né. Depuis une quinzaine d'années, au moins, la plupart des artisans étaient déjà groupés en des corporations. D'autre part, le chapitre et le patriciat avaient, depuis assez longtemps aussi, pris l'habitude de recourir au populaire lorsque l'autonomie urbaine on leurs propres privilèges de classe étaient menacés. En luttant pour des causes qui n'étaient pas les leurs, les artisans ont fini par acquérir une certaine maturité politique et sociale que, pour la première fois, ils mirent au service de leurs intérêts directs, en 1303. Pour s'expliquer les incidents qui se produisirent alors, point n'est besoin de recourir à des événements étrangers à la cité; ils sont, au contraire, le fruit d'une longue évolution interne. La clé de la « révolution » de 1303 réside dans une série continue de faits locaux qui se sont succédé, depuis le milieu du XIIIème, jusqu'au début du XIVème siècle. Elle ne se peut comprendre que si on l'intègre étroitement dans le cadre de l'histoire liégeoise, que si on se rappelle l'opposition constante entre patriciat et chapitre et que si on ne perd pas de vue la lente croissance politique et sociale des milieux d'artisans.
Mais cette « révolution » eût-elle vraiment un caractère « démocratique » ? On en peut singulièrement douter, à considérer l'esprit qui régnait au sein des métiers et les principes du programme de réformes qu'ils élaborèrent. L'artisan liégeois est, essentiellement, un petit entrepreneur; il est à la tête d'un atelier, éventuellement il possède une boutique. Trois ou quatre ouvriers travaillent avec le maître; ce ne sont pas des prolétaires, car un jour ils deviendront maîtres à leur tour; ils font partie, tout comme le maître, de la corporation et, tout au moins jusqu'en 1350, ils y ont droit de vote au même titre que le maître. Aucun artisan - exception faite peut-être du houilleur - n'a donc intérêt à un bouleversement des institutions sociales et économiques ou à une modification du régime des métiers. Les réformes qu'il envisage sont d'ordre politique et fiscal et n'ont rien de révolutionnaire. L'interdiction de lever la fermeté était une vieille revendication formulée depuis longtemps par le chapitre; la vente des rentes sur la ville n'était pas interdite en principe; quant à la question du service militaire dû au prince, les artisans n'y étaient opposés que par suite d'un cas d'espèce: le conflit qui, de mai à novembre 1302 avait mis aux prises l'évêque, le comte de Hainaut et le roi des Romains et à l'occasion duquel le prince avait voulu - indûment, semble-t-il - les mobiliser. Enfin le non payement des subsides au prince n'était en rien un article exclusif d'un prétendu crédo démocratique; le patriciat s'était déjà, dans le passé, opposé à diverses reprises, à la liquidation de semblables aides financières.
On le voit, rien dans ce programme n'a un caractère spécifiquement « démocratique » au sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot; rien n'y est stipulé qui soit de nature à améliorer la condition matérielle et sociale de certaines couches de la population. En somme, le résultat essentiel de cette « révolution » a été de faire entrer les représentants des corps de métiers dans le conseil des jurés et de partager le pouvoir entre la grande et la petite bourgeoisie. Cette réforme, pour importante qu'elle soit, se ramène, en somme, à une question de personnes. En dernière analyse, la « révolution » de 1303 va favoriser la création d'oligarchies rivales, les unes, issues des métiers, les autres, des lignages.
Si ces dernières, cédant à la violence ou à la peur, ont dû abandonner aux métiers une partie du pouvoir politique, elles ne se considèrent cependant pas comme vaincues; très vite elles vont se ressaisir et tenter un mouvement de réaction. Durant une dizaine d'années, de 1303 à 1312, les patriciens vont essayer d'endiguer d'abord, de briser ensuite, la puissance croissante des métiers. Pour ce faire, ils vont se rapprocher du prince-évêque Thibaut de Bar (1303-1312) et chercher des alliances en dehors de la principauté, notamment auprès du duc de Brabant et du comte de Looz.
Dès la fin de l'année 1306 ou le début de 1307, la guerre civile éclate à nouveau à Liège et les échevins et patriciens doivent quitter la cité. Le 15 mars 1307, d'accord avec le prince, ils appelaient au secours Jean II de Brabant « contre le comun de la citeit de Liege, tant ke (= jusqu'à ce que) li eschevin, nos li citain et nostre acors soient remis et restablit en teilh estat ou en melour ke nos astiens devant à jour quant chies comuns de Liege qui orendroit (= présentement) governe se revela et juskes a tant ke la dite citeis soit remisse a son droit ». Comme tous les émigrés politiques, ils n'hésitent pas à promettre à leur allié de substantiels avantages, au détriment des finances communales; le duc étant créancier d'une rente sur la ville et cette somme ne lui étant pas payée « pour le raison de mauvais gouvernement qui est et a esteit très puis (= depuis) que li communs de Liege se releva », les échevins et jurés patriciens, parmi lesquels figurent les membres des lignages les plus fameux, tels les de Coir, de Lardier, Surlet, de Saint. Servais, de Dinant, etc. s'engagèrent à lui liquider tous ses arrérages « le heure que nous soyons remis on restablis en estat ».
De part et d'autre on mobilisa, les troupes se concentrèrent à Vottem, mais on n'en vint cependant pas aux mains. Faut-il croire que les milices communales, c'est-à-dire les métiers, constituaient, surtout par la masse, une force militaire redoutable? Le 20 août 1307, la paix était signée à Seraing; elle maintenait le principe de la parité dans le conseil et proclamait une amnistie. Les conquêtes réalisées par les artisans étaient donc confirmées.
L'évêque voulut profiter de cet apaisement pour mener à bien une politique de paix. C'est à cette fin qu'il promulgua, le 7 mai 1308, une importante ordonnance « pour refourmer en bien l'estat de la cité entre les grans et menuz des mestiers ». De ce document qui avait complètement sombré dans l'oubli, le regretté conservateur honoraire des Archives de Liège, M. E. Fairon, avait retrouvé récemment une analyse très complète: il entérinait tous les règlements édictés depuis 1303 et limitait à quinze le nombre des métiers. L'érudit précité considère, et, à notre avis, avec raison, que ce privilège donné par l'évêque Thibaut de Bar, le 7 mai 1308, est « la grande charte constitutionnelle qui a réglé l'administration communale de Liége jusqu'en 1384 ». Il stabilisait, en effet, les réalisations de la « révolution démocratique » de 1303.
Par ailleurs, au sein du conseil l'influence des artisans ne cessait de croître; c'est sur leurs instances, sans doute, que le 5 septembre 1311 cet organisme décide que dorénavant on ne pourrait lever d'impôts dans la cité « se ce n'estoit de le volenté et de l'assent d'eulx tous, grans, moyens et petiz ». Le principe démocratique du consentement à l'impôt par toutes les classes sociales - on remarquera la distinction en trois groupes: patriciens, marchands et artisans aisés, ouvriers manuels - était donc officiellement reconnu et proclamé.
Mais les « grands » n'avaient pas perdu tout espoir de regagner leur omnipotence; lorsqu'en juillet 1312 on eut appris à Liège, la mort de l'évêque Thibaut tombé dans un combat à Rome le 26 mai, les patriciens crurent le moment venu de mettre fin au régime qui régissait la cité depuis 1303. Le décès du prince rendait nécessaire l'élection d'un mambour ou « régent », chargé d'administrer le pays jusqu'à l'élection d'un nouvel évêque. Le chapitre désigna pour ces fonctions son prévôt, Arnould de Blankenheim. Mais les nobles et les chevaliers qui prétendaient avoir le droit de participer à l'élection du mambour, nommèrent, de leur côté, le comte Arnould de Looz. Le patriciat, hostile au chapitre, puisqu'il était l'allié des métiers, se joignit à la noblesse, à laquelle l'unissaient d'ailleurs, nous l'avons dit, de nombreux liens. Fort de l'appui des chevaliers, il crut que les circonstances allaient lui permettre d'humilier le chapitre et d'abattre le parti populaire.
Dans la nuit du 3 août 1312 une troupe armée venue de Huy et qui comprend des membres des lignages et des échevins se concentre au marché; elle y met le feu à la « mangonie » ou halle des bouchers. Mais des innombrables ruelles qui serpentent entre Hors-Château et la Meuse, la foule des travailleurs accourt en poussant des cris et, à la lueur des flammes, engage le combat contre les patriciens. Les chanoines, suivis de leurs serviteurs, et conduits par leur prévôt et son frère, l'abbé de Prüm, se rassemblent en tumulte sous les voûtes de Saint-Lambert, ouvrent avec fracas les portes de l'église et, tenant en main des torches allumées, se précipitent vers le marché, désireux de porter secours au peuple. Dans l'ardeur du combat les torches tombent, s'éteignent; comme il n'y a pas de lune, les coups s'échangent dans les ténèbres, ce qui ajoute à l'horreur de la scène. Un chanoine s'effondre, mortellement frappé, sur les degrés de la cathédrale.
Les patriciens, constatant que le nombre de leurs ennemis s'accroît sans répit, veulent profiter des premières lueurs d'une aube blafarde, pour se retirer vers l'église de Saint-Martin. Ils battent en retraite vers la Haute-Sauvenière, afin de s'installer sur la croupe du Publémont, où, profitant des avantages qu'offre ce site escarpé, ils espèrent pouvoir se défendre avec plus de succès et gagner la porte Saint-Martin qui donne accès à la route de Huy. Poursuivis et harcelés, ils arrivent devant l'église de Sainte-Croix, puis à l'entrée de la rue Mont-Saint-Martin; là ils font face au « commun » et parviennent à le repousser en un furieux combat, au cours duquel le prévôt de Saint. Lambert est tué.
Mais déjà des renforts arrivent de partout pour soutenir l'ardeur, un instant défaillante, des artisans; les habitants de Vottem, alertés, se sont armés, ont attaché, en signe de ralliement, des rubans à leurs vêtements et accourent, tout brûlants de prendre part au combat. II en est de même des bouilleurs qui, venus du faubourg Sainte-Marguerite, escaladent en courant la ruelle qui mène vers Saint-Martin. En présence de cette avalanche d'ennemis, les patriciens essayent de franchir la porte Saint-Martin; Jean du Pont, le maître plébéien de la cité qui avait trahi le peuple en ouvrant cette porte aux conjurés, trahit maintenant les patriciens et la fait fermer. Les malheureux, traqués, cherchent alors un asile dans l'église, mais le peuple, poussé par une rage aveugle, amoncelle contre la tour des bottes de paille et y met le feu. Bientôt l'église flambe et, lorsque les rayons d'un clair soleil d'été viennent frapper cette scène de carnage, le temple est en ruine et les flammes et la fumée ont eu raison de ceux qui s'y étaient réfugiés. Les autres, pour avoir voulu échapper au brasier, se sont fait massacrer dans la rue.
Telles furent ces « matines liégeoises » que les contemporains appelèrent « le mal » - entendez le malheur - ou « la mâle Saint-Martin ». Le nombre des victimes peut être évalué à deux cents environ et, des quatorze échevins, dix étaient parmi les morts. Ce fut un coup terrible pour le patriciat: « la fleur de la citeit, fut la consummée » s'écrie Jean d'Outremeuse. En effet, décimé et exilé, il perdait toute autorité effective sur la cité aux destinées de laquelle il présidait depuis deux siècles.
Les survivants comprirent qu'il ne leur restait plus qu'à traiter avec ce « commun » dont la puissance venait de se manifester d'une manière si redoutable. Tandis que la guerre des Awans et des Waroux continuait à désoler la principauté et à éclaircir les rangs de la chevalerie, alliée du patriciat, des négociations s'engageaient entre le chapitre et la « communiteit » de Liege, d'une part, le comte Arnould de Looz et « cheaz de Liege qui sont hours de Liege » c'est-à-dire les patriciens bannis, d'autre part. La paix fut signée à Angleur, le 14 février 1313, et proclamée, le même jour, devant la porte et sous les tilleuls de l'abbaye de Saint-Gilles en Publémont.
Depuis un siècle les historiens s'accordent, à la suite de L. Polain et de F. Hénaux, à voir dans cette paix un document d'intérêt capital, fondant définitivement la prépondérance du parti démocratique à Liège.
Une sagace étude de feu E. Fairon, édifiée sur nombre de documents inédits, est venue tout récemment, contredire cette opinion. Il ne faut plus voir désormais dans la paix d'Angleur « qu'un simple compromis liquidant, après une guerre civile atroce, tout ce qui faisait obstacle à la pacification des esprits ». En particulier la stipulation qui aurait imposé aux patriciens l'obligation de se faire inscrire dans un des vingt-cinq métiers de la cité afin de pouvoir faire partie du conseil, est le fruit d'une interprétation erronée de texte; en réalité la paix d'Angleur décide que les patriciens bannis qui désireront siéger au Conseil devront être membres soit d'un métier, soit d'un des vingt-cinq lignages de la cité. Cette paix ne consacre donc pas, comme on l'a pensé, la prédominance exclusive des métiers et elle ne fait pas du conseil un organisme de classe. Mais elle témoigne cependant de la très réelle importance acquise par les métiers dans l'organisation politique de la cité de Liège.
A côté du conseil, fut organisée aussi l'assemblée générale des bourgeois; elle réalisait le principe du gouvernement direct par le peuple et avait des attributions fort étendues. Ses réunions se tenaient, généralement, au Palais; les maîtres y faisaient connaître l'objet de la convocation; ensuite les métiers délibéraient et les résolutions étaient adoptées ou rejetées, à la majorité des métiers.
Comme on le voit il n'y a guère de place, dans ce système politique, pour l'individu isolé; celui-ci ne compte qu'en tant qu'il fait partie d'un groupe: le métier ou le lignage. Le parti politique au sens moderne du mot n'existe pas et ne peut exister. Tous les votes sont à deux degrés au moins; on vote à l'intérieur du métier d'abord, puis les métiers votent entre eux.
Pareil régime n'est pas, comme le pense G. Kurth, « une démocratie pure ». Bien qu'il soit une émanation du peuple des travailleurs, il favorise la formation d'oligarchies, par suite du caractère indirect du vote et du groupement préalable des électeurs dans le sein des corporations. Ce sont ces oligarchies qui vont être le principal moteur des nouvelles luttes sociales qui agiteront la cité au XIVème siècle; ce sont, elles aussi, qui choqueront, au plus haut point, le chanoine et chroniqueur Jean de Hocsem.
VI.
Les luttes politiques et sociales du XIVe siècle.
Les luttes qui ont agité la cité de Liège depuis Henri de Dinant jusqu'à la paix d'Angleur, ont essentiellement mis en scène, nous l'avons vu, le chapitre de Saint-Lambert, le patriciat et les artisans. Le prince n'y a participé que d'une manière assez effacée et les événements de 1303, ainsi que ceux de 1312, se sont déroulés durant des vacances du siège épiscopal. Les choses vont changer complètement au XIVème siècle; le rôle du prince grandit et devient infiniment plus actif. La raison de cette intervention est double: elle s'explique, d'abord, par la personnalité du souverain, ensuite, par l'attitude politique de la cité.
On sait que c'est au XIVème siècle que l'absolutisme des souverains commence à se manifester avec une réelle intensité en Europe Occidentale. Les princes. évêques de Liège et singulièrement Adolphe II de La Marck (1313-1344) et son neveu et successeur Englebert de La Marck (1345-1363), n'ont pas échappé à cette tendance et ils ont essayé de pratiquer une politique favorable au maintien de leur « haut domaine ». D'autre part, la ville où l'élément petit bourgeois et artisanal vient d'acquérir un prestige considérable, tend à intervenir de plus en plus fréquemment dans la politique de la principauté et à usurper une notable partie des droits de la souveraineté princière. L'accentuation de ces deux tendances opposées devait fatalement provoquer entre ville et prince un choc violent.
Les deux éléments sociaux qui avaient, au XIIIème siècle, dominé la cité: le patriciat et le chapitre, ont perdu une notable partie de leur influence au siècle suivant. La casse sociale vraiment importante dans la ville, c'est celle des artisans ou membres des métiers. C'est à la lutte entre elle et le prince qu'il convient, avant tout, de prêter attention.
La paix d'Angleur fut signée, rappelons-le, le 14 février 1313, pendant la vacance du siège épiscopal. Le 16 avril, Adolphe de La Marck était promu évêque par le pape et le 26 décembre il faisait sa joyeuse entrée à Liège. C'était un prince allemand, impérieux, hautain, tout imbu de principes féodaux, mais qui avait subi, dans les universités françaises, l'influence des légistes et du droit romain. Brave et courageux, il réalisait davantage l'idéal du soldat que celui du prêtre. Le jour de son entrée à Liège, alors qu'il descendait, à cheval, les degrés de Saint-Lambert, son coursier se cabra dangereusement, mais l'évêque se soulevant, de sa selle, sauta prestement à terre, sans l'aide de personne.
En prenant possession du trône, le prince trouvait un pays désolé par la guerre des Awans et des Waroux; aussi se préoccupa-t-il, avant tout, de faire régner un minimum d'ordre parmi ses turbulents vassaux et sujets. Pour réaliser ce dessein il avait besoin de la bienveillance de la cité. Il évita donc soigneusement de heurter de front les métiers et le chapitre, ratifia les stipulations de la paix d'Angleur et, dès le 9 janvier 1314, accordait à la ville le pardon des excès commis dans la nuit du 3 août 1312. Trois mois plus tard les échevins - juges et administrateurs épiscopaux - déclaraient, à leur tour, que tous les crimes perpétrés à cette occasion, étaient pardonnés et que personne ne pouvait plus être poursuivi de ce chef. « Le mal Saint-Martin » était, en quelque sorte, légalisé par l'autorité souveraine.
La classe ouvrière profita de cette attitude généreuse d'Adolphe de La Marek pour parachever l'organisation qu'elle venait de se donner; le prince semble s'y être associé sans arrière-pensée. Comme les métiers entendaient soumettre étroitement toute la vie économique au régime corporatif, l'évêque s'empressa, dès le mois de janvier 1314, de donner aux drapiers un règlement « lesquellez contiennent la fourme et maniere de la drapperie de Liège, comment ouvrer doivent et vendre »; puis, le 1er juin, il annula, en faveur des boulangers et meuniers, une disposition de son prédécesseur. Enfin, le 15 janvier 1315, le conseil promulguait la « lettre de la change » ou règlement pour les changeurs. Alors que tous les artisans étaient déjà groupés en associations professionnelles, les changeurs, qui n'étaient pas des manuels et qui se recrutaient en partie dans le sein du patriciat, parmi « touttez bones gens, grans et moyens, de bon nom et filx de proidhome » n'étaient qu'associés en une « frairie » aux liens assez lâches. On les intégra, de gré ou 'de force, dans le cadre de l'organisation corporative urbaine.
Quelques années plus tard, le 1er février 1324, le prince publia également un règlement relatif à la vente du drap à Liège. La « lettre des halles » - tel est le nom donné à ce document - contient, au point de vue social, une stipulation intéressante: c'est celle qui ordonne la nomination d'une commission de six hommes, les « wardans delle drapperie » appelés à faire observer le dit règlement. Or, ce texte distinguait soigneusement les marchands de drap ou « halliers », recrutés surtout dans les milieux patriciens et aisés, des fabricants et ouvriers appelés « drapiers » qui appartenaient à un milieu social beaucoup plus humble. La « lettre des halles » prévoit que, des six « wardans » deux seront choisis parmi les jurés du conseil, deux parmi les halliers et deux parmi les drapiers. C'est là une véritable commission paritaire: les « wardans », devant surveiller la fabrication des étoffes indigènes, examiner les draps étrangers, fixer les prix et exercer la police des balles, il est visible qu'on n'a pas voulu laisser aux halliers seuls, l'exercice d'attributions relatives à leur activité économique; on pouvait craindre, en effet, qu'ils ne les utilisent à des fins personnelles et dommageables pour les drapiers. Ceux-ci ne se trouvent donc pas dans un état de sujétion vis-à-vis des halliers; l'artisan-ouvrier et le marchand-patron sont mis sur le même pied et le pouvoir public arbitre, éventuellement, leurs différends. Pareille organisation ne rappelle guère le régime social que connaît, à la même époque, l'industrie drapière en Brabant et eh Flandre; là les marchands sont des entrepreneurs qui ont réduit les artisans à la quasi-condition du prolétaire, tandis qu'à Liège _ces derniers sont des quasi-collaborateurs des premiers.
Malgré les dispositions bienveillantes que le prince témoigna, au début de son règne, à l'égard de la cité, un conflit ne tarda pas à éclater. Vers le milieu de l'année 1315, Liège s'allia avec les autres villes de la principauté ainsi qu'avec le parti des Awans contre Adolphe de La Marck, sans que les raisons de cette lutte nous apparaissent d'une manière précise. La guerre fut pénible, cruelle et elle ne tourna pas à l'avantage du prince; pour obtenir l'appui du duc de Brabant, il dut lui payer de gros subsides. Les pillages, les meurtres, les atrocités se succédaient; la famine et une mortalité excessive désolaient le pays; les subsistances étaient vendues à des prix fous et des spéculateurs, dont les greniers regorgeaient de blé, refusaient de le vendre et préféraient l'exporter à l'étranger, où les prix étaient plus élevés encore.
Finalement les parties, épuisées, signèrent le 18 juin 1316, la paix de Fexhe. Ce document célèbre, qui allait devenir la base de la constitution du pays et qui était appelé à des destinées brillantes, ne fut cependant, aux yeux des contemporains, qu'une compilation assez contradictoire, qu'ils considérèrent comme une simple trêve. La paix proclamait un principe qui se retrouve aussi dans la fameuse charte brabançonne dite de Cortenberg du 27 septembre 1312, à savoir « que cascuns soit meneis et traities par loy et par jugement des esquevins ou d'ommes, solonc ce que a cascuns et à cas affierat, et nient aultrement ». Un petit nombre de cas étaient cependant réservés au « haut domaine » du prince; la paix de Fexhe ne s'exprimant qu'avec ambiguïté à l'égard de ces derniers, la cité allait en prendre prétexte pour continuer à rogner sur les attributions du prince et pour persévérer dans son hostilité à son égard.
Les prérogatives de la souveraineté furent bientôt, et ouvertement, mises en question; la cité s'oppose, par exemple, à l'exercice de la juridiction du prince-évêque, prétend étendre son autorité sur les voies publiques, les « werixhas » ou waréchaix, c'est-à-dire les terres du domaine public qui n'avaient pas fait l'objet d'une appropriation privée et sur les fosses à charbon ou houillères. Elle s'arroge le droit d'avoir une prison et décerne, sur une grande échelle, le droit de bourgeoisie afforaine. Finalement, le prince n'y tint plus; le 14 février 1325 il faisait rédiger un acte d'accusation contre la cité, dans lequel il énumérait, en un vigoureux raccourci, les innombrables atteintes portées à son autorité. En même temps il jetait l'interdit sur la ville et excommuniait les maîtres et jurés.
C'était la rupture; la guerre qui débutait allait durer près de quatre ans.
Dans le sein du chapitre des tendances diverses se firent jour, dès le début du conflit. Quelques chanoines tenaient pour la cité; la majorité - dont Jean de Hocsem - pour le prince. Le débat était vif entre les deux groupes et un jour que se tenait une séance capitulaire, les maîtres de la cité, faisant irruption, demandèrent aux chanoines de leur faire connaître, individuellement, leur opinion sur le conflit. « Devant un pareil acte de pression, raconte Hocsem, je voulus me retirer, mais le maître Hanoset, un de mes amis, se dressa devant moi et m'empêcha d'atteindre la porte. Je pris alors les clés du claustrier et sortis par la poterne; je ne devais revenir en ces lieux que cinq ans plus tard ». La majeure partie du chapitre se retira avec Adolphe de La Marck à Huy; quelques chanoines restèrent à Liège.
La politique d'alliance entre la cité et le chapitre, politique pratiquée depuis trois quarts de siècle, prenait fin. Aux yeux du clergé elle avait eu sa raison d'être, tant que l'appui du peuple lui était nécessaire pour combattre les prétentions formulées contre ses privilèges parle patriciat. Mais maintenant, la puissance croissante du populaire l'effrayait et il n'était pas loin de voir en lui une force susceptible de bouleverser la hiérarchie sociale. Ce « renversement des alliances » n'entraîna cependant pas la conviction de tous les chanoines; malgré l'excommunication, malgré le pape, malgré le prince-évêque, une minorité resta fidèle au point de vue de la cité.
Les Liégeois considérèrent que cette minorité constituait à elle seule le chapitre; d'autre part, ils forcèrent à deux reprises, en 1325 et 1328, l'échevinage à déclarer que les ponts, les murs, les fossés et les « werixhas » de Liège appartenaient à la cité et que le prince ne pouvait, sans leur consentement, appliquer d'autre loi dans la ville que la loi Charlemagne. Il pouvait donc sembler que la légalité était du côté du gouvernement communal.
Les tentatives d'arbitrage faites par le pape échouèrent complètement et la lutte continua, implacable, désolant la riche Hesbaye que les mercenaires engagés par la cité et les chevaliers brabançons et allemands du prince-évêque, ruinaient sans scrupules.
A la tête de la cité se trouvaient alors deux hommes Pierre Andricas et André de Ferrières. Le premier était un pelletier qui fut, à deux reprises, maitre de la cité. Nommé dans les documents à partir de 1317, il paraît avoir appartenu à un milieu aisé, qui avait des attaches avec Guillaume de Jeneffe, châtelain de Waremme et un des chefs du parti des Awans. Nous ne le connaissons guère que par ce que disent de lui ses adversaires et, avant tout, Hocsem. Ambitieux, obstiné, doué d'une grande éloquence, il est un de ces typiques représentants des politiciens liégeois qui profitèrent du régime créé par la « révolution démocratique », pour devenir les leaders de la masse des artisans et petits bourgeois.
Quant à André de Ferrières c'était un juriste qui occupait les fonctions de secrétaire du conseil. Les chanoines du chapitre qui le détestaient - c'était lui aussi un clerc - nous l'ont dépeint sous des traits peu flatteurs que l'on ne peut accepter que sous toutes réserves. Est-ce vraiment lui qui incita le peuple à la révolte contre le prince en 1325 et qui prit l'initiative d'une série de mesures vexatoires à l'égard du chapitre? Est-ce lui également qui fut accusé, en 1345, d'avoir trempé dans une escroquerie financière au détriment de la ville?
La haine, la rancune personnelle, le parti pris ont certainement déformé les maigres renseignements que nous possédons sur les hommes qui furent alors les moteurs des événements. Aussi ne connaissons-nous ces derniers que d'une manière confuse et fragmentaire, car, à l'époque considérée ici, le rôle des individus a dû être considérable et a dû influer d'une manière parfois décisive, sur le cours des faits politiques dans la cité. On ne peut oublier, en effet, que cette multitude nerveuse d'ouvriers, d'artisans, de boutiquiers, de patrons, peu ou pas instruits, mal informés, très influençables, crédules, agités et disposant, en fait, d'un pouvoir politique considérable, était une proie facile pour quelques personnalités éloquentes et ambitieuses. C'est à des politiciens, préoccupés d'intérêts personnels et dont les partisans devaient former autant de petites oligarchies jalouses et rivales, que le peuple avait, en fait, abandonné le pouvoir.
Mais ce même peuple n'hésitait jamais une fois qu'il avait pris les armes, à lutter sans arrêt, et à affronter des forces militaires redoutables quand ses ennemis le poussaient à bout. Aussi lorsqu'on apprit, à Liège, en mars 1328, qu'une ambassade envoyée par la cité à Avignon avait été capturée, aux environs de Saint-Quentin, par les partisans du prince, les masses, impulsives, coururent attaquer l'armée campée près de Huy. Adolphe de La Marck paya de sa personne en cette circonstance et, le 27 mai, il remportait un brillant succès sur les Liégeois au Thier de Nierbonne, sur la colline de Huy; il s'empressa d'en communiquer la nouvelle au pape et au roi de France.
Si l'on songe, qu'au même moment, ce dernier devait envoyer une armée de secours en Flandre pour soutenir le comte, attaqué par les paysans de la région maritime, on en conclura que les Pays-Bas étaient alors le foyer de ces insurrections populaires qui communiquent au siècle où eurent lieu la Jacquerie, la révolution d'Étienne Marcel et le soulèvement de Wat Tyler, un aspect particulièrement sombre et farouche.
Malgré leurs revers, les Liégeois se raidirent dans leur volonté de résistance. A bout de ressources financières, ils se décidèrent à prendre une mesure fiscale à laquelle il avait été décidé, depuis quarante ans, de ne plus recourir : ils levèrent une fermeté. Aussitôt les chanoines de Saint-Lambert, qui étaient jusqu'alors restés dans la cité, s'insurgèrent; cette atteinte directe à leurs privilèges les décida à rompre avec la ville. Ils l'abandonnèrent et vinrent, à Huy, grossir le nombre des alliés du prince (juillet 1328). Attitude significative qui montre, contrairement aux affirmations de Kurth, combien le clergé ne songeait nullement à épouser le point de vue de la « démocratie » liégeoise. Il y eut une explosion de haine à Liège contre les chanoines; leurs biens furent saisis et leurs maisons furent transformées en casernes par des soudards qui y commirent mille excès.
Cependant Adolphe de La Marck faisait un suprême effort; il se procurait de l'argent auprès du clergé et de nouveaux alliés auprès de la noblesse d'Allemagne et des Pays-Bas. L'archevêque de Cologne écrivait, de son côté, au pape pour obtenir un prompt châtiment des Liégeois. Toute l'Europe suivait avec un intérêt anxieux le développement des luttes sociales, tant en Flandre qu'à Liège, lorsqu'elle apprit, coup sur coup, la nouvelle des victoires remportées sur les Flamands à Cassel (23 août) et sur les Liégeois à Hoesselt (25 septembre).
Ce dernier fait d'armes fut bientôt suivi de la signature de la paix de Wihogne (4 octobre), complétée, par la suite, par la paix de Flône (1 juin 1330) et le règlement du 23 juin 1330 (qualifié parfois, mais à tort, de paix de Jeneffe). Ces paix tranchaient, dans un sens favorable au prince, la question des usurpations commises au détriment de son « haut domaine », elles imposaient aussi à la ville une lourde amende mais elles ne modifiaient pas essentiellement l'organisation politique et sociale de la cité. On se contenta de reprendre aux métiers une partie des avantages acquis: le règlement du 23 juin stipule, que les gouverneurs des métiers seront exclus du conseil et que les six vinâves pourront élire quatre-vingts conseillers « personnes bonnes et discrètes, moitiet de grans et motie de petis ».
Ces mesures visent à établir un équilibre entre les différentes classes sociales dans la cité de manière à « maintenir a tousjour pais et accord entre nous et les citains, povrez et riches, grans et petis ». Bien que cette formule revienne, comme un leitmotiv, dans tous ces documents, il ne semble pas que le prince ait imposé, effectivement, des mesures propres à la réaliser. Une notable partie du personnel politique liégeois resta en place, et le 25 juillet 1330, lors de l'élection à la maîtrise, le peuple éleva aux fonctions de maître, Pierre Andricas. Celui-ci ne pensait qu'à changer le nouveau statut dont la cité était dotée afin de revenir au temps de la puissance des métiers. Par ses soins, un complot fut ourdi au début de février 1331; dénoncé par une femme, il avorta et Pierre Andricas dut fuir avec ses complices; un seul fut arrêté et écartelé.
Le prince se décida alors à prendre des mesures plus rigoureuses à l'égard de la cité: le 10 juillet 1331, il promulguait un règlement dit « Reformation d'Adolphe » qui instituait une sorte d'état de siège, interdisait les rassemblements de plus de deux personnes et qui reçut du peuple le nom de « loi du murmure ». En même temps, l'élection des jurés était enlevée au peuple, les gouverneurs des métiers étaient supprimés et remplacés par des « wardains », choisis par le tribunal des échevins. Des deux maîtres, l'un devait être pris parmi les grands, l'autre parmi les petits. Ainsi on enlevait tout pouvoir politique aux métiers, qui redevenaient des associations professionnelles.
Lorsque le 26 avril 1332, Adolphe de La Marck fit, après une absence de sept ans et au milieu d'un grand concours de princes, ses alliés, une rentrée triomphale à Liège, pouvait-il se vanter de l'avoir emporté sur la cité? Au point de vue politique, on aboutissait à un compromis: l'absolutisme princier ne triomphait pas, mais la cité, dotée d'un régime constitutionnel, n'était pas parvenue à s'émanciper complètement de l'autorité du prince. Au point de vue social on peut faire une constatation analogue: le régime patricien avait vécu et ne fut pas rétabli, mais, d'autre part, l'omnipotence des métiers fut brisée et les artisans durent partager l'exercice du pouvoir avec les représentants des autres classes sociales. Ce double compromis ne résolvait donc rien; les luttes allaient reprendre.
Les douze années qui s'écoulent de 1331 à 1343 furent, pour la cité, une période de calme. Ses relations avec le prince furent, dans l'ensemble, cordiales; les conflits sociaux n'étaient pas apaisés, sans doute, mais n'avaient pas l'occasion de se manifester d'une manière violente. Plusieurs métiers reçurent du prince, des chartes, dans lesquelles les stipulations du règlement du 10 juillet 1331 recevaient leur application directe. D'autre part, Adolphe de La Marck parvint, le 16 mai 1335, à imposer aux Awans et aux Waroux la paix dite des lignages, mettant ainsi fin à une guerre qui avait duré trent-huit ans et à laquelle toutes les classes sociales avaient fini par s'intéresser.
Malgré la tranquillité dont jouissaient ainsi la principauté et la cité, certains problèmes n'étaient pas sans inquiéter les habitants. Un des plus importants était le problème monétaire. La dépréciation constante de la valeur des monnaies avait d'inévitables répercussions sociales et politiques; elles furent particulièrement sensibles à Liège où résidaient nombre de changeurs. Nous avons déjà dit qu'on avait imposé à leur « frairie », en 1315, un règlement corporatif; le 13 décembre 1338 de nouveaux statuts, édictés par le maïeur et les échevins venaient détailler, d'une manière beaucoup plus précise, les devoirs et obligations de ces manieurs d'argent en matière professionnelle et financière.
Par ailleurs, le renchérissement de la vie préoccupait tellement le public que les plaintes relatives à ce phénomène deviennent des formules de style et que les travailleurs réclament des augmentations de salaires. Le 19 juillet 1325 une sentence arbitrale règle les difficultés survenues entre les maîtres et le valets des foulons au sujet du salaire de ces derniers; cet accord étant, par la suite, devenu caduc, un autre taux des salaires est fixé en faveur des ouvriers foulons, d'abord en avril 1351, puis le 19 septembre 1352; un nouveau barème des salaires est stipulé le 1 octobre 1423 et d'autres tarifs sont encore édictés en 1435 et 1447 pour les mêmes ouvriers.
Outre la hausse lente mais constante du prix de la vie, il y a aussi des hausses brusques mais temporaires, dues à un fait accidentel: mauvaise récolte, hiver rigoureux, interdiction d'importation de vivres ou de matières premières provoquée par la guerre et, notamment, par celle qui vient d'éclater, en 1337, entre la France et l'Angleterre. Des famines n'étaient pas rares et c'étaient, naturellement, les milieux ouvriers de la cité qui en souffraient le plus. D'autre part, les monnaies subissaient assez souvent, de brusques et importantes mutations de valeur. Ce manque de stabilité économique et monétaire, ces difficultés de ravitaillement, contribuaient à donner à l'existence des masses, un caractère précaire et dangereusement mouvementé qui avait sa répercussion sur le plan politique; les métiers liégeois, privés de toute participation directe au gouvernement et bridés par la « loi du murmure » ne cherchaient qu'à se libérer de leurs entraves et à reprendre la lutte contre le patriciat. Cet état d'esprit entretenait dans la cité une agitation constante et une hostilité entre classes sociales, dont on trouve des échos, affaiblis sans doute, dans des documents de 1343 et de 1345; le premier stipule qu' « il doit estre faite bon et raisonable status... contre tous cheaz qui creieront « az clers » ou « az damisealz » ou « as vilain »; le second fixe l'amende que payera l'homme « de linaige qui crierat « auz vilain » ou uns bons de mestier qui crierat « az damoiseals » publement » (publiquement).
Michelet au tome sixième de son < Histoire de France » publié en 1844, a consacré à l'histoire de Liège « cette petite France de Meuse » quelques pages, où figurent d'ailleurs nombre d'erreurs, mais dans lesquelles, d'autre part, son intuition de visionnaire lui a permis d'évoquer, d'une manière saisissante, quelques aspects caractéristiques de ce passé tumultueux. « Liberté orageuse, sans doute, ville d'agitations et d'imprévus caprices. Eh bien, malgré cela, pour cela peut-être, on l'aimait. C'était le mouvement, mais, à coup sûr, c'était la vie (chose si rare dans cette langueur du moyen âge), une forte et joyeuse vie, mêlée de travail, de factions, de batailles: on pouvait souffrir beaucoup dans une telle ville, s'ennuyer? jamais. Le caractère le plus fixe de Liège, à coup sûr, c'était le mouvement ».
Faisons la part du point de vue romantique et du subjectivisme, mais reconnaissons que Michelet a « senti » la société qu'il peignait. Ecoutons-le décrire la Liège ouvrière du XIVème siècle: « La chronique a jugé durement cette Liège ouvrière du XIVème siècle, mais l'histoire qui ne se laisse pas dominer par la chronique et qui la juge elle-même, dira que jamais peuple ne fut plus entouré de malveillances, qu'aucun n'arriva dans de plus défavorables circonstances à la vie politique. S'il périt, la faute en fut, moins à lui qu'à sa situation, au principe même dont il était né et qui avait fait sa subite grandeur. Quel principe? nul autre qu'un ardent génie d'action, qui ne se reposant jamais, ne pouvait cesser un moment de produire sans détruire. La tentation de détruire n'était que trop naturelle pour un peuple qui se savait haï, qui connaissait parfaitement la malveillance unanime des grandes classes du temps, le prêtre, le baron et l'homme de loi. Ce peuple, enfermé dans une seule ville et, par conséquent, pouvant être trahi, livré en une fois, avait mille alarmes et souvent fondées. Son arme, en pareil cas, son moyen de guerre légale contre un homme, un corps qu'il suspectait, c'était que les métiers chômassent à son égard, déclarassent qu'ils ne voulaient plus travailler pour lui. »
De pareilles séditions jalonnent, nous l'avons vu, toute l'histoire de Liège. Celle qui éclata en 1343 fut le résultat de ce mécontentement latent des métiers. Lorsque le prince, désireux de réprimer la rébellion de la ville de Huy, vint demander la mobilisation des milices urbaines, la cité exigea la suppression de la « loi du murmure ». Elle l'obtint, le 1er juillet, par un document qu'on a coutume d'appeler la lettre de Saint-Jacques. Celle-ci restaure l'élection directe des jurés par le peuple, renouvelle la parité entre grands et petits au conseil, rétablit les gouverneurs des métiers et autorise la convocation générale des bourgeois à la demande de deux ou trois métiers. Ces conquêtes se distinguent, a dit Kurth, par leur modération aussi ne parurent-elles pas suffisantes aux métiers qui ne supportaient qu'avec peine le partage du pouvoir avec ce patriciat qu'ils avaient vaincu lors du mal Saint-Martin et qui, de plus en plus absorbé par la noblesse, avait, en fait, perdu toute importance dans la cité où il ne se maintenait que grâce à l'appui du prince et grâce aussi à la corruption.
La mort d'Adolphe de La Marck, le 3 novembre 1344, offrait aux artisans l'occasion de réaliser leurs desseins. La cité s'allia avec d'autres villes de la principauté et même, en 1346, avec certaines villes de Flandre, peut-être Gand, où, après l'assassinat de Jacques Van Artevelde (17 juillet 1345), le parti des tisserands avait pris le pouvoir. Aussi lorsque Englebert de La Marck succéda à son oncle (23 février 1345), se trouva-t-il dans l'obligation de faire presque aussitôt la guerre à ses sujets. Le peuple s'en prit à quelques patriciens, accusés de malversations, et, mécontent, par ailleurs, de la solution donnée à la question de la succession au comté de Looz, il malmena plusieurs chanoines qui durent quitter la cité. Le prince fit ce que ses prédécesseurs avaient fait en semblables circonstances il s'allia avec le duc de Brabant pour mettre à la raison les Liégeois et faire cesser « les violences, arsins, rapines et grans damages que chis de la ditte cyteit, lor aidans et aherdans, ont faites » L'attitude du chapitre fut exactement celle que ce même corps ecclésiastique avait eue vingt ans auparavant: la majorité des chanoines, docile aux ordres du prince, quitta la cité rebelle; quelques tréfonciers restèrent à Liège et cette fois, Jean de Hocsem fut de ce nombre. Mais lorsque, en avril ou mai 1347, la Cité après avoir décidé de ne plus payer de subsides au prince, prit l'initiative de recourir, une fois de plus, à l'impôt de la fermeté, le chapitre, atteint dans ses intérêts matériels, manifesta sa réprobation; des dix chanoines restés à Liège, cinq abandonnèrent la ville. Hocsem fut un de ceux qui continuèrent à résider.
Les troupes de la cité avaient commencé par remporter quelques succès et détruit plusieurs châteaux du prince, mais, le 21 juillet 1347, lors d'un combat livré à Waleffe, elles furent écrasées par les chevaliers du prince et du duc de Brabant. Les Liégeois laissèrent de nombreux morts sur le terrain - dix mille aux dires de Hocsem, quatre mille suivant une autre source, bien que l'un et l'autre chiffre soient certainement exagérés. La défaite de la cité était complète. Elle dut signer, le 28 juillet, la paix de Waroux et renoncer, écrit Hocsem, à toutes les choses pour lesquelles elle avait commencé cette guerre.
Cette remarque du chanoine liégeois n'est qu'en partie exacte: si Liège dut faire abandon de tout ce qui était de nature à porter atteinte au « haut domaine » du prince, en revanche, celui-ci maintint l'organisation interne de la cité et ne révoqua pas la lettre de Saint-Jacques. Visiblement Englebert ne tenait pas à s'immiscer dans les questions politiques et sociales locales qui préoccupaient les Liégeois; du moment que son autorité n'était pas contestée il laissait, à la cité pleine liberté. Il ne prenait parti ni pour les petits, ni pour les grands. Ces derniers étaient trop faibles pour former un parti susceptible de s'opposer avec succès aux métiers et les petits étaient trop nombreux et trop résolus pour qu'on pût les anéantir. Même après sa victoire de Waleffe, le prince les craignait encore, et lors de son entrée à Liège, en août 1347, il fut effrayé par les clameurs que poussait, dans les rues, la multitude des hommes et des femmes du peuple; plusieurs clercs de son entourage, terrifiés par ce bruit, s'enfuirent de la ville.
Cependant le prince était désireux d'établir des relations pacifiques entre lui et la cité; pour faire oublier les maux de la guerre il réduisit le montant de l'amende que stipulait la paix de Waroux, il dota le pays d'une monnaie saine en fixant la valeur du sou liégeois, il répartit avec plus de justice le fardeau fiscal en imposant un subside au clergé. Enfin, pour mettre un terme à l'arbitraire don les échevins de Liège faisaient souvent preuve, il décida que le droit, en vertu duquel ils jugeaient, serait mis par écrit (loi nouvelle, 12 décembre 1355) et réglementé (modération de la loi nouvelle, 15 novembre 1361). Les échevins devaient jurer de faire droit au pauvre comme au riche et les limites de leur juridiction furent fixées. C'était un rude coup porté à la puissance des vieilles familles patriciennes qui considéraient l'échevinage comme leur fief depuis des siècles.
Peu d'années après, elles allaient subir un échec plus grave encore. L'échevinage était, probablement depuis le milieu du XIIIème siècle, représenté au conseil par quelques-uns de ses membres; après 1369 il cesse d'en être ainsi. Le dernier acte émané du conseil et qui, selon l'antique formule, débute par les mots « nous, les maîtres, les échevins, les jurés, le conseil et toute l'université de la cité de Liège » est du 25 novembre 1369 - c'est d'ailleurs, chose curieuse, un acte adressé au magistrat d'Anvers et rédigé, pour cette raison, en flamand. Par la suite les échevins ne sont plus cités dans cette titulature, ce qui prouve qu'ils ont été exclus définitivement du conseil. L'échevinage, organe princier, où siègent les patriciens, n'est plus qu'un tribunal; il n'a plus à intervenir dans les affaires administratives et politiques de la cité.
Quant aux patriciens qui avaient encore séance au conseil en tant que jurés « ils finirent, dit H. Pirenne, par renoncer, en 1384, de leur plein gré à ce partage du pouvoir communal qui n'était plus pour eux qu'une charge inutile, une dépense vaine et une ennuyeuse corvée. » God. Kurth a pensé, lui; aussi, que le désistement des patriciens « fut une abdication résignée et raisonnée ». Ainsi, ajoute le même historien « le peuple supprimait l'aristocratie comme corps politique et inaugurait dans la cité le règne de l'égalité absolue ». On a quelque peine à s'imaginer la réalité de ce fait: une classe sociale abandonnant, bénévolement, des prérogatives politiques importantes! Malheureusement, les sources sont muettes sur cette nuit du 4 août liégeoise; elles ne nous permettent que d'épingler le fait au passage, mais non de l'expliquer.
Quoi qu'il en soit, Liège fut dès lors gouvernée par un conseil où ne siégeaient plus que les représentants des métiers; cette organisation « la plus purement démocratique que la Belgique ait connue au moyen âge » se fondait, comme Pirenne l'a bien observé, sur deux principes essentiels: le gouvernement direct du peuple par lui-même et l'égalité absolue de tous les métiers, quelle que fut, par ailleurs, leur importance. Parmi les métiers aucun ne l'emportait d'ailleurs d'une manière écrasante sur tous les autres, comme c'était, par contre, le cas en Flandre, pour celui des tisserands. L'égalité politique entre métiers est le fruit, à Liège, d'une certaine égalité économique et sociale.
Pour être citoyen optimo jure, il fallait être d'un métier; pour être d'un métier il fallait, en principe, être Liégeois. On vit donc nombre d'étrangers, et même des non-résidents, solliciter, ce que nous appellerions aujourd'hui la naturalisation liégeoise. Ce privilège fut accordé, assez libéralement jusqu'au XIVème siècle; on nommait ceux qui en jouissaient le bourgeois afforains. Aux dires de Jacques de Hemricourt, - un ennemi du régime, qui sans doute exagère, - ils formaient le quart de la population et « les ignorans borgois citains... sèment pierres prechieuzes entre porcheaux, quant ilh font les borgois afforains ».
Ces masses d'artisans suivaient, avec une évidente sympathie, les efforts que déployaient les communiers dans d'autres principautés, et notamment en Flandre, pour obtenir un statut politique semblable à celui que possédait Liège. Lors de la grande révolte de Gand contre le comte de Flandre (1379-1385), on vit les Liégeois écrire des lettres aux Gantois, pour leur dire combien ils estimaient juste, la cause pour laquelle ils combattaient (eosque per litteras animabant quod eorum optimam judicarent esse causam). En outre, ils ravitaillèrent la ville flamande en lui faisant parvenir des centaines de sacs de blé et de farine achetés en Hesbaye.
Le régime politique que Liège venait de se donner et que la cité conservera jusqu'aux grandes guerres contre les Bourguignons, repose donc, avant tout, sur l'omnipotence des corporations. A ce point de vue le corporatisme liégeois diffère profondément du corporatisme français, qui, comme l'a fait observer récemment un bon juge, vit assez en marge de la politique active. (E. COORNAERT. Les corporations en France avant 1789. Paris, 1941)
Malgré les guerres civiles ou, peut-être, à cause d'elles, la puissance des métiers n'a fait que croître au XIVème siècle. Ils visent au monopole à partir de 1343 on exige de tous les habitants pratiquant un métier déterminé, de se faire inscrire dans une corporation. Puis, la « lettre du commun profit » (24 mars 1370) stipule que tout bourgeois doit être inscrit dans un métier et, s'il n'en exerce aucun, dans la frairie des changeurs. C'était donc le corporatisme obligatoire et l'accès au métier était devenu la condition sine quiz non de l'accès à la vie politique. Pour réprimer les abus que cet état de choses pouvait entraîner - participation aux délibérations dans plusieurs métiers, brigues électorales, etc. - on créa une commission de trente-deux personnes, chargée de surveiller, à ce point de vue, les habitants de la cité et de réprimer toutes infractions aux règlements (19 juin 1373).
A l'extrême fin du XIVème siècle, vers 1398, un notable Liégeois, Jacques de Hemricourt (1333-1403), notaire public et secrétaire du tribunal des échevins, composa, entre autres oeuvres, un ouvrage intitulé Li patron, delle Temporaliteit. Il y entreprend de faire un tableau des institutions politiques de la principauté et de la cité. Laudator temporis acti, il ne peut cacher sa vive sympathie pour l'époque où le patriciat dominait à Liège; il n'a d'yeux que pour les preux chevaliers, n'admire que les grands coups d'épée et constate, avec regret, que, par suite de la diminution de l'humeur batailleuse, les combats duraient trois fois moins longtemps que dans sa jeunesse. D'opinion réactionnaire en politique, ennemi acharné du régime démocratique qu'il charge de toutes les tares, il déplore la constitution politique de la cité. Ses dires, qui manquent d'impartialité et parfois même d'exactitude, sont cependant intéressants parce qu'ils révèlent la mentalité du patriciat vaincu. Et puisque, par une sorte de fatalité, on ne possède aucun témoignage écrit favorable à la cause de la démocratie, nous verserons au dossier un passage de Hemricourt, quitte, rappelons-le, à ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire.
« Ly paiis dont je suy d'antiquiteit extrais et nouris ne puet longtemps demoreir en paix sens defoiiere (déterrer) et requeire (rechercher), de fait et de forche, noveliteis estraingnes, al encontre de son naturel saingnour et de ses justiches, en prejudiche de droit, de loy et de ses propres franchieses et liberteis anchienes, approvées tant par lettres imperiauls et regiauls, comme par usaige; dont si pesans, enormes et irrecuperables damaiges sont a dit paiis avenus pluseurs fois en homicides, arsiens (incendies), rapines et aultres diverses accidens, que by paiis s'en truve, en la fien, deçhuis, silhies (dévasté) et en maul (mauvais) point. Et tout che avient par le malvais et indiscreit regyment del citeit de Liege, qui est et eistre doit, ly chief de paiis de ma noureture, dont je ay parleit; laqueile citeit est cause de tous les mais avenus en paiis à mon temps et par quatres poins tant soillement (seulement), qui seroient legiers a remedier, se ly common peuple n'estoit si fort obstineis et avoileis (étourdi). »
« Veriteit est que tout fontaine de scienche et de sens natureil est a present en la dicte citeit. Mains, par envie, qui tout biens avilhist et retarde, ons n'en vuelt de riens useir quant al regiment de la dicte citeit touchant le bien common, si que dist ly livre de Polityke (la « Politique » d'Aristote); car ly nombre de cheaux qui sont povres de sens et d'avoir, dont ly quarte part n'est point del nation de la dicte citeit ne de paiis, que piis vault, est si grans que les saiges et les riches, qui sont borgois citains, ne puelent (peuvent) all'encontre d'yaux eistre creyus. »
Après cet exorde où l'auteur manifeste sa mauvaise humeur à l'égard de la cité, Hemricourt va entreprendre d'énumérer les quatre raisons qui, à son avis, sont causes du « déplorable » régime politique que connaît Liège.
« Ly promier est par tant que ly conseaul del citeit est trop large, car ilh y at bien deux cens personnes de conseilh... car multitude engenre confusion.
« Ly seconde est par tant que les petis mestiers, qui n'ont point de puissanche en la citeit, ne aux champs en temps de guerre, ont ortant (autant) de gens en conseilhe et ont ortant d'avaintaiges a faire une siiet (délibération), quant la citeit est ensemble, qu'ilh ont les fors et les honoraubles mestiers.
« Ly thiers est par tant que, quant ly universiteit de la dicte citeit est ensemble por alcun cas notable ou les mestiers sont ensemble per fair leur offichiens (dignitaires), les garchons servans et les apprendiches ont ortant de vois, en la suet faisant, comme ilh ont les maistres et les chiefs d'hosteit (de famille).
« Ly quars est par tant que les maistres et les mestiers de la dicte citeit prendent afforains borgois et les sortinent (favorisent) pour biensfais, contre le tenure del Lettre de Saint Jaqueme, et soy lassent la plus grande partie des offichiens corrumpre por argent. »
Telle était l'opinion d'un ennemi du régime sur l'organisation politique et sociale de la cité. Elle ne peut être retenue intégralement. Pour mieux comprendre ce régime d'omnipotence des métiers, fruit de plus d'un siècle de luttes sociales, il importe de montrer ce qu'est le métier, comment il fonctionne, comment il évolue.
Durant tout le XIVème siècle, on observe que les corporations complètent et changent constamment leurs statuts; celle des drapiers, par exemple, reçoit six règlements successifs de 1314 à 1386; celle des brasseurs, quatre, de 1357 à 1394; celle des orfèvres, trois de 1393 à 1400. Ces modifications sont la preuve d'une intéressante évolution sociale qui se produit à l'intérieur même des métiers. Jusque vers le milieu du XIVème siècle ces associations étaient animées d'un esprit assez libéral les maîtres et les compagnons y étaient mis sur le même pied et tous avaient droit de vote lors des élections dans le métier. A partir de 1350 un certain exclusivisme commence à se manifester, sinon dans tous les métiers, tout au moins dans ceux où la masse des compagnons était élevée par rapport au nombre de maîtres. C'est ainsi qu'un règlement du métier des drapiers, du 1er avril 1350, décide que le droit de vote dans le métier sera, désormais, réservé uniquement aux maîtres et que « nuls varleis servans ne ovrans par journée ne par quartiers en notre dit mestier n'aient ne n'aront dors en avant vois d'enliere officiiens dele citeit de Liege partenant a notre dit mestir, mais quant ons ferat lez diz officiiens auz jours deputeis et acoustumeis, li maistres drappiers, li maistres tesseurs (tisserands) et li maistres folons trairont ensemble et enlieront tous les officiiens partenans a notre dit mestier les plus ydones et suffisantes que ilh saront en notre dit mestier. »
Les maîtres-patrons se montrent de plus en plus méfiants à l'égard des compagnons et des apprentis; leur esprit de classe s'affirme de jour en jour et ils poursuivent l'ouvrier, oublieux de ses devoirs, en dehors même de la cité. En 1348 on voit les métiers des fèvres de Liège et de Huy s'engager réciproquement à ne pas employer des valets et apprentis qui n'auraient pas tenu les engagements contractés avec leurs premiers maîtres et qui, pour cette raison auraient émigré d'une ville à l'autre. Par un curieux renversement des choses, les maîtres agissent de la même manière que certains patriciens au siècle précédent, car l'attitude des fèvres liégeois et hutois n'est pas sans rappeler celle que prirent, en 1274, les patriciens d'Anvers, Bruxelles, Lean, Lierre, Louvain, Malines et Tirlemont lorsqu'ils s'engagèrent vis-à-vis du magistrat de Gand à ne pas donner asile aux foulons et tisserands gantois, coupables d'avoir comploté contre le patriciat. Attitude qui montre combien les manifestations de solidarité de classe sont indépendantes de l'appartenance nationale ou ethnique
A partir de la seconde moitié du XIVème siècle les métiers liégeois ont aussi une tendance à se fermer; à cette fin on exige de celui qui désire s'y faire inscrire un droit d'entrée dont le taux s'élève graduellement plus on avance dans le temps. Rien de plus caractéristique à cet égard que ce qui s'observe dans le sein du métier des toiliers; son statut du 20 février 1369 ne fixe pas encore de droit d'entrée, mais celui du 10 juillet 1385 stipule qu'il y aura désormais à payer un droit d'entrée de cinq vieux écus et cette taxe se monte à dix vieux écus dans les statuts du 20 mai 1404. De même, le métier des brasseurs exige, le 15 avril 1381, un droit d'entrée de six vieux écus d'or. Les pelletiers agissent de même le 30 août 1381 ainsi que les vieux-wariers ou fripiers, le 18 janvier 1389. On pourrait multiplier ces exemples.
Cet exclusivisme se manifeste, plus âprement encore, à l'égard de ceux des ouvriers qui ne sont pas Liégeois; en 1393 les orfèvres déclarent « que nuls d'estrainghe pays ne doit y estre rechus en leur meatier s'il ne paie a se entree XVI viez royaux et... que cel estraignier aportent lettrez scelleez de leur prestez ou autrement ne seroient point rechut au dit mestier ». Même note chez les brasseurs qui, en 1399, « ordennent tres grans deniers a payer par ceux estraignes qui entrer voroient en leur dit meatier et ossi sour lez aprentis de dehors et de dedens ».
Ce sont là manifestations d'un phénomène social bien connu et que la sociologie observe à toutes les époques de l'histoire. On sait que tout groupe social hiérarchisé - et c'est le cas des corporations - a tendance à se clore en dressant autour de lui des barrières, de manière à pouvoir s'affirmer vis-à-vis des classes concurrentes. A cette fin, il tend à rendre son recrutement malaisé, voire impossible en dehors de la dévolution héréditaire. Les corporations n'ont pas agi autrement, à cet égard, que le patriciat ou la noblesse.
Plus, le régime corporatif s'impose et plus le métier réglemente strictement le travail, la technique, les attributions des différentes catégories d'artisans. Le repos du samedi après-midi est déjà imposé dans certains métiers dès 1374 et 1377. Des peines sanctionnent toutes les infractions aux règlements; un membre du métier des meuniers est, en 1390, « bouttez hors don mestier... por sez demerites ». Les corporations veillaient même à ce que la réputation d'honorabilité de leurs membres ne pût être mise en question; en 1394 les entretailleurs de draps fixent une amende pour ceux d'entre eux qui quitteraient « une taverne sans payer leur escot » et, en 1397, les vignerons décident d'exclure de leur sein ceux qui commettraient des larcins en travaillant dans les vignobles d'autrui.
Cet exclusivisme, ce particularisme et et esprit de réglementation prouvent le désir des maîtres-patrons de s'assurer un monopole économique, au détriment, s'il le faut, des compagnons et des apprentis. Cette tendance, qui grandira encore au XVème siècle, aboutira finalement à la création d'une sorte de prolétariat dans certains métiers et explique, en partie, le paupérisme endémique qui a sévi durant tout l'Ancien Régime.
La « démocratie » liégeoise est donc une démocratie de petits bourgeois, petits patrons et petits entrepreneurs qui, ayant conquis une indépendance économique et une influence politique, tendent, dès le milieu du XIVème siècle, à se réserver excIusivement les avantages sociaux, fruits d'une lutte longue, pénible et opiniâtre. Au moment même où, sur le plan politique, Liège devient une démocratie, elle cesse d'en être une sur le plan social, pour devenir une oligarchie.
APPENDICE.
Les idées politiques et sociales d'un chanoine liégeois au XIVe siècle: Jean de Hocsem.
Rien n'est plus difficile, surtout pour l'époque qui retient spécialement notre attention ici, que de se rendre compte des opinions qu'ont eues et des sentiments qu'ont ressentis les hommes d'autrefois. Et cependant c'est la connaissance de leur mentalité qui nous mettrait le mieux à même d'atteindre la vérité historique et d'apprendre, selon le mot de Ranke « wie es eigentlich gewesen ist ». Or, un heureux hasard a fait qu'un « intellectuel » liégeois du XIVe siècle, nous a laissé, sur ses conceptions politiques et sociales, un témoignage complet et sincère. Il s'agit de Jean de Hocsem, chanoine du chapitre de Saint-Lambert et auteur d'une chronique qui retrace, en ordre principal, l'histoire des événements dont Liège fut le théâtre de 1246 à 1348.
Ce personnage était né à Hougaerde, dans la province actuelle de Brabant, en 1279; destiné à la cléricature, il fréquenta l'école de bonne heure; à dix-huit ans il alla continuer ses études à l'université de Paris, puis suivit, durant quatre ans, les cours de droit à l'université d'Orléans. Son séjour en France se prolongea encore durant quelques années, puis Hocsem, revenu au pays natal, reçut un bénéfice dans l'église Saint-Germain de Tirlemont; en 1315 il devint chanoine à Liège et y fut bientôt chargé d'importantes fonctions: official, prévôt de Saint-Pierre, écolâtre de Saint-Lambert, il s'éleva, en peu de temps, à un rang en vue dans le clergé liégeois. Juriste expert et renommé, il intervint, au nom du chapitre, dans les luttes incessantes soutenues par ce corps ecclésiastique contre la ville de Liège. Il eut donc l'occasion d'approcher les acteurs des événements qui agitaient la cité et il joua un rôle important dans les négociations entre le prince-évêque et ses sujets. « Durant plus d'un quart de siècle il a été le secrétaire du chapitre et toutes les affaires importantes ont passé par ses mains ». Bien documenté et bien informé, mais porté tout naturellement à considérer les faits en fonction des intérêts exclusifs du clergé et du chapitre de Saint-Lambert, il a pris la plume en 1334 et a poursuivi la rédaction de sa chronique jusqu'à la veille de sa mort, survenue le 2 octobre 1348. Il est témoin oculaire des faits à partir de 1309; quant à la période antérieure, il la connaît par des documents nombreux, réunis par ses soins; mais il, juge souvent les individus et les événements du XIIIe siècle avec la mentalité d'un homme du XIVe siècle.
Cette rapide esquisse de la carrière de Hocsem en dit assez pour montrer l'intérêt de son oeuvre. Dans un passage de sa chronique il s'est laissé aller à nous exposer ses vues personnelles en matière de politique et de vie sociale. Témoignage fort rare à une époque où les auteurs ne livrent généralement rien d'eux-mêmes et où les mieux informés ne trahissent presque jamais leurs sentiments. Les opinions de Hocsem sur le meilleur mode de gouvernement, sur la politique en général et sur les diverses modalités d'organisation sociale, sont celles d'un homme intelligent et instruit qui a une vision réaliste des choses, mais qui, en même temps, est fortement influencé par sa condition de clerc, par son milieu et par son éducation.
Hocsem est nourri de philosophie scolastique et de science juridique. Aussi recourt-il tout naturellement, dans l'exposé de sa doctrine, à Aristote, quant au fond, à la subtilité juridique romaine, quant à la forme. Mais les événements auxquels il a été mêlé à Liège ont également réagi sur son comportement; il y fait de fréquentes allusions et il tente, non sans pédantisme, de les expliquer en fonction de la doctrine aristotélicienne. En résumé, Hocsem considère les rois comme des tyrans, les démocraties urbaines comme des régimes anarchiques, les patriciats comme des oligarchies égoïstes; son idéal, en matière politique ce serait « un gouvernement de l'élite des bons citoyens, qu'il se figure d'ailleurs nombreux et non clairsemés, comme dans les régimes aristocratiques ».
Il faut cependant se souvenir que, comme tous les hommes du moyen âge, Hocsem n'a pas le sens du relatif et qu'il lui manque donc une vision historique exacte. Il n'éprouve pas le besoin de faire une enquête objective sur les causes et les origines des phénomènes sociaux; de gré, ou de force il les fait entrer dans les cadres de la pensée aristotélicienne, au risque de les dénaturer complètement. Il affuble d'une défroque antique et scolastique les événements de son temps et il en résulte un tableau très curieux sinon toujours très clair, un mélange pittoresque de science politique grecque, de juridisme romain, de théologie catholique, de méthodologie scolastique, le tout saupoudré d'une 'bonne dose de pédantisme. Ajoutons enfin, que le style de Hocsem est rocailleux au possible et très amphibologique; jamais sa pensée ne se dégage clairement et souvent il ne fait pas de nécessaires distinctions entre certains termes, au point de confondre, par exemple, démocratie avec démagogie.
Tel quel le témoignage de Hocsem est cependant précieux et, pour donner au lecteur une idée de sa « manière », nous reproduirons ici, en une paraphrase simplifiée, l'essentiel de ses conceptions en matière politique et sociale. Il importe, toutefois, de se rappeler qu'au point de vue intellectuel, Hocsem, comme tous ses contemporains, est imbu du principe scolaire du magister dixit. Il entend, dès l'abord, faire appel à l'opinion d'un auteur antique, sous l'autorité duquel il se range; il s'agit, en l'espèce, d'un passage de l'écrivain romain Végèce (IV siècle après J.-C.) qui ne fait que reproduire un chapitre de la Politique d'Aristote. Hocsem, qui ignore le grec, commence par recopier ce texte latin qui lui fournit l'essentiel de la pensée du philosophe de Stagire et va en déduire ensuite toute une série de considérations et de conclusions. Ecoutons-le disserter:
« Végèce, dans le deuxième chapitre de son livre « Abrégé de l'art militaire » nous apprend que les peuples, fixés dans les zones de climat chaud sont habitués à la sécheresse et que, partant, ils ont peu de sang; il en résulte qu'ils sont d'un naturel calme et assuré; ils n'aiment pas de se battre parce que, ayant peu de sang, ils craignent que des blessures ne le leur fassent perdre. Par contre les peuples du Nord qui vivent loin des ardeurs du soleil, sont moins réfléchis, ont du sang en abondance et sont très prompts à faire la guerre. Cette pensée, Végèce l'a trouvée dans Aristote. On en peut conclure que, dans le Midi, le peuple ne se soulève pas aisément contre les rois et les tyrans; il accepte plutôt de vivre dans la paix et de servir son maître. Quant aux peuples du Nord - et le nôtre en est un - ils refusent de subir une autorité qui leur paraît injuste; aussi, chez nous, le régime du gouvernement est-il fréquemment changé. »
« Aristote, dans son troisième livre de la Politique, a exposé qu'il y a trois modes de gouvernements possibles: celui dans lequel un seul homme est le maître, celui où domine la masse des pauvres, celui où un petit nombre d'hommes riches exerce le pouvoir. De chacun de ces trois modes, il peut exister deux variétés, puisque le pouvoir suprême peut être exercé soit en bien, soit en mal; si l'autorité est aux mains d'un seul homme et s'il se trouve qu'il est un bon chef d'Etat, on appellera cet homme roi ou prince; par contre, s'il est mauvais chef, préoccupé seulement de ses propres intérêts et non de ceux de ses sujets; on dira qu'il est un tyran. Si la cité est gouvernée par de nombreux citoyens honnêtes et instruits on donnera à pareil régime le nom de démocratie ou république, et c'est là le meilleur des gouvernements. Mais si, au contraire, ce régime manque de discipline, il sera dit démagogie. Enfin si le pouvoir est détenu par un petit nombre d'individus sages et honnêtes, il méritera le nom d'aristocratie, tandis que, si ce petit nombre d'hommes ne recherche que son propre avantage sans se préoccuper du bien public, on doit qualifier cette organisation d'oligarchie. »
« Ainsi donc il existe, comme le dit Aristote, six formes possibles de gouvernement. De chacune de ces formes il est loisible de fournir un exemple: de la première, le règne de Romulus, grâce auquel la puissance romaine a commencé à croître; de la deuxième, l'attitude de Tarquin le Superbe et de tous les rois qui vivent aujourd'hui; de la troisième, le régime implanté à Rome après la chute des rois et l'instauration des cinq tribuns, comme on le lit au Digeste; de la quatrième on voit, de nos jours, un exemple partout où le peuple gouverne seul; de la cinquième est représentative l'époque des sept sages d'Athènes, comme nous l'apprend Valère-Maxime; de la sixième enfin on trouve un modèle là où le pouvoir est entre les mains de quelques échevins ou d'un petit nombre d'hommes riches. »
« Toutefois ces différentes formes de gouvernement se combinent entre elles de sorte qu'on n'en trouve jamais une seule à l'état pur et qu'il est très difficile d'arriver à un juste équilibre et de rencontrer la solution intermédiaire c'est-à-dire la meilleure. De même que dans le tempérament humain on distingue quatre éléments qui tous sont nécessairement réunis chez tous les corps, de même on voit actuellement chez nous un évêque et une poignée d'hommes riches partager, de manière égale, le pouvoir avec la masse populaire. (En effet avant la victoire remportée par l'évêque Adolphe de la Marck, le peuple avait exercé seul l'autorité dans notre cité pendant une durée de quatorze ans.) Mais ces gouvernements mixtes ne subsistent pas longtemps et ceci pour deux raisons: d'abord, parce que le peuple veut toujours, contre toute raison, réaliser l'égalité absolue - il condamnera, par exemple, tous les délinquants à la même peine, sans tenir compte de leur rang et qualité respectifs - ensuite parce que les riches recherchent avec excès les honneurs. Or, ainsi que le dit Aristote au livre cinquième de sa Politique, l'égalité se présente sous un double aspect quantitatif et qualitatif. Si les riches étaient animés de l'amour du bien public, ils auraient raison de faire bande à part contre le populaire qui recherche l'égalité pure et simple, - car l'inégalité entre eux et lui est fondée sur la raison, le riche étant plus utile à l'Etat que dix paysans, puisqu'il sert l'Etat en mettant à sa disposition ses chevaux et ses gens de dépendance, tandis que le plébéien est tout seul. »
« La noblesse et l'honnêteté étant des qualités rares, les citoyens dotés de pareilles vertus sont peu nombreux. Les pauvres, eux, sont légion; à cause de cela même ils veulent, proportionnellement à leur nombre, avoir une part prépondérante dans le gouvernement de l'Etat. Or les riches qui disposent de beaucoup plus de moyens que les pauvres, refusent de les laisser participer à la gestion de la chose publique. Ainsi oligarchie et démagogie sont deux exécrables régimes. Des deux, l'oligarchie est cependant la pire; en effet, les oligarques ne se contentent pas de faire la guerre au peuple, ils la font aussi entre eux, comme nous l'avons vu dans notre propre cité, tandis que le peuple se borne à lutter contre les grands et ne se déchire pas lui-même. Dans l'un et l'autre de ces régimes se produisent donc fréquemment des émeutes; si le peuple l'emporte il exerce le pouvoir jusqu'à ce qu'il en soit chassé par une nouvelle révolution. En tout état de cause, l'autorité n'est jamais exercée que par ceux qui rêvent d'injustice. »
« Aristote décrit également les précautions que prennent les tyrans et les oligarques pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir, tout en retenant le peuple sous leur domination. Mais si les princes et les grands gouvernaient équitablement les masses, celles-ci ne provoqueraient jamais de commotions; en effet, préoccupées avant tout de chercher leur subsistance, elles ne tenteraient jamais les premières à s'emparer du pouvoir. Avant le règne de l'élu Henri de Gueldre, les habitants de Liège ne se sont jamais révoltés, par crainte de la puissance impériale. Mais après la déposition de l'empereur Frédéric II, l'empire fut à l'abandon; à la place d'un roi ou d'un tyran on vit alors surgir mille tyranneaux. Dans nos régions chaque cité se mit à exercer la tyrannie, dont démagogie et oligarchie ne sont que des variétés. »
« Mais revenons en maintenant à notre sujet. »
1176-1184, création du conseil des jurés.
Fin du XIIe siècle, charte du prince-évêque Albert de Louvain ou Albert de Cuyck, accordant des franchises et des privilèges aux bourgeois de Liège.
1208, juin, construction d'une halle pour les tisserands par Louis Surlet.
1253-1256, activité politique de Henri de Dinant dans la cité.
1255, octobre, paix de Bierset.
1287, 7 août, paix des Clercs.
1288, 4 mai, première mention d'un métier - celui des tanneurs - à Liège.
1383, entre le 29 avril et le 15 mai admission des représentants des métiers dans le conseil des jurés.
1307, 20 août, paix de Seraing.
1308, 7 mai, ordonnance du prince-évêque Thibaut de Bar.
1312, 3 août, le mal Saint-Martin.
1313, 14 février, paix d'Angleur.
1313, 16 avril, avênement du prince-évêque Adolphe II de La Marck.
1316, 18 juin, paix de Fexhe.
1328, 25 septembre, bataille de Hoesselt.
1328, 4 octobre, paix de Wihogne.
1330, 1 juin, paix de Flône.
1331, conspiration de Pierre Andricas.
1331, 10 juillet, Réformation d'Adolphe » dite aussi loi du murmure.
1343, 1er juillet, lettre de Saint-Jacques.
1345, 23 février, avènement du prince-évêque Englebert de La Marck.
1347, 21 juillet, bataille de Waleffe.
1347, 28 juillet, paix de Waroux.
1348, 2 octobre, mort de Jean de Hocsem.
1370, 24 mars, lettre du Commun profit.
1384, les patriciens cessent de faire partie du conseil des jurés.
V. 1398, Jacques de Hemricourt compose le « Patron delle Temporaliteit ».
|
|



