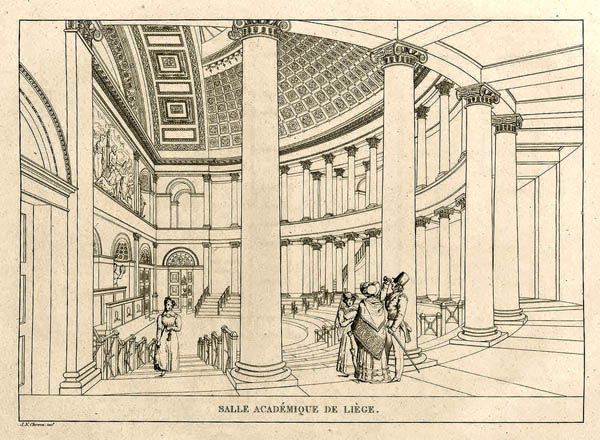
INTRODUCTION
Il est d'usage dans les Universités, de temps immémorial, de jeter à certains moments un regard en arrière, de mesurer le chemin parcouru, de se livrer en quelque sorte à un examen de conscience. On choisit pour cela le retour d'une date mémorable, l'anniversaire de la fondation de l'établissement, par exemple; on célèbre une fête de famille, on rattache le présent au passé, puis on publie les fastes universitaires, ce que les Hollandais appellent un Gedenkboek et les Allemands un Denkschrift. C'est ainsi que Valère André a recueilli, au XVIIe siècle, les souvenirs des deux premières centuries de l'ancienne Université de Louvain; c'est ainsi que tout récemment, en 1864, M. le recteur Jonckbloet a mis au jour un travail très complet sur celle de Groningue. Il nous serait facile de mentionner vingt autres ouvrages du même genre, si l'utilité de l'entreprise que nous tentons sous les auspices du Conseil académique de Liège avait besoin de justification. Nous n'avons à cet égard qu'une inquiétude: celle de n'avoir répondu qu'imparfaitement à l'attente de nos honorables collègues.
Nous n'avons pas eu la prétention d'écrire une histoire proprement dite de l'Université de Liège; nous nous sommes contenté de rassembler des notices et des renseignements sortant du cadre obligé des publications officielles. Il nous sera permis cependant, avant d'entrer en matière, d'esquisser les traits généraux du tableau d'ensemble que nous aurions voulu peindre, si la discrétion n'avait pas imposé des bornes à notre zèle, et si nous ne nous étions cru strictement lié par les termes précis de notre mandat.
L'histoire des Universités belges depuis 4817, ou seulement celle de l'une d'entre elles, offrirait un vif intérêt, d'une part à cause du rôle qu'elles ont joué avant la révolution de 1830, de l'autre à cause de la situation particulière qui a été faite depuis lors, en Belgique, à l'enseignement supérieur. On y verrait à quels mécomptes s'est exposé un prince animé d'intentions loyales, mais « trop libéral pour être roi, et trop roi pour être libéral » (1); on y apprécierait la prudence du Congrès national de 1831, qui donna satisfaction aux pétitionnaires de 1828, en proclamant la liberté illimitée de l'enseignement, mais qui en même temps, pour assurer la liberté des études en même temps que celle des propagandes, décréta qu'il y aurait un enseignement donné aux frais de l'État; on y serait en présence des difficultés nouvelles qu'a fait surgir la terrible question de la collation des diplômes; on s'y convaincrait enfin de l'urgente nécessité de laisser chaque Université vivre de sa vie propre, devenir exclusivement responsable de ses actes, résultat qui ne sera obtenu que par la séparation complète du jury et de l'enseignement. Mais, encore une fois, ce n'est pas une semblable étude que nous abordons: c'est le développement intérieur de l'Université de Liège qui nous touche exclusivement; c'est son caractère distinctif, son attitude si l'on veut, que nous essayerons de dégager, en nous attachant aux hommes qui l'ont personnifiée et qui la personnifient encore, plutôt qu'aux vicissitudes de la législation.
Il n'a pas été possible d'établir dans notre pays, comme on l'avait généreusement rêvé, une Université unique. La préoccupation de l'équilibre a dominé toute autre considération: il y avait deux Universités libres; deux Universités de l'État ont paru indispensables. D'un autre côté, le système de la centralisation est antipathique à notre esprit national: on a voulu avoir égard aux différences de race et de langue. C'est ainsi que chacune de nos quatre Universités a sa raison d'être et sa physionomie bien tranchée: celles de Bruxelles et de Louvain représentent les deux grandes opinions qui se disputent la majorité au Parlement; celles de Gand et de Liège, les deux groupes de la population belge, non assimilés l'un à l'autre, mais intimement unis par le pacte constitutionnel.
L'uniformité des lois qui régissent les deux Universités de l'État n'a point fait et ne saurait faire disparaître les caractères saillants de leur individualité respective. Elles répondent aux mêmes besoins généraux; mais, installées aux deux pôles de la Belgique, s'adressant à des populations dont les instincts, les traditions, les tendances, les éléments de richesse ne sont point les mêmes, elles se ressemblent tout juste assez pour qu'on les reconnaisse comme des soeurs:
Facies non omnibus una,
Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.
Veut-on les bien connaître? C'est sur leur propre terrain qu'il faut les étudier. Leur prospérité, leur vitalité, la direction même qu'elles impriment aux études tiennent sans doute à leur constitution légale, mais tout autant, pour le moins, aux égards qu'elles ont pour l'esprit public. Introduisons donc tout d'abord le lecteur dans le milieu où respire l'Université de Liège.
Une excursion dans le passé, même le plus lointain, ne sera pas un hors d'oeuvre. Les provinces de l'Est de la Belgique ont constitué, jusqu'à la fin du siècle dernier, une principauté indépendante, doublement isolée des États limitrophes par sa Constitution toute particulière et par le caractère ecclésiastique de ses Souverains. On se méprendrait sur le sens des aspirations des Liégeois, sur la ténacité de leurs répugnances, sur l'idéal qu'ils se font de la liberté, sur les mobiles mêmes de leur zèle pour la diffusion des lumières, si l'on négligeait de tenir compte de l'héritage de dure expérience que leur ont légué leurs ancêtres.
La société influe sur l'école et l'école réagit sur la société: c'est une vérité banale; mais c'est à la lumière des vérités banales qu'on pénètre au fond des questions. Quel était en 1817 l'état intellectuel de la population liégeoise? Comment et en quel sens l'Université a-t-elle contribué à l'émanciper, à modifier les idées reçues, à élargir l'horizon des esprits? A coup sûr ces problèmes ne manquent ni d'intérêt ni même de nouveauté. Efforçons-nous donc d'en rassembler les données.
I
En considérant le droit d'enseigner comme un droit régalien (2) les empereurs romains convertis au christianisme ne firent que consacrer une maxime antique. Mais les idées se transformèrent à mesure que les écoles païennes tombèrent en décadence et que les études théologiques absorbèrent toutes les préoccupations des hommes éclairés. L'enseignement devint, en fait, une des hautes prérogatives de l'Eglise. A l'ardeur du premier zèle succéda pourtant une mortelle langueur. Les écoles fondées par les évêques s'étaient enrichies de l'héritage des écoles laïques; elles avaient fleuri tant qu'il y était resté quelque chose des traditions classiques: tout d'un coup les lettres profanes parurent suspectes, et un moment vint où l'ignorance des clercs n'eut d'égale que leur grossièreté. Le VIIe siècle marque dans l'histoire comme une époque de chaos, de violences et de licence; les guerres continuelles, la misère générale perpétuèrent cet état de choses jusqu'à l'avènement de Charlemagne, dont la forte main ressaisit le pouvoir que les derniers empereurs romains avaient abandonné.
Charlemagne dirigea l'enseignement par le clergé; ses successeurs Louis le Débonnaire et Charles le Chauve firent comme lui. Lorsque l'empire se démembra pour faire place au système féodal, l'enseignement redevint, pour des siècles, l'apanage et le domaine exclusif du pape et des évêques. « Les nouveaux souverains érigés par la féodalité se gardèrent de tourner leurs vues de ce côté. Contents des droits de justice, de guerre, de monnaie et autres, qui ajoutaient à leurs richesses et leur faisaient goûter le pouvoir sous sa forme matérielle et lucrative, ils ne comprenaient rien aux influences morales au nombre desquelles l'enseignement tient le premier rang. Ils laissèrent donc la propriété de ce grand droit au clergé, qui en sentait seul la puissance pour régir les peuples. Dans un temps d'ailleurs où l'Etat ne se sentait plus comme le faisceau un et indivisible de toutes les forces sociales; où la puissance publique, lacérée en mille fragments, comptait autant de représentants que de propriétaires de ses lambeaux; où les privilèges réguliers, inféodés à titre héréditaire, étaient disséminés çà et là suivant les bigarrures les plus diverses et les caprices les plus bizarres, il était tout au moins logique que l'Eglise conservât, comme son patrimoine exclusif, les écoles dans lesquelles venaient se former tous ceux qui aspiraient au titre de clerc et composaient son immense milice » (3).
Or, à Liège, il arriva que le pouvoir temporel échût aux chefs du diocèse. L'Etat s'y trouva donc maître de l'enseignement, par cela même que l'enseignement relevait du clergé. Aux Xe et XIe siècles, aucune circonstance n'aurait pu favoriser plus efficacement le progrès des études; plus tard, ce même régime devait l'enrayer et même y être hostile. A ce point de vue, l'histoire de l'instruction publique à Liège est exceptionnellement instructive: elle fait apprécier ce qu'il en coûte à une nation de rester trop longtemps en tutelle.
Berceau des Carlovingiens, notre pays fut toujours, de la part de leur plus illustre représentant, l'objet d'une affection vraiment filiale (4), Une lettre adressée à l'évêque Gerbalde (Garibaldus) témoigne de l'intérêt que portait Charlemagne à la bonne éducation du clergé liégeois. Il est certain que, dès son temps, des écoles furent érigées à côté de la cathédrale de St-Lambert; mais somme toute, si elles répondirent jamais à l'attente du régénérateur des études, leur éclat fut singulièrement éphémère. L'évêque Francon de Tongres essaya de les relever forcé de prendre l'épée pour combattre les pillards normands, il n'eut pas le temps d'achever son oeuvre. Le règne d'Eracle fut au contraire le point de départ d'une ère brillante. Eracle trouva les clercs plongés dans une ignorance profonde et n'ayant nul moyen d'en sortir: il prit pour type de ses réformes la célèbre école de St-Martin de Tours, qui avait possédé Alcuin, fit venir de l'étranger, à grands frais, les professeurs les plus distingués, et s'appliqua tout à la fois à fortifier les études ecclésiastiques et à y rattacher l'enseignement des lettres et des sciences (5). Ce que Tours était pour la France, ce que Fulde était pour l'Allemagne, Liège le devint bientôt pour les contrées intermédiaires. L'école de St-Lambert s'éleva même au premier rang (6) sous Notger (997-1008), qui y importa les traditions savantes de son couvent de St-Gall et en fit une pépinière de professeurs: la France, la Germanie et jusqu'aux pays slaves en ressentirent l'influence. Pour la première fois, des cours spéciaux furent institués à l'usage des laïcs et l'instruction se donna en langue vulgaire (7). Notger enseigna lui-même; son activité politique et militaire ne lui laissa jamais oublier ses chers élèves: dans ses excursions, si longues qu'elles fussent, il en emmenait toujours quelques-uns avec lui; leurs études achevées, il restait leur ami et leur protecteur dévoué; il était leur hôte affectueux, comme celui des lettrés étrangers qui affluaient à sa cour. Par contre, il tenait à recueillir le fruit de ses efforts. « Hubold, chanoine de notre cathédrale, après avoir enseigné à Paris et avoir formé, en peu de temps, une foule de disciples, fut, sous peine d'excommunication, obligé de venir professer dans sa patrie: Notger ne voulait pas laisser perdre pour elle des talents qui devaient l'enorgueillir » (8).
Wazon, monté sur le trône épiscopal en 1042, resta fidèle aux traditions de ses prédécesseurs. On lui doit, entr'autres, la fondation de l'école de St-Barthélemy, où se distingua plus tard AIgerus, l'adversaire de Bérenger de Tours. Le zèle de Wazon était sans bornes: non seulement il voulut que l'enseignement fût gratuit à St-Lambert, mais il fournit des éléments de subsistance aux étudiants pauvres. Il visitait assidûment les classes, interrogeait sur les Ecritures saintes les élèves avancés, les plus jeunes sur Donat et Priscien, engageait volontiers des discussions avec les uns et les autres et professait la maxime: que mieux vaut être vaincu rationnellement que vaincre arbitrairement. Adelman, célèbre avant Algerus par ses écrits sur
l'Eucharistie, remplaça Wazon dans l'écolâtrie de St-Lambert. On cite encore Francon de Cologne, qui a droit à une page dans l'histoire de la musique; Egbert, l'auteur des AEnigmata rusticana; Gozechin, qui, retiré à Mayence après avoir enseigné à Liège les humanités et la philosophie, ne cessa toute sa vie de regretter la Fleur des trois Gaules, la moderne Athènes, etc., etc. Les écoles des monastères méritent aussi une mention: en un mot, dans tout le cours de cette période, Liège rayonna comme un phare au milieu des ténèbres.
Mais quand éclata la querelle des investitures, ce qui avait donné vigueur aux écoles de Notger et de Wazon, c'est-à-dire la réunion des deux pouvoirs sur une même tête, fut précisément pour ces institutions une cause de ruine. Relevant la fois du pape et de l'empereur, les princes-évêques se virent mis en demeure d'opter, et cette alternative périlleuse détourna forcément leur attention de l'oeuvre commencée avec tant de ferveur. La splendeur naissante de l'Université de Paris, cette « chevalerie intellectuelle, » attira d'autre part l'élite de la jeunesse vers la montagne Ste-Geneviève; les écoles des cathédrales et des abbayes, de moins en moins fréquentées, finirent par ne plus recevoir que les aspirants à la prêtrise; enfin l'émancipation des communes rendit nécessaire la création de nouveaux établissements, où le magistrat eut sa part d'intervention. A part quelques controverses inévitables dans une période transitoire, il faut dire qu'une entente cordiale continua de régner entre clercs et laïcs; mais les deux faits essentiels à noter, c'est que les hautes études se déplacèrent et que les classes laborieuses furent appelées à profiter des bienfaits de l'instruction. L'école de St-Lambert dépérit peu à peu; ou n'en trouve plus de trace après le XIIIe siècle. Son rôle était fini. Des bouleversements passagers qui coïncident avec la fièvre des croisades sortit une société régénérée. Tandis qu'une partie de la noblesse allait ensanglanter les champs de l'Orient, l'Eglise attirait dans son sein, par l'appât de riches bénéfices, les fils de grande famille restés en Europe, et ainsi les seigneurs commençaient à ne plus dédaigner de savoir lire et écrire. Elevés d'abord à l'ombre des cathédrales, ils fréquentèrent ensuite les Universités et quelquefois y brillèrent (9). Cependant, à côté des anciennes écoles qui perdaient insensiblement leur renommée, de modestes institutions communales ou chapitrales se formaient et grandissaient chaque jour: ouvertes aux enfants des bourgeois, elles coopérèrent puissamment, de leur côté, à la transformation sociale. Le Tiers-Etat réclamait hautement l'instruction; la langue nationale secouait le joug du latin; les gens des communes, admis à prendre part à l'administration, entendaient ne plus dépendre que d'eux-mêmes; le développement de l'industrie et du commerce, l'extension croissante des relations provoquaient dans la classe moyenne un immense besoin d'indépendance et importaient dans le pays des idées nouvelles; enfin, les arts et la littérature devenaient laïques et populaires, et le clergé se voyait en présence d'une opposition satirique de plus en plus hardie. Les écoles élémentaires répondaient aux exigences de la situation: elles ne formaient pas des savants, mais des hommes émancipés et prêts à suivre l'exemple des plébéiens de Rome. C'est ainsi que la commune revendiquait pour elle-même, au profit d'un élément social jusque là compté pour rien, le droit que l'Eglise, confondue ou non avec l'Etat, paraissait avoir usucapé à jamais.
On possède peu de renseignements sur l'état de l'instruction publique à Liège dans la première partie du XIVe siècle. Pétrarque décerne une mention honorable à notre clergé (10); mais lui-même déclare, dans un autre endroit de ses oeuvres (11), que s'étant rendu à l'abbaye de St-Jacques pour y copier un manuscrit de Cicéron, il ne put se procurer à Liège que de l'encre tellement vieille, qu'elle avait pris une couleur de safran (12). Quoi qu'il en soit, l'opulence et le faste des dignitaires de l'Église faisaient tort à leur zèle pour l'étude; en outre, le pays était déchiré par des querelles de famille, et la capitale voyait se renouveler, sur un théatre restreint, les agitations des anciennes républiques. On vivait au dehors, dans le tourbillon des fêtes, des combats et des émeutes: tout contribuait à rendre solitaire les parvis du temple de la science. Cette époque vit fleurir Jean-d'Outremeuse, le naïf chroniqueur; Jean Le Bel, le maître de Froissart; Jacques de Hemricourt, un miroir de chevalerie. Mais ce sont là de rares exceptions, et la peinture même qu'ils nous ont laissée de leurs contemporains, prouve que les temps étaient bien changés depuis le bon Wazon. Il faut arriver à l'établissement des frères de St-Jérôme à Liège pour retrouver quelque apparence de discipline classique tant soit peu régulière: encore la nouvelle institution dut-elle être supprimée en 1428, à cause des abus qui s'y étaient glissés (13); il parait qu'on y faisait trop bonne chère. Rétablie en 1495, sous les auspices de la maison de Boisle-Duc, elle mérita au contraire l'estime générale. On y compta plusieurs bons maîtres, entr'autres Macropedius, venu d'Utrecht, et Arnold d'Eynatten, dont Jean Sturm, le célèbre fondateur des hautes écoles de Strasbourg, s'honore dans ses écrits d'avoir été le disciple (14). Les Hiéronymites ou Frères de là vie commune poursuivaient un triple but ils avaient de petites écoles gratuites pour les enfants du peuple; ils poussaient aux études savantes ceux qu'ils trouvaient capables de les entreprendre; enfin, ils s'occupaient avec zèle de la transcription des manuscrits (15). Leur action fut généralement salutaire, surtout à mesure qu'ils renoncèrent aux tendances purement ascétiques de leurs premiers fondateurs. Leur enseignement ne perdit jamais son caractère religieux; mais il se transforma entièrement sous l'influence de quelques-uns de leurs élèves, tant Allemands que Hollandais, qui visitèrent l'Italie au commencement du XVIe siècle (16). Ils rompirent directement en visière avec le système d'éducation des scolastiques: dans la dernière période de leur existence, cette réaction eut pour effet de répandre en Allemagne et chez nous le goût des chefs-d'oeuvre de l'antiquité; à ce titre, on peut les ranger au nombre des précurseurs de la renaissance des lettres.
Il suffira de mentionner en passant la fondation de l'Université de Louvain (1426), où les Liégeois, de même que les autres Belges allèrent désormais compléter leurs études, au lieu de se rendre à Paris, à Cologne ou à Padoue. On se plait ordinairement à vanter ce résultat; on répète bien haut que notre pays commença dès lors à ne plus compter sur l'étranger. Matériellement, on peut voir là un avantage; mais au point de vue des idées, il ne serait pas impossible de soutenir que l'enseignement de l'Alma mater fut en somme très-peu national. En tous cas, il ne fut jamais civilisateur: il habitua les esprits à prendre les mots pour les choses et les subtilités de la dialectique pour la véritable science. L'Université de Louvain jeta sans doute un grand éclat; elle put être fière à bon droit de Busleiden, de Louis Vivès, de Juste-Lipse, de Puteanus, du jurisconsulte liégeois Wamèse et de bien d'autres; mais, en général, que l'atmosphère y était lourde et assoupissante! Quelle timidité scientifique et quelles prétentions pompeuses! Son influence vint surtout en aide à la politique du gouvernement espagnol; en dernière analyse, elle ne servit qu'à retarder la franche expansion du génie des Belges.
Dans des conditions plus ou moins différentes, on peut observer à Liège les mêmes tendances et des résultats analogues. Nous avons dit plus haut que les Hiéronymites s'occupaient tout particulièrement de l'éducation des enfants pauvres. Or l'une des maximes du créateur de l'ordre, Gérard de Groot, était que, si le prêtre doit être la lumière du monde, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, il importe néanmoins que les ouailles soient préparées à profiter de ses enseignements: dans ce but, Gérard recommandait à ses collaborateurs de rendre aussi facile que possible, à tous, l'intelligence des saintes Écritures. Il n'en fallait pas plus pour rendre les Frères de la vie commune (17) suspects à nos princes-évêques, terrifiés comme Charles-Quint et Philippe II des progrès de la réforme en Allemagne et dans les Pays-Bas. Ils résolurent de couper le mal dans sa racine, en s'appuyant sur la milice puissante qui venait de se dominer la mission de protéger la tradition purement orthodoxe. L'iconoclaste Herman Struycker étant venu prêcher dans le pays, l'évêque Charles d'Autriche se hâta d'appeler à Liège Pierre Canisius, « l'une des plus fermes colonnes » de la Compagnie de Jésus (18). Orateur pathétique en même temps que théologien profond, Canisius obtint tin succès prodigieux; les sermons de Salmeron et de Ribadeneira, qui le remplacèrent, n'eurent pas moins de retentissement que les siens, et ce fut probablement leur influence qui détermina Robert de Berghes, successeur de Charles, à établir dans sa capitale un Collège de Jésuites. Ses négociations n'aboutirent pas: Gérard de Groesbeck les renoua, parvint à obtenir quelques missionnaires, mais recula tout d'un coup devant l'établissement du nouveau Collège, parce qu'il ne voyait pas de raison suffisante, dit-on, de renvoyer les Hiéronymites. Le silence des historiens sur les détails de cette affaire laisse le champ libre aux conjectures. Gérard de Groesbeck n'était pas un prince tolérant: on sait qu'il essaya, sans y réussir toutefois, d'établir l'inquisition à Tongres. Quoi qu'il en soit, il temporisa; mais au commencement du règne d'Ernest de Bavière, les Hiéronymites furent purement et simplement privés de leur local, et les Jésuites s'y installèrent immédiatement (19). Le nouvel établissement fut inauguré le 30 avril 1582.
Ernest de Bavière fonda en outre un collège à Louvain, pour les Liégeois qui désiraient se perfectionner dans les sciences. Il établit à St-Trond un séminaire pour les humanités, et un autre à Liège, pour la philosophie et la théologie (20). C'était un prince instruit (21), sceptique à ce qu'on dit, et néanmoins persécuteur implacable des dissidents: par parenthèse, ses édits de bannissement eurent pour conséquence de transporter dans le pays de Stolberg l'industrie métallurgique qui commençait à se développer vers les sources de la Vesdre. L'enseignement fut soumis, sous son règne, à la censure la plus sévère: défense à quiconque « d'entreprendre d'estre ou estre maistre d'écolle ou d'enseigner aucuns enfans ou autres, communement ou particulièrement, lire, escrire langues d'aucune sorte, compter, ciphrer, musiquer ou semblable art, science ou praticque quelconque, beaucoup moins d'enseigner la philosophie ou « prescher, » sans l'autorisation du grand vicaire (22) La vigueur de ces mesures rétablit la paix religieuse; mais elle eut aussi pour effet d'amortir pour un temps l'énergie de la population et de préparer les Liégeois, par l'abaissement de leur niveau intellectuel, à supporter le plus pénible de tous les jougs, celui du despotisme théocratique.
Sans être injuste envers les successeurs des Hiéronymites, il est permis de dire que leur enseignement, à Liège, ne fut rien moins que favorable au progrès des lumières. Comme partout, ils reléguèrent au second plan les langues et les littératures profanes, pour s'attacher exclusivement au latin; ils exercèrent leurs élèves à écrire proprement des pièces de rhétorique; ils composèrent et leur firent composer force héroïdes et tragédies pieuses; ils eurent soin de les tenir éloignés du mouvement du siècle, ou tout au moins de ne le leur laisser entrevoir qu'à travers un prisme: zèle maladroit pour être trop habile, et dont le XVIIIe siècle se chargea de leur démontrer l'imprévoyance. En attendant, ils cherchèrent à s'assurer la première place dans le monde théologique, et l'effroi inspiré, sur la fin du XVIIe siècle, parles noms de Baïus et de Jansénius favorisa un instant leurs tentatives. Pendant un certain temps, ils trônèrent dans les chaires du Séminaire épiscopal. Ces querelles passionnèrent les Liégeois, qui n'avaient plus à s'occuper d'autre chose: nous traversons une période tout à la fois d'agitation stérile et de somnolence...
Tel fut l'enseignement public, en notre ville, jusqu'à la suppression de la Compagnie de Jésus. Il serait injuste de passer sous silence le Collège des Jésuites anglais, fondé en 1616; on y commenta les livres d'Aristote, on y attaqua Descartes et sa séquelle; on y cultiva les mathématiques et la physique avec quelque succès, paraît-il; en tout cas, l'influence de cet établissement sur les études des nationaux fut très indirecte.
De la fin du XVIe siècle au commencement du XVIIIe, Liège compta cependant un assez grand nombre d'hommes distingués dans les sciences et dans les lettres: le savant critique Langius, l'éminent mathématicien R. de Sluse, le P. Foullon , historien impartial et souvent profond, apparaissent comme des étoiles de première grandeur au milieu d'une pléiade d'érudits et d'écrivains de second ordre. Nous laissons de côté les artistes, parmi lesquels il y aurait à citer surtout des graveurs très remarquables et quelques peintres, comme Lairesse et Bertholet. Mais l'histoire des lettres et des arts n'est pas précisément celle de l'instruction publique. Ces individualités saillantes se détachent sur un fond d'une teinte assez monotone. La population liégeoise, naturellement si vive, si avide de savoir, si virile en d'autres temps, s'endormait volontiers sur le doux oreiller de la paresse et ne se montrait fière que de ses chanoines. Elle vivait dans un demi-jour, et s'en trouvait bien. Elle était séparée de l'Europe comme par une muraille de la Chine. A l'intérieur, toute vie politique avait disparu: il se rencontrait des panégyristes du coup d'État de Maximilien-Henri, qui avait supprimé d'un trait de plume, en 1684, toutes nos libertés constitutionnelles. Cette atonie était-elle incurable? Cette quiétude profonde qui persista pendant un demi-siècle, où notre histoire n'a pas un événement à enregistrer, devait-elle durer toujours? Sous le règne de l'excellent prince Georges-Louis de Berghes (1724-1743), alors que plus que jamais on a lieu d'être satisfait du présent, alors qu'effectivement on en est satisfait, nous voyons un vif sentiment de curiosité s'emparer soudain de tout le monde. Ce n'est pas qu'on songe à réclamer les droits confisqués; mais on tient singulièrement à les bien connaître, à savoir au juste ce qu'ils ont coûté à nos aïeux. On relit Foullon, on le continue; Bouille écrit son Histoire de Liège; les jurisconsultes Méan et Louvrex publient leurs précieux recueils; poussé par un instinct secret, l'esprit public se réveille. D'autres vagues symptômes se manifestent: on voit apparaître quelques ouvrages de littérature légère. Encore un moment les idées de Jean-Jacques et des encyclopédistes vont franchir la frontière; l'antique édifice tout entier chancellera sur sa base.
C'est le comte de Horion, premier ministre de Jean-Théodore de Bavière, qui se charge lui-même d'introduire l'ennemi dans la place. Pierre Rousseau, directeur du Journal encyclopédique, vient s'installer à Liège. Cette ville est peu philosophe, il le déclare; elle n'est connue dans la république des lettres que par son Almanach; mais elle est bien située de là, le Journal se répandra plus aisément dans toute l'Europe. De 1756 à 1759, Rousseau poursuit sa propagande tout à l'aise. Tout d'un coup l'évêque, mieux informé, lui retire son privilège. Rousseau s'adresse à Marie-Thérèse; mais l'Université de Louvain a l'oeil au guet. Renvoyé de Bruxelles, il se réfugie enfin à Bouillon, où il organise une Société typographique dont l'influence, comme celle du Journal encyclopédique et de l'Esprit des journaux, sera considérable jusqu'en 1793. Le gant est jeté: mais quoi! loin de le relever, le prince-évêque Velbruck va lui-même se faire le protecteur, presque le complice des audacieux publicistes. La physionomie de ce règne est très-intéressante; retracée par un pinceau habile, elle expliquerait le mouvement des idées à Liège mieux que la révolution ellemême.
Les Jésuites disparurent de la principauté en 1773. Un ancien prédicateur de leur collège, l'abbé de Feller, polémiste fougueux et infatigable, resta seul sur la brèche pour défendre le système qu'ils avaient personnifié. Le philosophisme français fit de rapides progrès dans le pays, grâce à l'activité des presses liégeoises, d'où sortit même une nouvelle édition de l'Encyclopédie. On peut reprocher au gouvernement d'avoir poussé trop loin l'insouciance, lorsque des libraires spéculèrent en grand sur des publications obscènes de bas étage, qui propageaient l'esprit d'opposition voltairienne dans ce qu'elle avait de malsain et oblitéraient le sens moral du peuple. Il est vrai que Velbruck édicta un règlement sévère contre les mauvais livres; mais ce règlement, comme bien d'autres, ne fut jamais sérieusement appliqué (23)
En abusant de la tolérance, Velbruck ne fut pas moins imprévoyant que ses prédécesseurs. Ceux-ci avaient entretenu les Liégeois dans un état d'indifférence béate; le nouveau prince ne prit pas assez garde à l'effet que devait produire, sur les masses ignorantes, la rupture subite le toutes les digues. Le prestige du pouvoir ecclésiastique une fois évanoui, la religion elle-même et jusqu'à la morale jetées par dessus bord, qu'allait-il advenir?.
C'est là le revers de la médaille: il n'en est pas moins vrai que Velbruck, prince éclairé, grand zélateur des sciences, des lettres et des arts, peut être appelé à juste titre l'émancipateur des Liégeois. Il ne se contenta pas de régénérer les écoles et de créer des cours gratuits spéciaux (mathématiques et dessin appliqué aux arts mécaniques); il fonda la Société libre d'Émulation, institution académique dont il fut le premier président, et qui eut pour mission, d'abord d'étudier à fond les ressources du pays, ensuite d'ouvrir des concours sur des questions de science et d'utilité publiques. Tous les hommes de quelque valeur que renfermait Liège s'y firent inscrire (24); on y prit habitude, dans les réunions du soir, de choisir pour texte des conversations les doctrines et les problèmes sociaux qui passionnaient le plus en plus le public. Là se faisaient entendre des orateurs ardents; là se préparaient aux luttes de la tribune, à leur insu, les Bassenge, les de Chestret, les Fabry; là se rencontraient les tréfonciers de Paix et de Harlez; là s'essayaient les poètes; là Grétry recevait des ovations et léguait d'avance son coeur au pays natal. Par ses concours, par ses expositions, par les travaux de ses Comités, par ceux qu'elle sut encourager, la Société d'Émulation resta pendant longues années fidèle à son mandat. Elle subit comme toutes les institutions le contre-coup de la crise révolutionnaire; mais elle se releva au commencement de l'Empire, pour prendre une part plus directe et plus active que jamais au développement de l'instruction publique. Elle patrona l'Ecole de médecine fondée par Ansiaux et Comhaire (25); elle organisa des fêtes intellectuelles et décerna des récompenses qui furent noblement disputées: nous n'exagérons rien en disant que le mouvement d'idées qu'elle prit sous sa direction contribua puissamment à fixer le choix du gouvernement hollandais, lorsqu'il fut question, en 1816, de déterminer le siège des Universités de l'État.
Mais encore une fois, Velbruck ne songeait pas au lendemain. Ou a vu des prêtres mondains sur le trône; mais un prince ecclésiastique ouvertement philosophe, dans le sens qu'on donnait à ce mot au siècle dernier, voilà certes une singularité dont cette période de l'histoire peut seule nous offrir le spectacle. Deux adversaires en une même personne: le prince compromettant l'évêque et l'évêque rendant le prince impossible. Ceux qui dès lors repoussaient la confusion des deux pouvoirs n'étaient que logiques; ils tiraient les conséquences naturelles des prémisses que leur fournissait le souverain lui-même. Les esprits modérés, mais clairvoyants, pressentaient qu'il faudrait bientôt opter.
Velbruck avait été évêque aussi peu que possible; son successeur Hoensbroeck, sincèrement mais étroitement pieux, s'engagea dès son avènement dans une voie tout opposée. Il tint en grande suspicion les penseurs et les beaux esprits; il essaya de paralyser l'essor vigoureux qui avait caractérisé le dernier règne. A un lettré qui lui demandait la place de conservateur de sa bibliothèque, il répondit sèchement: « Je n'ai jamais lu et je ne veux pas en prendre l'habitude » (26). « Il éloigna peu à peu les hommes qui avaient eu la confiance de son prédécesseur, et finit par renouveler tout son entourage. Il se forma ainsi, dans la partie la plus intelligente de la population, un noyau de mécontents que grossirent la froideur et l'extérieur peu sympathique du prince (27). » On saisit avidement le premier prétexte venu: la balance pencha...
La révolution qui engloutit la principauté de Liège fut exactement le contraire de la révolution brabançonne. Celle-ci s'éleva contre le joséphisme, qui asservissait l'Eglise à l'Etat; celle-là revendiqua contre le clergé toutes les libertés civiles et politiques. Velbruck avait laissé les idées françaises saper les fondements de son pouvoir; la réaction opérée par Hoensbroeck acheva de rendre odieuse et insupportable la domination ecclésiastique. Tout conspirait à transformer les Liégeois, si longtemps courbés sous la crosse épiscopale, en libéraux décidés, en adversaires de toute intervention du prêtre dans les affaires temporelles. Pour être certains d'en finir avec l'ancien régime, ils se jetèrent dans les bras de la république française: malheureuse inspiration, qui leur valut d'être traités en peuple conquis, mais conséquence naturelle des influences qu'ils avaient subies et des fautes de leurs derniers princes. Quand les yeux furent dessillés, d'ailleurs, ils furent les premiers à se souvenir qu'ils étaient Belges.
L'instruction publique languit Liège pendant toute la période révolutionnaire. Sous la domination française, le grand Collège qui avait remplacé la maison des Jésuites (28) fit place à une Ecole centrale, dont le programme devait comprendre « les mathématiques, la physique et la chimie expérimentales, l'histoire naturelle, l'agriculture et le commerce, la méthode des sciences ou logique, l'analyse des sensations et des idées, l'économie politique et la législation, l'histoire philosophique des peuples, l'hygiène, les arts et métiers, la grammaire générale, les belles-lettres , les langues anciennes , les langues vivantes et les arts du dessin. » C'était passer sans transition d'un extrême à l'autre. Ni les professeurs, ni les élèves n'étaient capables de venir h bout de ce qu'on exigeait d'eux (29). L'Ecole de Liège végéta pendant six ans (1798-1804); le Lycée qui lui succéda subsista jusqu'en 1814 (30), époque où il fut transformé en Gymnase, sous la courte administration prussienne. Dans le plan d'organisation de l'Université impériale, Liège avait figuré comme chef-lieu d'Académie, pour les départements de l'Ourthe, de Sambre-et-Meuse, de la Roér et de la Meuse-inférieure. La Faculté des sciences y fut seule organisée; un maigre cours de logique représenta à lui seul toute la Faculté des lettres; finalement, un décret fit tout disparaître. Les aspirants au barreau allèrent fréquenter, à Bruxelles, l'Ecole de droit, qui nous revint plus tard, professeurs et élèves, et forma le noyau de notre Faculté académique (31); les étudiants en médecine suivirent les cours d'Ansiaux et de Comhaire. En résumé, l'enseignement supérieur ne reçut pas, chez nous, d'organisation régulière et pratique avant l'établissement du royaume des Pays-Bas. Plusieurs bons éléments pouvaient être mis à profit; mais, comme le dit M. Nothomb, en 1816 tout était à faire.
II.
Lorsque le roi Guillaume soumit la loi fondamentale à l'approbation des notables de la Belgique, les délégués des départements de l'Ourthe, de la Meuse-inférieure et des Forêts (Liège, Limbourg et Luxembourg) se prononcèrent à une très-grande majorité en faveur du projet (32). A Bruxelles et à Namur, il y eut à peu près partage; l'attitude des Flandres, d'Anvers et du Hainaut fut au contraire tellement hostile, qu'en dépit des 110 voix hollandaises des Etats-généraux, consultés de leur côté et convoqués en nombre double, la loi se trouva rejetée par 796 suffrages contre 637. Cent vingt-six votants motivèrent formellement leur refus sur les articles 196 et 198, qui proclamaient la liberté absolue des cultes et rendaient les emplois accessibles à tous les nationaux, sans distinction d'opinions religieuses. L'opposition comptait aussi dans son sein un certain nombre de libéraux, préoccupés de certaines garanties essentielles dont la loi ne disait mot, notamment de la responsabilité des ministres, de l'institution du jury, que l'Empire nous avait fait connaître, enfin de l'inamovibilité des juges; mais il resta évident pour le roi, dont la surprise et l'irritation furent extrêmes, que le clergé était le principal instigateur de la résistance. Or la situation était délicate vis-à-vis des puissances alliées, qui avait stipulé l'assimilation constitutionnelle des deux pays. La Hollande acceptait sans réserve les propositions du gouvernement; la Belgique prise en masse n'en voulait pas: que faire? Un arrêté royal du 4 août 1815 déclara la loi fondamentale purement et simplement acceptée (33). C'était une première faute, que le temps pouvait faire paraître excusable (34); malheureusement le roi ne s'en tint pas là. II laissa échapper des paroles menaçantes; il jura d'écraser le parti qui l'avait tenu en échec (35). On sait comment furent traitées les protestations du prince de Broglie, évêque de Gand; on sait comment, dans la suite, le nouveau Joseph II fut accusé de vouloir asservir l'Eglise. La sincérité des intentions de Guillaume ne saurait être révoquée en doute; il voulait incontestablement le bien de ses sujets, mais il le voulait à sa manière et sans tenir, compte du sentiment des populations. Plus il s'obstina, plus ses mesures devinrent suspectes; finalement elles parurent odieuses. On lui imputa le projet de vouloir propager en Belgique l'esprit calviniste, et tout d'abord de l'introduire subrepticement dans les écoles primaires (6); on lui reprocha de réserver toutes ses faveurs à ses compatriotes; et ce ne furent pas seulement les coryphées de la politique active, ce furent tous les Belges qui s'indignèrent, lorsqu'il eut la malencontreuse inspiration de nous imposer de force la langue hollandaise (37). En vain il émancipa notre industrie, en vain il rendit plus prospères que jamais nos provinces épuisées, en vain il régénéra l'instruction publique: une nation qui voit sa religion et sa langue en péril se sent frappée au coeur et répudie des bienfaits qu'elle regarde comme empoisonnés.
Le royaume des Pays-Bas dura néanmoins quinze ans, et ces quinze années, malgré tous les griefs, figureront dans notre histoire comme une période heureuse et brillante. La paix, cette fée si longtemps insaisissable, désormais assise à notre foyer, nous prodiguait ses trésors. Les relations intimes de la Belgique et de la Hollande nous profitaient plus encore qu'à nos voisins bataves. Le roi aimait les lumières et respectait la liberté dans tout ce qui ne louchait pas à ses idées fixes. Aveugle et intraitable sur ce point, il mina lui-même l'édifice qu'il avait mission de consolider; mais sous d'autres rapports les provinces belges eurent tant de sujets de lui rendre grâces, que jusqu'au moment suprême un seul mot de sa bouche eût pu tout réparer il ne le prononça pas.
Il avait l'admirable patience qui a toujours caractérisé ses compatriotes et qui leur a permis de conquérir leur sol sur l'Océan; mais il avait aussi les défauts de ses qualités: sa ligne de conduite une fois tracée, aucune considération n'aurait pu l'en faire dévier; les éléments qu'il avait négligés en posant ses prémisses n'existaient pas à ses yeux; lui eût-on démontré à l'évidence le danger de les éliminer, il restait logicien jusqu'au bout. Avec ces dispositions d'esprit, il gagna peu à peu du terrain, notamment dans la capitale des Flandres, où les libéraux, peu nombreux au commencement, mais en communauté directe d'idées avec lui, étaient ravis de le voir entamer une lutte à outrance contre les doctrines politiques de l'épiscopat. Le noyau de ses partisans s'y grossit peu à peu des représentants de la grande industrie, presque tous ses obligés, et finalement d'une bonne partie de la classe moyenne, qui appréciait hautement sa sollicitude pour l'instruction publique. Foyer de l'opposition cléricale au commencement de son règne, la ville de Gand était devenue, en 1830, le dernier boulevard de l'orangisme. - Les choses se passèrent tout autrement à Liège. Là aussi de puissants industriels, et à leur suite tout un peuple de travailleurs, étaient sympathiques au gouvernement; là aussi florissait une Université qui ne laissa pas que de lui recruter des auxiliaires; mais par contraste avec Gand, l'attachement au régime établi eu 1815 se refroidit dans le pays wallon à mesure que les idées libérales y firent du chemin. On a vu plus haut que la loi fondamentale avait été assez bien accueillie dans les provinces dont le territoire correspond à l'ancienne principauté ecclésiastique; or c'est au sein de ces mêmes provinces, quinze ans à peine écoulés, que la révolution fut surtout populaire et qu'elle trouva ses principaux chefs. L'explication de ce revirement se trouve dans l'idée radicalement fausse que le roi Guillaume s'était faite de notre caractère et de nos intimes aspirations.
Pendant toute la durée de son règne, le parti catholique fut représenté à Liège par plusieurs notabilités de premier ordre; cependant l'influence politique du clergé s'y faisait beaucoup moins sentir, depuis la grande révolution, que dans les provinces qui avaient fait partie des Pays-Bas autrichiens. Les Liégeois, pris en masse, se souvenaient trop amèrement du règne de Hoensbroeck, pour n'être point attachés aux idées de 1789 et pour n'en point tirer les conséquences rigoureuses. Nous voyant assez indifférents aux susceptibilités des prélats, le roi nous considéra comme gagnés d'avance à sa cause. On peut aussi admettre qu'à Liège comme à Gand, pour mieux assurer la réussite des projets qu'il avait conçus, il eut l'arrière-pensée d'engager la fidélité des provinces wallonnes en les dotant de grands avantages matériels, moyen de se faire absoudre des faveurs administratives et religieuses qu'il accordait aux Hollandais (38). Il atteignit son but, comme on vient de le dire, dans le monde industriel. Mais il se méprit du tout au tout sur la véritable portée du libéralisme liégeois; surtout il ne prévit pas que la jeunesse universitaire, déjà libérale d'instinct, lui échapperait tout à fait lorsqu'elle comparerait la conduite politique du souverain avec les principes que des hommes choisis par l'autorité, mais en définitive des hommes de conscience, étaient appelés à lui enseigner. C'est en effet dans nos Universités, ou plus exactement c'est à l'Université de Liège, que se forma ce groupe de patriotes qui déchirèrent le pacte de 1815, devenu une lettre morte. Il faut dire à l'honneur de Guillaume I qu'il ne porta jamais atteinte à la liberté de la chaire: mais le moment devait arriver où les jeunes aiglons qu'il avait habitués à contempler le soleil en face, n'en pourraient plus détourner leurs regards.
Libéralisme est un mot tellement élastique, que les partis les plus opposés l'ont inscrit sincèrement, et tour à tour, sur leur drapeau. Le roi Guillaume se croyait libéral, non qu'il aimât la liberté, mais parce qu'il voulait affranchir les peuples de tout autre joug que le sien. II en voulait surtout à l'esprit du catholicisme et à l'influence française. Sa pensée était d'émanciper le peuple en le forçant d'accepter son système d'éducation. Persuadé de son infaillibilité, il démonétisait toute idée qui ne portait pas son effigie. La manie de réglementer s'empara donc de son esprit: il propagea l'instruction, mais en la monopolisant; il protégea la presse, sauf à la museler quand elle ne lui donnerait pas raison; il combattit les empiètements du clergé, mais en opprimant le clergé et en s'ingérant dans l'enseignement théologique. En Hollande, cette façon d'agir ne blessait personne, sauf quelques vieux républicains partisans de l'oligarchie; mais ceux-ci mêmes avaient sur la liberté des idées toutes différentes des nôtres. En Belgique au contraire, à Bruxelles et à Liège en particulier, un tel système ne pouvait que froisser profondément les adversaires comme les amis du cléricalisme. Chez nous, les purs libéraux aspiraient tout bonnement à la séparation de l'Église et de l'État: ils ne voulaient pas que l'Église pesât sur l'État, mais ils n'entendaient pas davantage que l'État absorbât l'Église. Ils trouvaient naturel qu'un libéral alIât même à la messe; en revanche, ils se seraient bien gardés de s'enquérir de la présence de leurs voisins au prêche évangélique. Le Liégeois, de tout temps, s'est montré extrêmement jaloux de sa liberté individuelle; les moindres envahissements du pouvoir lui portent ombrage et trouvent en lui un adversaire implacable. Voilà ce dont Guillaume ne parut point se douter: il prit le libéralisme des loges maçonniques, qui avait des points de contact avec le sien, pour le reflet de l'opinion publique; impossible de se tromper plus complétement. Parce que les Liégeois avaient l'ancien régime en horreur, ils n'en étaient pas moins, en général, restés attachés à la religion de leurs pères. Tolérance pour tous, point de propagande officielle, liberté de penser et de parler, tels étaient leurs voeux et leurs légitimes espérances. Voyant le roi viser au gouvernement personnel et faire aussi bon marché de leurs griefs que de ceux du clergé, ils prirent tout d'un coup au sérieux les protestations des catholiques. Appliquant à la situation présente un mot du vieux Balzac, rapporté par Lamennais, nos concitoyens se dirent qu'un peuple qui avait secoué le joug de la théocratie ne pouvait se résigner à regarder comme un Dieu son chef temporel. Ils virent la Belgique moins indépendante que jamais, en dépit des promesses du pacte fondamental. Libéraux et catholiques oublièrent en un moment leurs dissidences et n'eurent plus qu'une préoccupation dominante, la délivrance de la patrie. Ainsi fut conclue cette fameuse Union que Guillaume qualifia d'infâme, mais que justifiait pleinement au contraire le sentiment des devoirs les plus sacrés; ainsi s'organisa le pétitionnement général de 1828, qui ébranla jusqu'en ses fondements l'édifice élevé par la Sainte-Alliance (39).
Le roi des Pays-Bas attachait au développement de l'instruction publique dans les provinces méridionales une importance d'autant plus grande, qu'il avait trouvé la Belgique, sous ce rapport, dans un état d'infériorité déplorable. Ses idées de réforme se rattachaient, comme on peut s'y attendre, à sa politique générale; et ici encore emporté par son zèle anti-clérical, il finit par ne plus garder aucune prudence. Cependant nous avons lieu de croire que l'Union aurait eu de la peine à se former, si les libéraux liégeois n'avaient eu des raisons de se croire directement froissés. Ils épousèrent la querelle du clergé parce qu'ils trouvèrent que le clergé avait raison, mais plus encore parce que, comme le Harry Wind de Walter Scott, ils avaient à combattre pour leur propre main. En général, les mesures prises par Guillaume pour régénérer l'instruction publique furent applaudies à Liège aussi bien qu'à Gand. Jamais établissement d'enseignement primaire n'obtint chez nous un succès aussi universel, aussi incontesté, que l'école primaire modèle dirigée par J. Stapper, de Haarlem. Les écoles gratuites de la ville, les écoles des campagnes même étaient pour la plupart excellentes; l'un des premiers soins du roi avait été d'appliquer à la Belgique cette loi de 1806, dont Cuvier et Noël n'avaient su en quels termes vanter les résultats, lors de leur voyage officiel en Néerlande. Partout s'organisaient des cours normaux; le gouvernement, appréciant les avantages de l'initiative privée, favorisait les Sociétés d'encouragement qui se constituaient dans les principaux chefs-lieux de province; les Commissions provinciales d'instruction exerçaient une influence salutaire; une juste sévérité présidait au choix des instituteurs, qui étaient nommés au concours. L'organisation nouvelle répondait d'ailleurs à un besoin vivement et généralement senti: on ne se représente pas aujourd'hui l'abaissement de nos écoles primaires avant 1815. La réorganisation de l'enseignement élémentaire est pour Guillaume I un titre impérissable à la reconnaissance des Belges: elle aurait assuré sa popularité parmi nous, si l'on ne s'était trouvé tout d'un coup en présence de questions plus brûlantes. Quant à l'accusation de propagande calviniste jusque dans les petites écoles par le choix des livres, etc., etc., elle se réduit aujourd'hui à fort peu de chose. Il n'est pas vrai de dire que l'instituteur ait jamais porté atteinte à l'enseignement du curé: les enfants se rendaient à l'école pour s'y instruire et allaient à l'Eglise pour y apprendre le catéchisme; tout le monde s'en trouvait bien, et les deux autorités, chacune indépendante dans son domaine, se respectaient mutuellement. D'ailleurs, quelle que fût la pensée secrète du roi, il n'aurait pas trouvé dans notre pays les moyens d'arriver à ses fins. L'expérience fut tentée jusqu'à un certain point dans des régions plus hautes; mais ici, nous nous croyons en droit d'affirmer qu'il n'en fut jamais question; nous en appelons aux souvenirs de tous les hommes de cette époque. Les motifs de défiance dont on fit état dans la suite pour ramener le clergé dans l'école étaient plutôt théoriques que justifiés par une expérience de quinze années.
L'enseignement moyen fut réorganisé à son tour. Ici la lutte qui s'engagea contre le monopole du pouvoir civil ne se réduisit pas un procès de tendance. Le clergé ne pardonna pas plus à Guillaume la fermeture des collèges libres, que la proscription des corporations religieuses qui s'occupaient d'enseignement élémentaire. Toutes les familles catholiques s'émurent quand parut le décret du 11 août 1825, excluant des emplois publics et des fonctions ecclésiastiques les jeunes gens qui auraient lait leurs humanités à l'étranger. Il n'y avait plus à se faire illusion le roi se rangeait ouvertement sous la bannière du joséphisme; il fallait courber la tête sous le joug, renoncer à la liberté de conscience ou se laisser traiter en parias. L'attitude résolue des députés belges arracha enfin au gouvernement quelques concessions: elles arrivèrent trop tard...
Les Athénées et les Collèges belges, sous le gouvernement hollandais, furent loin de briller autant que les écoles primaires (40). La Hollande, qu'on avait pris pour modèle, ne possédait pas un enseignement secondaire en rapport avec les nécessités du temps. On n'y cultivait guère que les langues anciennes, comme si l'on n'eût eu à former, écrivait Victor Cousin, que des professeurs et des théologiens. II est permis de voir dans ce système étroit, auquel la Hollande cherche à renoncer aujourd'hui sans parvenir à se fixer, un obstacle sérieux au développement de nos Universités naissantes, et aussi une des causes de l'esprit de réaction qui s'y fit jour contre les institutions existantes. La jeunesse belge abordait les études académiques entièrement étrangère au monde moderne; tout était nouveau pout elle; on ne lui avait appris que des mots et des formules stériles; les uns, dont l'esprit manquait de ressort ou de stimulant, restaient dans l'ornière jusqu'à la fin; les autres se jetaient à corps perdu dans l'étude des choses présentes et, plus avides de se faire l'écho des bruits du dehors que de pâlir sur des manuels sèchement écrits dans un latin de convention, rêvaient réformes sur réformes, descendaient dans l'arène de la presse militante et finissaient par ne s'attacher qu'aux maîtres dont les leçons correspondaient à leurs préoccupations politiques.
Ainsi s'explique comment la Faculté de droit atteignit dès le début, à l'Université de Liège, une importance hors ligne: à un moment donné, il en devait sortir une phalange tout armée pour le combat. L'esprit scientifique proprement dit souffrit cependant de cette situation; le système qui fut mis en vigueur en 1817 porta de tout autres fruits que ceux sur lesquels avaient compté ses promoteurs. Parmi les étudiants qui se distinguèrent, un petit nombre poursuivirent plus lard des études paisibles; la plupart visèrent à jouer un rôle actif clans les affaires publiques. On sait ce que la Belgique doit à leur chaleureux patriotisme, à leurs audaces précoces, à la sagesse pratique dont ils firent pleuve jusque dans leurs entraînements. On sait également avec quelle dignité courageuse et quelle abnégation antique quelques-uns d'entre eux restèrent fidèles au gouvernement déchu: ceuxlà aussi sont dignes de tout respect et de toute sympathie. Noble et vigoureuse génération, dont l'histoire se souviendra et qui est encore l'honneur de notre pays. Mais l'époque où ces hommes étaient jeunes fut une époque de crise et de transformation c'est à peine si l'Université de Liège, jusqu'en 1830, put respirer dans des conditions normales. On y entrait trop peu préparé, on en sortait trop agité, et dans tous les cas trop indifférent à la science pure. C'est ainsi que, par l'effet naturel des circonstances, la politique vint s'asseoir sur nos bancs, et absorber de plus en plus l'attention; elle s'en retira plus tard, nos libertés une fois conquises, pour intervenir, sous l'égide de la loi, dans la constitution du jury d'examen; mais jusqu'aujourd'hui notre enseignement supérieur en a subi l'influence, et c'est ce qu'il importe de constater d'abord, si l'on veut porter un jugement équitable sur les efforts de ceux qui l'ont représenté jusqu'ici.
Pris en lui-même, le Règlement organique de 1816 était digne d'un prince éclairé, loyalement dévoué à l'oeuvre d'émancipation qu'il avait entreprise. Il consacrait une sorte de compromis entre le système de centralisation de l'Université de France, et le système d'autonomie des hautes écoles de l'Allemagne. Les spirituelles plaisanteries de l'Observateur belge (41) ne lui portèrent aucune atteinte sérieuse; s'il n'était pas irréprochable de tout point, il substituait du moins des établissements complets aux institutions incomplètes léguées par l'Empire (42). Le travail de M. Nothomb (43) nous dispense d'analyser ce document, qui d'ailleurs a servi de base à nos institutions actuelles, en ce qui concerne la constitution intérieure des Universités. Celles-ci devaient comprendre cinq Facultés; mais la Faculté de théologie catholique, la seule qui aurait pu porter directement ombrage au clergé, n'y fut jamais organisée. Le règlement portait la contre-signature du ministre Falck, qu'on a surnommé le bon génie de Guillaume I: cela encore devait inspirer confiance (44). En somme, une opposition systématique pouvait seule à l'origine, suspecter les intentions royales.
Tout allait dépendre, il est vrai, du premier choix des professeurs. Le gouvernement fit tout ce qu'il put pour trouver dans le pays des hommes capables; il s'en rencontra quelques-uns, mais pas assez pour satisfaire aux conditions du programme. Il ne suffisait pas d'avoir été premier de Louvain pour être en état d'enseigner le droit romain à une époque où les Hugo, les Thibaut et les Savigny transformaient la science. L'histoire philosophique, les sciences économiques étaient chez nous de mystérieuses inconnues; la philologie ne comptait pas un représentant sérieux; en sciences naturelles, on aurait eu à peine un nom à citer; en médecine, nous possédions Ausiaux, Comhaire et Sauveur; mais la Faculté devait être complétée. On fil venir de Bruxelles J.-G.-J. Ernst, pour le droit civil; Delvaux eut mission d'enseigner la physique et la chimie; partout enfin où il fut possible de trouver des professeurs belges, on alla les chercher. Cependant, sous peine de tout compromettre, il fallait, dès le commencement, offrir à la jeunesse un ensemble de moyens d'instruction. Le gouvernement ne fit que remplir un devoir en recrutant à l'étranger quelques hommes d'avenir, capables de pourvoir aux nécessités du moment. Ces hommes arrivèrent à Liège, jeunes encore, inexpérimentés peut-être, mais dans tous les cas à la hauteur de leur mission. L'opposition jeta les hauts cris (42): elle eut doublement tort. Les nouveaux professeurs n'étaient pas tous également familiarisés avec la langue française; mais, d'une part, c'était un défaut dont ils avaient le loisir de se corriger tous les jours; de l'autre, l'enseignement de certains cours devait se faire en latin. L'essentiel était de pourvoir les jeunes gens de connaissances solides, de leur ouvrir des perspectives que rien jusque là ne leur avait fait entrevoir. Mais l'injustice de l'opposition est surtout saillante à un autre point de vue. Sans les professeurs étrangers, les fortes méthodes de l'Allemagne ne se seraient pas introduites dans notre pays; or ce sont ces méthodes, on peut le dire, qui nous ont décidément affranchis de la routine. Les Wallons ont quelque chose de l'esprit clair et analytique de leurs voisins du sud; mais leurs instincts réclament aussi cette forte discipline intellectuelle et cette coordination synthétique des idées qui sont les premiers besoins des races germaniques. Les professeurs étrangers rendirent à nos étudiants un service inappréciable, en les initiant à leurs procédés de travail et de recherches. Beaucoup d'élèves, sans doute, ceux qui faisaient des Brodstudien (il en est ainsi partout), ne prêtèrent à leurs leçons qu'une attention superficielle et forcée; beaucoup même conquirent leur diplôme en défendant des thèses dont ils n'étaient point les auteurs (cet abus tenait, soit au système qui n'exigeait point assez de garanties, soit à l'indulgence ou à la bonhomie de certains professeurs); mais ceux qui voulurent travailler sérieusement eurent du moins la possibilité de le faire et d'élargir la sphère de leurs idées, dans des conditions où ils ne se seraient certainement pas trouvés, s'ils n'avaient eu pour maîtres que des hommes restés dans le terre-à-terre de nos vieilles écoles.
Quel essor n'imprima pas aux élèves de Liège un Wagemann, par exemple, non pas seulement en les animant du désir de savoir, mais en remuant avec eux les plus hautes, les plus pressantes questions sociales, économiques, historico-politiques? Ackersdyck après lui, et dans un autre domaine Kinker, quelle part ne prirent-ils pas à notre émancipation intellectuelle? quels disciples ne suivirent pas Bekker et Fohmann dans des sentiers où personne parmi nos compatriotes n'avait depuis longtemps plus songé à s'aventurer ? Sachons rendre pleine justice au roi Guillaume: nous lui devons d'avoir été, une fois pour toutes, mis au pas de la civilisation et de la science modernes.
Il nous eût fallu, cependant, un plus grand nombre de professeurs. Confier à un seul titulaire l'enseignement de toutes les sciences naturelles, par exemple, c'était presque dérisoire. La sollicitude du gouvernement ne se démentit point; mais à l'époque où il s'occupa sérieusement de renforcer le Corps enseignant, le ciel se couvrait de nuages et l'on songeait à tout autre chose qu'à l'intérêt des études. Warnkœnig et le baron de Reiffenberg publièrent, en 1829, un écrit rempli de vues sages sur la réforme de l'enseignement supérieur. Ils y prenaient pour point de départ la direction de l'enseignement par l'État; ils perdirent leur temps et leur huile: ce qui préoccupait alors tout le monde et le gouvernement lui-même, c'était moins l'amélioration des études que la question même dont nos deux publicistes supposaient la solution acquise.
Les premières années se passèrent sans bruit: quelques petites querelles de ménage, quelques échauffourées d'étudiants aux eaux de Chaudfontaine (43), l'une ou l'autre réclamation au sujet d'articles publiés par des élèves dans les journaux militants, dans tout cela rien de bien grave. Les règlements universitaires étaient rarement enfreints. Il régnait entre plusieurs professeurs et leurs élèves une sorte d'intimité tout à fait avantageuse pour ces derniers et non sans importance au point de vue de la popularité du gouvernement, par la raison bien simple que la liberté des conversations privées amenait des discussions d'opinion qu'on ne pouvait aborder en chaire, et que, sans trop s'en douter, la jeunesse se pénétrait insensiblement d'idées qu'elle n'eût peut-être point accueillies si elles lui avaient été présentées ex cathedra (44). On s'habituait donc au nouveau régime. L'enseignement suivait une marche régulière et prenait peu à peu de l'extension. Denzinger, Fuss et Wagemann avaient fondé une École propédeutique pour les aspirants au professorat secondaire; le gouvernement décrétait l'annexion à l'Université de Liège d'une chaire d'économie agricole et forestière et d'une chaire d'exploitation des mines. En un mot, l'institution commençait à répondre aux espérances du Pouvoir et du public, lorsque les imprudents arrêtés de 1825 vinrent jeter tout d'un coup le trouble dans les esprits et allumer l'incendie qui devait tout consumer.
On a mentionné plus haut l'ordonnance relative aux élèves qui avaient fait leurs études humanitaires à l'étranger; l'arrêté du 14 juin, créant à Louvain le Collège philosophique, produisit dans le pays une impression plus vive encore. Ne devaient plus être admis à l'avenir dans les Séminaires épiscopaux, que les élèves qui auraient achevé leur cours d'études dans cet établissement. Il n'était plus possible dès lors de se méprendre sur le but du gouvernement. « Dans toute société de citoyens, mais surtout dans un État où la loi fondamentale adoptée le prescrit textuellement, il est du devoir du souverain de veiller à l'instruction publique dans toutes les classes de citoyens. Or il n'existe point de condition dans la société qui ait autant d'importance que celle des ministres de la religion, aucune qui exerce une plus grande influence sur l'esprit des citoyens. Il est, par conséquent, très important que l'autorité civile surveille et prenne à coeur l'éducation de la jeunesse qui se destine au service du culte. Mais cette surveillance et cette sollicitude ne doivent pas s'étendre aux efforts concernant ce qui constitue proprement dit la doctrine de l'Église, mais seulement à ce que les futurs ecclésiastiques puissent acquérir convenablement la conviction qu'ils sont et resteront toujours des citoyens de l'État, et qu'ils connaissent bien leurs devoirs comme tels. » Cette déclaration du ministre de l'instruction publique parut décisive au clergé, qui fit entendre son cri d'alarme jusqu'à Rome. On ne pouvait prétendre à la rigueur que Guillaume voulût semer jusque dans les Séminaires des germes de protestantisme; mais, comme nous l'avons dit, son joséphisme n'était pas douteux. Les évêques modifièrent tout d'un coup leur tactique: ils avaient repoussé la loi fondamentale en 1815 parce qu'elle proclamait la liberté absolue les cultes; ils l'invoquèrent maintenant contre le roi, qui était le premier porter atteinte à cette même liberté. Une fois sur ce terrain, leur mot de ralliement fut la revendication d'une autre liberté inséparable de la première: la liberté de l'enseignement (45)
Le gouvernement trouva des défenseurs dans la presse (46) et quelques partisans dans le sein même du clergé: un instant on put craindre un schisme, s'il faut s'en rapporter à certains journaux du temps. Il y a là une exagération manifeste. Les joséphistes en robe ecclésiastique étaient très clairsemés. Il paraissait sans doute fort désirable que les jeunes théologiens reçussent désormais une éducation en rapport avec la civilisation moderne; mais en s'arrogeant le droit exclusif de diriger cette éducation, le pouvoir civil devenait oppresseur. En vain le Journal de Gand (47) cherchait à donner le change à l'opinion. « Ici l'arbre de Bacon fleurit par toutes ses branches, écrivait-il: et l'on ose dire que l'instruction n'est pas libre! » En vain un correspondant du Courrier des Pays-Bas appliquait au roi la parole de l'Evangile: « Je ne suis pas venu pour détruire la loi et les prophètes, » on répondait de toutes parts aux sophistes:
O pueri, fugite hinc! Latet
Anguis in herbâ...
Guillaume I voulut tenter un coup de maître par le Concordat; mais le pape Léon XII fut aussi fin que lui. L'insuccès de cette tentative ne découragea pas le roi (48); son obstination ne fit que propager le désaffectionnement parmi les libéraux aussi bien que parmi les catholiques, et força pour ainsi dire les deux partis, comme l'avait prévu de Potter, à se jeter dans les bras l'un de l'autre (49), sauf à se séparer de nouveau après la victoire.
Il ne nous appartient pas d'entrer ici dans le détail de ces débats; il suffira de faire remarquer qu'ils contribuèrent à passionner notre jeunesse universitaire, plus préoccupée d'ailleurs des réclamations des libéraux que des motifs de plainte invoqués par le clergé. Le cri de liberté retentissait de toutes parts; elle y répondait comme par un vague instinct, sans avoir encore pleinement conscience du but précis de ses aspirations. Elle devint bruyante et inquiète: toute mesure autoritaire lui parut suspecte; un simple règlement d'ordre intérieur, en 1826, provoqua une véritable insurrection (50). Ces premières agitations n'eurent à proprement parler aucun caractère politique; elles attestèrent cependant, par l'attitude hostile des étudiants envers certains professeurs qu'ils croyaient être particulièrement à la dévotion du pouvoir, qu'il y avait un point noir à l'horizon. Quelques jeunes avocats, des élèves même du doctorat en droit, notamment les rédacteurs du Mathieu Laensbergh (51), commencèrent alors à battre en brèche la politique de Guillaume, au nom des idées libérales; leur polémique hardie, vigilante, soutenue avec autant de talent que de généreux enthousiasme, surexcita de plus en plus les esprits, et les procès de presse eurent pour effet, comme toujours, de fortifier les rangs de l'opposition. Le Mathieu Laensbergh prit le nom de Politique et exerça, sous ce nouveau titre, une influence croissante (52). Le gouvernement s'émut. En 1829, une subvention de 25,000 fl. (sur les fonds de l'industrie nationale) fut allouée au publiciste Munch (53), nommé l'année précédente professeur à l'Université de Liège, à charge de créer un organe officieux. Malgré ce point d'appui, le Courrier universel ne naquit pas viable, et les manifestes de Munch contre la liberté d'enseignement, que l'Union avait déjà inscrite sur son programme, ne firent qu'accroître l'irritation et les défiances. Les discussions à l'ordre du jour exaltèrent de plus en plus les étudiants: on courait se suspendre aux lèvres éloquentes du professeur de droit public; on commentait ses doctrines après chaque leçon; on en déduisait les conséquences; on protestait contre le fameux message du 11 décembre 1829; on commençait à dire que le régime inauguré en 1815 était un perpétuel coup d'État (54). Le roi voulut détourner l'attention en provoquant une enquête sur l'état de l'enseignement supérieur. Des rapports mûrement élaborés virent le jour (55), mais ne produisirent aucun effet sur l'opinion et n'aboutirent pas. Dans le sanctuaire des études on songeait à peine aux études; les professeurs n'avaient plus de stimulant; les étudiants suivaient les cours parce qu'il les fallait suivre, mais leur esprit était ailleurs: ils s'échauffaient les uns les autres à propos des finances, de l'impôt-mouture, de la presse, de la magistrature, des droits mêmes de la couronne (56); à leurs yeux, comme aux yeux de tous, la cause de la liberté était devenue la cause de l'indépendance nationale. Un moment vint où l'on ne se posséda plus: aux barricades, à Ste-Walburge et jusqu'au gouvernement provisoire, partout se retrouvèrent au premier rang les enfants de l'Université de Liège.
Tout avait conspiré à exalter leur patriotisme, et l'influence du vieil esprit liégeois, et un souffle venu de France, et l'éducation constitutionnelle qu'ils avaient reçue. Ils combattirent pour la vraie liberté comme on l'entendait à Liège, où tout ce qui est imposé d'autorité paraît suspect, fût-ce le progrès. Le Timeo Danaos est en quelque sorte le mot d'ordre de nos populations; il n'en est peut-être pas en Europe qui puissent moins s'habituer à un gouvernement personnel. Si Guillaume avait compris cela ...
Revenons à l'Université. Nous avons dit qu'avant 1830 elle ne forma qu'un petit nombre de savants proprement dits; en revanche, elle trempa des caractères: l'un vaut bien l'autre. L'enseignement, relativement peu étendu et peu varié, y était surtout émancipateur; il ne s'agit, bien entendu, que des cours à influence directe, de ceux où Guillaume forgea des armes contre lui-même, selon la pensée de M. Gerlache. On n'oserait dire que les examens fussent très-sérieux (57); mais le système des dissertations et des concours, malgré ses abus, offrait du moins ce avantage, que les bons élèves avaient l'occasion de donner des preuves réelles de capacité et non pas seulement de mémoire. En outre, l'Université n'avait pas à s'inquiéter de ses voisines, ce qui est un privilège inappréciable. La répartition même des leçons entre les professeurs était l'affaire des Facultés; un professeur était nominé membre de telle ou telle Faculté, mais non pas chargé exclusivement de tel ou tel cours; ne parvenait-on pas à s'entendre sur les attributions de chacun, les propositions se faisaient-elles concurrence, on avait recours, en dernier ressort, au Collège des curateurs. Un tel système ne serait plus guère praticable aujourd'hui; mais, à l'époque dont nous parlons, les programmes étant peu chargés, il était de nature à donner de bons résultats. Les Universités d'Allemagne qui sont entrées dans cette voie n'ont pas eu à s'en repentir. Une certaine latitude laissée au professeur dans le choix même des objets de son enseignement (sous le contrôle de la Faculté, qui veille à ce que tous les cours obligatoires soient faits régulièrement) le dispose à travailler avec goût, lui laisse le loisir de suivre ses prédilections sans être obligé de faire deux parts de son temps, l'une pour préparer ses cours, l'autre pour continuer ses études; enfin, le rapproche des collègues avec lesquels il alterne. Chaque jour il fait part à ses auditeurs des nouveaux progrès qu'il vient de réaliser; il avance pour ainsi dire avec eux, comme disait et faisait Victor Cousin à la Sorbonne; une sorte de solidarité s'établit, la curiosité est tenue de part et d'autre en éveil; il n'y a plus de refuge pour la paresse d'esprit: le professeur est en mesure non seulement de former de bons élèves, mais de véritables disciples. C'est ce qui est arrivé à Liège pour plusieurs cours, particulièrement dans les Facultés de philosophie et de médecine. D'autres cours, il est vrai, se réduisaient à une sorte de formulaire, et c'est d'après ceux-là qu'on a jugé l'ensemble. Nous n'hésitons pas à dire que ni du chef de leur organisation générale, ni du chef de la plupart de leurs professeurs, nos anciennes Universités, et tout d'abord celle de Liège, n'ont mérité les dédains dont elles ont été l'objet, après avoir été prônées outre mesure. M. de Gerlache, qu'on n'accusera certes pas de partialité en leur faveur, n'hésite pas à reconnaître que l'enseignement y fit des progrès en droit, en médecine et dans les sciences exactes; « elles ne laissèrent pas, ajoute-t-il, d'imprimer une certaine impulsion aux esprits » (58). Nous ne comprenons pas comment on a pu contester leur influence sociale: s'il est un fait saillant au contraire, c'est qu'à Liège surtout, la jeunesse universitaire s'intéressa aux questions pratiques beaucoup plus qu'à la science pure. Les anciens élèves de Wagemann, de Kinker, de Destriveaux et d'Ackersdyck ont été et sont encore au premier rang parmi les promoteurs et les soutiens des institutions dont la Belgique est justement fière.
Qu'il y eût quelque chose de suranné dans l'emploi du latin, par exemple, et dans l'habitude prise par quelques professeurs de dicter des pourquoi et des parce que, nous aurions mauvaise grâce à le contester; mais il faut se reporter à cinquante ans en arrière et se rappeler qu'en dehors de l'ancienne Alma mater, on n'avait jamais possédé en Belgique un enseignement supérieur. Si l'Université eût pu rester calme, nul doute qu'elle n'eût répondu graduellement à l'attente générale: mais que faire en présence du trouble des esprits? On ne peut s'étonner que d'une chose: c'est qu'avec tous les obstacles qui l'ont enrayée, elle ait pu former autant d'hommes d'élite dans tous les genres. Que ceux qui sont bien au courant du mouvement intellectuel de notre pays depuis la chute de l'Empire se donnent la peine de parcourir les listes annexées au présent volume: nous nous inclinons d'avance devant leur verdict.
Avant d'en finir avec la période hollandaise, il nous faut dire quelques mots d'une institution que la législation nouvelle a fait disparaître: nous voulons parler du Collège des curateurs, dont le règlement de 1816 avait fait la première autorité académique (59). Ses attributions, très importantes et très étendues, embrassaient l'administration générale de l'Université. Il n'exerçait d'ailleurs aucune surveillance sur les professeurs; chacun demeurait responsable de son enseignement. Sans méconnaître les services rendus par ce Conseil, on jugea convenable, en 1835, de le remplacer par un fonctionnaire unique investi de pouvoirs relativement restreints; l'action du gouvernement sur les Universités devint plus directe et plus immédiate, sans entraver d'ailleurs la liberté de la science (60).
Les curateurs devaient être choisis parmi les personnes distinguées autant par leur amour pour les lettres et les sciences, que par le rang qu'elles occupaient dans la société (art. 164 du Règlement de 1816). La liste suivante atteste qu'ici le gouvernement hollandais ne saurait être accusé d'intolérance. On doit lui rendre cette justice que, sans avoir égard à leurs opinions personnelles, il n'accorda sa confiance qu'à des hommes qui en étaient réellement dignes. Les curateurs de l'Université de Liège jouirent jusqu'à la fin de la considération générale, et l'on peut dire qu'ils contribuèrent beaucoup à maintenir la concorde entre les membres du corps enseignant. Furent nommés en 1817:
Le comte de Liedekerke, gouverneur de la province, président du Collège;
Le baron C.-H. de Broich, membre de l'ordre équestre de la province de Liège;
Hilarion-Noël, baron de Villenfagne d'Ingihoul, membre des Etats de la même province, correspondant de l'Institut des Pays-Bas (61);
D. de Mélotte d'Envoz, bourgmestre de la ville de Liège 62);
F. Rouveroy, membre des Etats provinciaux et conseiller communal à Liege (63);
J. Walter, membre des Etats de la province de Namur, Inspecteur de l'Université, secrétaire du Collège (64),
O. Leclercq, conseiller d'Etat (65), remplaça le baron de Villenfagne, décédé en 1826. Si les événements n'avaient pas interrompu ses travaux, on peut affirmer que cet honorable magistrat, aussi lettré que judicieux, aurait exercé, sur la législation de l'enseignement supérieur, la plus heureuse influence. Nous renvoyons le lecteur aux rapports qu'il rédigea comme membre de la Commission de révision nommée en 1828. Ils ont été insérés dans le recueil des actes de la Commission, publié à La Haye en 1830, in-fol.
Bien que le bourgmestre de Liège, Louis Jamme (66), successeur du chevalier de Mélotte d'Envoz, n'ait fait partie du Collège des curateurs que postérieurement à la révolution, nous mentionnons ici son nom, n'ayant plus dans la suite à nous occuper de ce corps.
|
Ill.
A peine installé, le gouvernement provisoire de 1830 se vit mis en demeure de pourvoir aux besoins de l'instruction publique. Il fallait avant tout contenter l'opinion en proclamant la liberté de l'enseignement et en abrogeant tous les arrêtés qui paraissaient incompatibles avec ce nouveau régime; mais il y avait aussi à faire face aux exigences du moment, c'est-à-dire à permettre aux jeunes gens qui étaient en vacances depuis le mois de juillet, de reprendre au plus tôt le cours de leurs études. L'arrêté du 16 décembre vint mettre un terme à l'impatience du public: les établissements fondés en 1817 furent provisoirement conservés; mais le Règlement de 1816, maintenu en vigueur, subit des modifications profondes (67). Les trois Universités n'échappèrent à la crise que pour être mutilées. Liège perdit sa Faculté de philosophie; Gand ne conserva que celles de droit et de médecine; les Facultés des sciences et de droit cessèrent d'exister à Louvain. Les réclamations furent si vives dans cette dernière ville, que la Faculté de droit y fut reconstituée dès le 3 janvier 1831, mais avec un personnel tout à fait insuffisant.
Ces mesures, nous venons de le dire, étaient essentiellement provisoires; l'enseignement supérieur devait ultérieurement faire l'objet d'une loi mûrement délibérée (68). En attendant, l'arrêté annonçait (art. 3) un renouvellement partiel des corps enseignants: les professeurs étrangers allaient être renvoyés dans leur pays, pourvus d'une pension de retraite. Dussent les éludes en souffrir, on voulait rompre à tout prix avec les traditions du gouvernement déchu.
L'arrêté du 16 décembre introduisit aussi des innovations dans le régime intérieur des Universités. Les professeurs ordinaires ne composèrent plus à eux seuls le Conseil académique; le recteur fut élu par ses collègues; le latin cessa d'être la langue académique officielle; l'usage des thèses devint facultatif. Il est facile de voir que le gouvernement provisoire était inspiré par son désir de donner sans retard satisfaction à l'opinion publique, en affranchissant l'enseignement de toute entrave; mais ici, comme en matière d'enseignement primaire et moyen, il pécha par excès de zèle. Les Universités se trouvèrent non pas émancipées, mais désorganisées. Les abandonner tout d'un coup à elles-mêmes, alors précisément qu'on les privait des Facultés qu'on peut appeler de recrutement, c'était les conduire infailliblement à leur perte. On ne s'explique l'arrêté du 16 décembre qu'en attribuant à nos gouvernants le projet d'arriver au système d'une seule Université centrale: pour en venir là, dit très-bien M. Th. Juste (69), ils commençaient par détruire en détail les Universités de Louvain, de Gand et de Liège.
Seize professeurs étrangers reçurent leur démission le jour même où parut l'arrêté de réorganisation: huit furent mis en non activité. Dans cette dernière catégorie se trouvèrent compris, à Liège, J.-D. Fuss et I. Denzinger, tous deux Allemands; dans la première, les quatre Hollandais J. Ackersdyck, P. Van Lirnburg, Brouwer, J. Kinker et M. Van Rees. F. Gall et L. Rouillé furent déclarés émérites. Le corps enseignant de Liège resta composé de 9 professeurs ordinaires, de 5 professeurs extraordinaires et de 4 lecteurs.
En vain la régence de Liège, soutenue par un grand nombre de membres du Congrès, réclama contre la suppression de la Faculté de philosophie; le gouvernement provisoire déclara sa résolution irrévocable. Comme ses soeurs de Gand et de Louvain, notre Université aurait été obligée de fermer ses portes, si quelques professeurs ne s'étaient associés pour fonder une FACULTÉ LIBRE (70). Les bâtiments universitaires furent mis à leur disposition; on ne voulait rien brusquer. Ce fait atteste, selon M. Thonissen (71), la puissance et la fécondité du principe de la liberté de l'enseignement. Nous y voyons seulement une conséquence forcée de la situation fausse où l'arrêté du 16 décembre avait placé les Universités de l'État. L'instinct de conservation avertissait qu'il y avait une lacune à combler; il ne s'agissait nullement d'élever autel contre autel, ce qui est le propre de l'enseignement libre proprement dit.
La FACULTÉ LIBRE ne pouvait prendre ce nom que parce que ses membres enseignaient sans titre officiel; mais en fait, elle n'était qu'une annexe, une dépendance de l'Université, et elle eût été bien heureuse de perdre sa liberté.
En dépit du mérite de ceux qui la composaient, son influence fut loin d'être féconde. Les étudiants s'habituèrent à regarder comme purement accessoires les études littéraires, philosophiques et scientifiques; il s'ensuivit une véritable décadence, à laquelle l'institution des Commissions d'examen fut loin de porter remède. Cette dernière innovation, par parenthèse, devait avec le temps nous engager tians un labyrinthe inextricable. Laissons la parole à M. Nothomb:
« Les élèves qui fréquentaient les Facultés libres aux dépens des Facultés de l'État conservées dans d'autres établissements, ne tardèrent pas à réclamer la nomination de Commissions d'examen, qui devaient être chargées de conférer le grade de candidat, préparatoire, soit aux études de droit, soit à celles de médecine. Cette réclamation fut vivement appuyée par les autorités communales et provinciales... Du moment que le régime provisoire des Universités était maintenu, la création de semblables Commissions, quelque mauvaise que fut cette mesure, devenait en quelque sorte indispensable. Que serait devenue l'Université de Gand, avec ses deux Facultés de droit et de médecine, privée qu'elle était des deux Facultés dans lesquelles les élèves auraient pu acquérir les grades préparatoires? Elle courait grand risque de n'avoir plus un seul élève. L'Université de Louvain, seule en possession d'une Faculté de philosophie, si elle avait eu une Faculté de droit plus complète, aurait eu la chance d'accaparer tous les élèves eu droit, mais elle aurait vu chômer peut-être sa Faculté de médecine; l'Université de Liège, au contraire, aurait vu arriver à elle la plupart des élèves en médecine, grâce â la consistance de ses deux Facultés des sciences et de médecine, qui étaient vigoureusement constituées (72). »
Les Commissions d'examen furent donc instituées par arrêté du 2 octobre 1831: celle de Liège eut mission de délivrer des diplômes de candidat en philosophie et lettres. Mais qu'arriva-t-il et que devait-il arriver? Que la Faculté de philosophie, officiellement conservée à Louvain, se trouva grandement affaiblie, et qu'une salutaire sévérité ne présida pas toujours aux examens. « Serait-il juste, ajoute M. Nothomb (73), d'en faire aujourd'hui un reproche à nos anciennes a Universités? Menacées dans leur existence même, vivant pour ainsi dire au jour la journée, leur était-il possible de se défendre d'une certaine complaisance envers des jeunes gens qu'on ne pouvait plus, il faut bien en faire le triste aveu, retenir qu'à ce prix? L'honorable ministre n'en rend pas moins justice aux professeurs, qui luttèrent autant qu'ils le purent, avec une énergie qui alla chez quelques-uns d'entre eux jusqu'à la passion, contre les conséquences d'un provisoire désastreux.
Mais la création des Commissions d'examen avait en elle-même une portée dont la gravité ne fut appréciée que plus tard. Le droit de délivrer des diplômes cessait d'appartenir exclusivement aux Facultés. Il y avait là toute une révolution. Du jour où de véritables Universités libres surgiraient dans le pays, il faudrait aussi pour elles des Commissions d'examen, et au nom de la Constitution, le fantôme du monopole devant les yeux, on en viendrait à réserver à des jurys mixtes une prérogative qui, ne pouvant être accordée aux Universités privées, serait déniée par contre-coup, sous prétexte d'égalité, aux Universités de l'Etat elles-mêmes.
Le gouvernement provisoire, en d'autres termes, se vit amené, en quelque sorte par la force des choses, non seulement à dispenser les étudiants de passer par les alambics des Universités (74), mais à poser un précédent dont la conséquence rigoureuse devait être que les professeurs de l'Etat n'auraient plus désormais, pas plus que leurs émules, mission de conférer des grades au nom de l'Etat.
A l'époque où nous sommes parvenus, Ph. Lesbroussart était administrateur-général de l'instruction publique. Chargé de préparer un projet de loi organique (75), il s'était rallié au système d'une seule Université, dont les quatre Facultés auraient été disséminées dans tout le pays; la collation des diplômes devait appartenir à une Commission centrale, produit de l'élection. Lesbroussart avouait luimême qu'il avait été plus préoccupé de satisfaire tout le monde, que convaincu des avantages de la dispersion des écoles. Une Commission spéciale, nommée le 30 août 1831, proposa la réunion des quatre Facultés dans une seule ville; ce nouveau projet resta dans les cartons. Une seconde Commission, nommée en 1833, fut plus heureuse: le ministre de l'intérieur approuva le travail qu'elle avait élaboré avec beaucoup de soin et d'esprit de suite, et le soumit à la Chambre des représentants. M. Ch. Rogier ne faisait qu'une réserve relative au nombre des Universités: décidément il n'en voulait qu'une (76), tandis que la Commission se prononçait pour le maintien de Gand et de Liège. La discussion ne put être aborde qu'en 1835, sous le ministère de Theux (77). Le système d'une Université unique fut écarté à cinq voix seulement de majorité; l'Université de Louvain fut seule supprimée, à la grande joie des évêques, qui y installèrent, sans perdre de temps, l'Université catholique fondée à Malines en 1834. Les libéraux avancés de Bruxelles, sur ces entrefaites, avaient ouvert dans cette ville une seconde Université libre, destinée à servir de contrepoids à celle du clergé (78): dès lors le maintien de deux Universités de l'Etat était une nécessité; dès lors aussi la question des jurys d'examen acquérait une importance capitale.
L'Union des catholiques et des libéraux n'avait pas survécu aux circonstances qui l'avaient fait naître: chacun était rentré dans son camp; on se préparait à un combat à outrance. Pour les partis extrêmes, l'enseignement supérieur était surtout un levier politique: il s'agissait avant tout de recruter, de discipliner une jeune et ardente milice, une réserve toute prête à combler les vides qui se feraient avec le temps dans les légions parlementaires. C'est à raison de cette attitude que l'enseignement libre put prendre presque instantanément un essor vigoureux. Le nombre des élèves des Universités de l'Etat diminua, comme on pouvait s'y attendre; cependant Liège ne tarda pas à reprendre une marche ascendante, grâce à l'esprit général de la population, peu sympathique, ainsi que nous l'avons déjà fait entrevoir, aux oeuvres de pure propagande. En somme, compromis par les décrets du gouvernement provisoire, par les tergiversations de trois ministères et par l'abandon systématique peut-être où on l'avait laissé, l'enseignement légal était sourdement miné; on en venait même à soutenir ouvertement, en se fondant sur une phrase de Ch. de Brouckere (79), qu'il n'avait point d'existence nécessaire et obligatoire, et que c'était tout simplement une question d'utilité. La section centrale, par l'organe de M. Deschamps, avait elle-même abondé dans ces idées, tout en reconnaissant que les garanties données par les Universités libres de Louvain et de Bruxelles ne pouvaient suffire au législateur. Ainsi était dénaturée la pensée du Congrès, qui dans sa haute sagesse avait précisément considéré l'enseignement de l'Etat comme dû au public, en présence de l'existence toujours éventuelle des institutions libres. Le Congrès avait prévu, d'autre part, le danger qu'il y aurait à livrer l'instruction publique à la merci des partis, c'est-à-dire à sacrifier à leurs dissidences les intérêts de la jeunesse et, en définitive, de la civilisation nationale. Mais les esprits n'étaient point calmes en 1835; et aussi bien, malgré les plus généreux efforts, les Universités de l'Etat avaient conservé peu de crédit. La nouvelle loi les trouva pour ainsi dire végétant, découragées, ternes, sans ressort; elles en saluèrent l'avènement avec un reste d'enthousiasme; mais elles furent longtemps à oublier le mot de mauvaise augure d'un visiteur étranger (80): Vous serez mangés, Messieurs, mangés jusqu'aux os.
Ce qui les sauva, en dépit des tâtonnements de nos législateurs et des réactions parlementaires, qui tournèrent presque toujours leur détriment; ce qui les sauva, ce qui sauva l'Université de Liège et la rendit plus tard forte et confiante, c'est encore une fois cet admirable bons sens de notre peuple, qui comprend que l'atmosphère des écoles doit être sereine, et que la jeunesse doit apprendre à penser et à étudier avant de se passionner pour les luttes du forum. Mais qu'il a fallu, pour ne point céder au torrent de fermeté, de clairvoyance et de prudence! Et pourquoi maintenant dissimuler? Neque amore et sine odio, nous dirons ouvertement toute notre pensée, sur la question du jury comme sur notre Université elle-même.
IV.
Un jury national se réunissant régulièrement dans la capitale et traduisant à sa barre tous les aspirants aux grades académiques, sans distinction aucune, autodidactes ou non, qu'ils vinssent de Liège ou de Louvain, de Gand ou de Bruxelles, des petits Séminaires, des Collèges des Jésuites ou des Universités étrangères, c'était à première vue une large institution, digne à tous égards d'un pays libre, en même temps qu'une garantie puissante contre les abus de la liberté. L'intérêt public justifiait, semblait-il, l'uniformité du programme des épreuves; les établissements privés étaient tenus de compter avec ceux de l'État, sans pouvoir se plaindre d'être assujettis à un contrôle quelconque. On exigeait des récipiendaires une certaine somme de connaissances; mais ils étaient dispensés de jurer in verba magistri. En théorie, on n'allait plus décerner de palmes qu'au vrai savoir; en pratique, il ne s'agirait que de choisir des examinateurs bien pénétrés de l'esprit de l'institution et supérieurs, par leur patriotisme et par la dignité de leur caractère, à toute idée de rivalité mesquine.
Les résultats des premières sessions donnèrent tort aux quelques membres du Parlement qui avaient soutenu, lors de la discussion de la loi, que le nouveau système péchait par la base. Il est certain que les examens redevinrent sérieux: la solennité des assises qui se tenaient à Bruxelles inspirait du respect aux récipiendaires; leurs études étaient moins étroites et plus indépendantes, puisqu'il ne leur suffisait plus d'être au courant des cahiers de leurs professeurs. Jamais peut-être diplômes ne furent plus honorablement conquis, en Belgique, que dans les années qui suivirent immédiatement 1835.
Cependant l'horizon se rembrunit peu à peu. L'institution du jury avait été viciée dans son essence par les dispositions de l'art. 41 de la loi, et, prise en elle-même, elle était incompatible avec la Constitution. Quand la première ferveur fut passée, il fallut bien le reconnaître.
Elle était viciée dans son essence par l'art 41, qui attribuait aux deux Chambres la nomination de quatre examinateurs sur sept. Dès 1836, M. Adolphe Bartels jeta les hauts cris. II ne pouvait admettre un seul instant que l'enseignement fût vraiment libre, tant que la composition des jurys serait subordonnée aux vissicitudes parlementaires. « Il dépendait de l'opinion dominante, disait-il, d'organiser le jury d'examen comme elle l'entendait. Si la majorité a fait une large part à la minorité dans le choix du personnel, c'est qu'elle y a mis de la complaisance. Car l'exercice du droit d'élection est essentiellement arbitraire. L'élection fait en toute chose prévaloir l'avis de la majorité... Qui ne comprend que ces mots: droit de concurrence et loi de la majorité s'excluent par le fait! Le despotisme ne se justifie point par la modération de son exercice... (81) ». L'implacable logicien, partisan d'ailleurs de la liberté absolue des professions, regardait le jury comme subversit de la liberté de l'enseignement et n'hésitait pas à déclarer que les Universités de l'Etat étaient destinées à périr.
L'art. 41, il faut le dire, n'avait été adopté qu'à une voix de majorité (42 contre 41) et, à titre d'essai, pour trois années seulement; mais ce provisoire fut prolongé, pour deux ans d'abord, puis d'année en année jusqu'en 1844, et de là pour quatre ans encore, malgré les efforts de M. Nothomb, qui s'était décidé à proposer de déléguer au Roi, sous certaines conditions, la nomination annuelle du jury (82). D'un autre côté, le projet de M. Nothomb accusait une tendance qui devait rendre tout à fait flagrante l'inconstitutionnalité du système. L'honorable ministre repoussait l'intervention du pouvoir législatif dans le choix des examinateurs; en revanche, il consacrait formellement un privilège, en demandant que le gouvernement fût obligé de coordonner ses choix de telle manière, que dans chaque section du Jury les quatre Universités eussent leurs représentants (83). Ce n'était pas seulement reconnaître une existence légale à deux établissements privés, à l'exclusion des Collèges de Jésuites, par exemple, qui commençaient à se compléter par des Facultés des lettres et des sciences; c'était encore réduire le jury, placé légalement et en apparence en dehors des Universités, à n'être plus qu'un établissement universitaire. En réalité, il avait fini par descendre à ce niveau, ce qui « rendait très difficile et parfois impossible la représentation des sciences, entretenait l'esprit de rivalité et de suspicion, et constituait les membres du jury en avocats de leurs élèves, alors qu'ils ne devaient en être que les juges impartiaux et sévères » (84).
D'autres inconvénients plus graves encore se révélèrent avec le temps. Le personnel des Universités était peu connu, en général, des membres de la législature; il en résulta que les mêmes professeurs furent appelés plusieurs années de suite à faire partie du jury. Or cette permanence, comme le faisait très-justement remarquer en 1842 la Faculté des sciences de Liège, établissait un véritable monopole pour les opinions scientifiques des élus. Tous les professeurs qui n'étaient point membres du jury se voyaient forcés, dans l'intérêt le plus immédiat de leurs élèves, de diriger leur enseignement d'après les opinions de leurs confrères plus favorisés, alors même qu'il leur était impossible de les adopter et de les soutenir. Quoiqu'ils en eussent, ils pouvaient être amenés à se faire complices du maintien de quelque système suranné et condamné par la science. Que devenait alors la liberté des études? Le jury pouvait à son gré enrayer dans le pays tout mouvement scientifique. De plus, le renouvellement du mandat d'un professeur-examinateur signalait son cours au public comme le plus profitable à suivre: c'était une prime en faveur de l'Université qui le comptait parmi ses membres. Avait-il composé un Manuel, les étudiants, dans tout le pays, n'en voulaient plus d'autre. Sa manière d'interroger ne tardait pas à être connue partout; on était sûr d'avoir affaire à lui; on se disait que le plus pressant étant d'obtenir un diplôme, ce serait une duperie que d'étudier la science pour elle-même ou seulement de prendre pour guide un professeur étranger au jury. Il existait, paraît-il (c'est M. Nothomb qui nous l'apprend), des recueils de toutes les questions posées depuis 1836; ou se contentait d'apprendre par coeur les réponses qui rentraient dans le cadre de ce formulaire (85).
Enfin, les élèves ayant le droit de choisir les leçons qu'ils voulaient fréquenter, il arrivait que les cours qui n'étaient pas directement représentés dans le jury demeuraient déserts dans les Universités. Le législateur de 1835 s'était moins préoccupé de l'idée scientifique que de l'idée politique; le but était manqué.
On finit par se demander: le jury a-t-il, oui ou non, le droit de juger des doctrines scientifiques? Si oui, nous retombons, sous une autre forme, dans le système du monopole reproché à Guillaume; et le mal sera d'autant plus grave que, le jury dépendant du sort des élections, la vérité d'aujourd'hui sera proclamée erreur demain, toujours au nom de l'État (86). Si non, l'État n'a rien à voir dans la nomination d'un jury scientifique. Ainsi commença à se faire jour l'opinion que soutient aujourd'hui l'Université de Liège, d'accord avec l'honorable M. Frère-Orban, à savoir qu'il est indispensable de laisser aux Universités la mission de délivrer, comme elles l'entendent et sous leur responsabilité, des diplômes scientifiques ne conférait aucun droit dans l'État. Le jury national serait dès lors entièrement étranger à l'enseignement, et n'aurait d'autre pouvoir que d'exiger des garanties pratiques de capacité, pour l'exercice de certaines professions dont la liberté absolue serait réputée dangereuse.
Cette opinion fait insensiblement son chemin; mais le jour de son triomphe est peut-être bien éloigné encore. Elle est l'expression, disions-nous, des tendances qui règnent à Liège. Avant d'y revenir plus explicitement, il nous parait utile de montrer comment il se fait qu'elle ait germé chez nous plutôt qu'ailleurs. Autrement dit, nous allons essayer de caractériser l'attitude de notre Université depuis 1835.
Les Universités libres ont été instituées dans un but de propagande: les évêques belges ont voulu offrir à la jeunesse catholique un enseignement subordonné aux principes de la foi (87); l'Université de Bruxelles a été fondée au nom du libre examen. De part et d'autre on marche en rangs serrés: on s'appelle légion, on obéit à un mot d'ordre. C'est là une puissance, et une puissance d'autant plus réelle que de part et d'autre on a voix au Parlement. Les doctrines professées à Louvain et à Bruxelles sont inconciliables entre elles; on tient dans les deux camps à le proclamer bien haut (88); par contre, on emploie volontiers les mêmes arguments, dès qu'il s'agit d'obtenir des concessions de la part de l'État (89). Les Universités de Gand et de Liège sont dans une position toute différente et moins avantageuse: ne pouvant être inféodées à un parti, elles trouvent aux Chambres moins de défenseurs intéressés à les soutenir, et le pouvoir dont elles relèvent subit lui-nième le contre-coup des fluctuations parlementaires. Mais elles ont dans le pays un point d'appui plus solide qu'on ne l'avait pensé d'abord. Les hommes modérés de toutes les opinions leur ont tendu la main: elles ont surnagé malgré tout. Peu à peu, d'ailleurs, les professeurs des quatre Universités ont appris à se connaître et à s'estimer, et les uns comme les autres ont fini par se dire qu'il y avait place pour tout le monde au soleil. Ainsi les prévisions des prophètes de malheur ne se sont point réalisées; on fait plus que de se tolérer réciproquement: non seulement les aspérités se sont adoucies, mais dans l'état du pays, l'opinion des gens qui voient clair est que les Universités de l'État sont la première sauvegarde des institutions libres elles-mêmes. Si la jeunesse tout entière était élevée au profit des partis, la lutte engagée depuis la rupture de l'Union deviendrait avec le temps une guerre d'extermination, dont le résultat, quel qu'il fût, exposerait la nation à de nouveaux hasards et mettrait tout d'abord nos chères libertés en péril.
Modération, sagesse pratique et fermeté, ces trois mots formulent la ligne de conduite imposée aux deux Universités de l'État. La politique militante doit leur rester étrangère: hors de là, point de salut pour elles. Leur enseignement doit être acceptable à droite comme à gauche, puisqu'elles vivent des deniers publics. On rendra cette justice à l'Université de Liège, qu'elle ne l'a jamais entendu autrement. Les familles libérales n'ont rien à objecter à l'enseignement de l'Etat, écrivait en 1848 M. Helfferich (90); à l'heure qu'il est, le publiciste allemand pourrait encore s'exprimer de la même manière. Ajoutons du reste que la très-grande majorité des libéraux belges, surtout à Liège, sont plutôt des partisans de la tolérance que des apôtres ou des adversaires directs de telle ou telle théorie politico-religieuse ou sociale. Restons tout à fait sur notre terrain. A Liège donc règne un libéralisme très-décidé, mais constitutionnel avant tout, nullement radical, et fort peu disposé, en fait d'éducation, à favoriser un système qui tendrait à peser d'une façon quelconque sur la liberté de penser des jeunes gens. Or, la liberté de penser n'est nullement le libre examen des rationalistes purs; elle implique qu'on puisse être rationaliste, mais aussi qu'on puisse ne l'être pas. Il y a d'autre part à Liège une minorité catholique-politique très-respectable, et qui demande à son tour que l'enseignement ne froisse pas ses convictions religieuses. C'est ce qui a été profondément et heureusement senti dans notre Université: personne n'y a sacrifié sa manière de penser; les professeurs appartiennent à telle ou telle fraction de l'opinion, c'est leur droit; mais ils se sont fait un devoir, dans leurs leçons, de ne passionner la jeunesse que pour les idées sur le terrain desquelles tous les hommes de conscience peuvent, nous allions dire doivent se rallier. De là lui est venue, à une époque où l'enseignement réorganisé par l'État ne paraissait pas être né viable, une confiance dont elle est légitimement fière. Allumer le flambeau de la science et former des citoyens, non des hommes de parti, tel a été, tel est encore son idéal; tel a été le secret de sa vigueur croissante et de sa sécurité profonde, alors même que dans le courant de ces dernières années, des influences malsaines, venues de l'étranger, avaient exalté une partie de ses élèves au nom de théories qu'ils ont été les premiers à répudier, lorsque le torrent est rentré naturellement dans son lit (91).
C'est ainsi que le vieil esprit liégeois a déteint sur l'Université et a reçu en retour, de son influence, une force et une activité nouvelles. Mais les difficultés à vaincre ont été d'autant plus ardues, que l'indépendance du Corps académique comme tel, vis-à-vis des partis extrêmes, semble avoir médiocrement plu à leurs coryphées, préoccupés par dessus tout de recruter des renforts. Il a été un temps où l'autorité supérieure elle-même a pris ombrage des réunions hebdomadaires de quelques professeurs, qui, n'avaient d'ailleurs pour but que de fortifier l'institution en provoquant d'utiles réformes, et surtout en élevant l'Université tout entière à la conscience claire de ses obligations et du rôle qu'elle est appelée à jouer dans le pays. On comprendra notre réserve à ce sujet, et au sujet des appréciations auxquelles pourrait donner lieu l'expérience qui a été faite de certaines idées émises par la Société du Samedi; mais ce que nous pouvons dire, c'est que les professeurs qui en ont fait partie ont tenté les efforts les plus louables pour créer dans l'Université cet esprit de corps, sans lequel un établissement laisse se perdre ses meilleures traditions et ne peut jamais compter sur le lendemain. On ne saurait trop le répéter: toute force qui ne vient pas d'un principe intérieur est factice et illusoire.
Mais que ceci soit bien entendu: il ne suffit pas qu'on se groupe pour former un faisceau d'influences, pour résister à des envahissements et pour réclamer des garanties légitimes. Ce qu'il faut dans une Université, c'est un esprit de corps scientifique, si l'on peut parler ainsi. Or, est-il possible l'Université de Liège, dans les conditions où elle se trouve, d'après ce qu'on vient de lire, lui est-il possible d'arriver à un tel résultat? Voilà l'importante question, en définitive, la question d'avenir. N'est-elle pas condamnée à une neutralité absolue, c'est-à-dire à la stérilité, de par sa constitution même?
C'est comme si l'on demandait si la science est nécessairement à la remorque de la politique, s'il y a nécessairement une science libérale et une science anti-libérale au sens belge de ces mots, ou si la science, cette étoile que nous avons devant les yeux, n'habite pas une région supérieure au théâtre de nos querelles. Félicitons-nous de n'avoir pas, avant d'enseigner, à passer sous des fourches caudines et de pouvoir prendre pour devise: Spiritus fiat ubi vult. Indépendance scientifique n'est pas neutralité. Officiellement neutres à l'égard des partis, nous avons précisément le droit et le devoir de ne pas l'être vis-à-vis de la vérité. Mais pour que cette prérogative et cette obligation ne soient pas illusoires, deux conditions sont nécessaires: il nous faut la liberté intérieure et la liberté extérieure.
La première nous est assurée sans contredit: le gouvernement n'exerce aucun contrôle direct ou indirect sur nos doctrines ou sur nos méthodes. On s'est vivement récrié, en 1856, lorsque M. de Decker, ministre de l'intérieur, s'émut de la dénonciation de quatre étudiants de Gand, accusant un de leurs professeurs (92) d'avoir nié, dans son cours public, la divinité du Christ, et des propositions anticatholiques émises par un autre professeur gantois dans un livre de philosophie étranger à son enseignement (93). Le droit strict de ce dernier, comme publiciste, n'était pas à méconnaître; quant au premier, si l'accusation eût été fondée (94), on ne peut disconvenir que le gouvernement n'était pas moins tenu de faire respecter la liberté de conscience des élèves que de respecter lui-même celle du professeur, et qu'après tout il eût été juste de dire à ce dernier: non erat his locus. La fausse position du ministre tenait à ce que, chaque cours n'ayant qu'un seul titulaire et les élèves étant tenus, depuis 1849, de suivre tous les cours, la responsabilité de l'autorité supérieure se trouvait directement engagée. A y regarder de près, M. de Decker ne fit que subir les conséquences de la situation. Mais il n'est jamais entré dans sa pensée, non plus que dans celle d'aucun ministre belge, de prescrire aux professeurs des Universités l'obligation de se rattacher à une doctrine quelconque en philosophie, en histoire, en droit naturel, en économie politique. Nous sommes libres, tout ce qu'il y a de plus libre, dans les limites de notre mandat. Cependant, comme il est difficile, dans l'enseignement de certaines sciences, de ne pas au moins toucher en passant à des questions brûlantes, les susceptibilités peuvent toujours trouver occasion de s'éveiller. Il n'y a qu'un seul moyen de donner satisfaction à tout le monde et de prévenir le retour d'incidents tels que ceux qu'on vient de rappeler, c'est que l'Etat se décharge de sa responsabilité sur les professeurs eux-mêmes; c'est qu'en un mot on nous accorde ce que nous appelons la liberté extérieure.
On va voir reparaître ici la question du jury. Parce qu'il y a un jury universitaire, il y a forcément un programme d'études commun à toutes les Universités. Voilà ce qui nous lie pieds et mains et ce qui met une sourdine à la science (94). Que chaque institution d'enseignement supérieure soit rendue à elle-même; que chacune compose son programme à l'instar des grandes Universités allemandes, et tout sera dit. Comme complément de ce système, que les cours redeviennent libres: les étudiants, bons juges de leurs intérêts et tenus en haleine par la perspective d'un examen sévère, fréquenteront ceux qui répondront le mieux à leurs besoins immédiats et d'autre part à leurs propensions individuelles. Dès lors la concurrence deviendra une nécessité: un professeur pourra, si cela lui convient, enseigner même le matérialisme 96); l'Université, en légitime défense, ne manquera pas de lui susciter un opposant, et la science y gagnera. Non seulement le système actuel tend à amoindrir les Universités et à les réduire à n'être que de simples écoles; mais il contribue indirectement à égarer la jeunesse. Depuis quelques années, des théories sociales aventureuses se sont répandues dans toute l'Europe, et en philosophie, une sorte de scepticisme nuageux d'une part, le positivisme de l'autre font appel à la génération nouvelle. L'enseignement, tel qu'il est organisé, ne peut contribuer suffisamment à la prémunir contre des séductions auxquelles elle est d'autant plus exposée, qu'à vingt ans on est presque toujours secrètement prévenu en faveur de l'opposition aux idées reçues, et d'autant plus que les innovations sont plus audacieuses et qu'on a moins d'expérience. Or en se traînant, forcément dans l'ornière de leur programme, les professeurs, malgré tout le talent du monde, perdent chaque jour un peu de leur influence, et il se forme clandestinement, en dehors de leur action, un noyau de jeunes adeptes de doctrines dont le crédit serait singulièrement ébranlé, si la liberté de la chaire était telle que nous la souhaitons. Et supposons même que ces doctrines trouvent des apôtres dans nos auditoires; encore une fois elles y trouveraient aussitôt des contradicteurs, et elles cesseraient du moins d'offrir aux étudiants l'attrait du fruit défendu. Il est presque trivial, mais il est opportun de répéter que la liberté est comme la lance d'Achille, qui guérit les blessures qu'elle a faites.
M. Dechamps a laissé tomber du haut de la tribune, le 29 mars 1844, une parole fatale: Le jury d'examen, a-t-il dit, est le gouvernement de l'enseignement supérieur. Aucune interprétation de la loi n'aurait pu porter un plus grand préjudice aux bonnes études et paralyser plus sûrement l'essor de la jeunesse belge. Le jury d'examen gouvernant les Universités, quel que soit son mode de composition, c'est la consécration d'un monopole anti-scientifique, c'est la décadence de l'enseignement supérieur, préparée par la loi. Le jury combiné, qui remplace le jury central depuis 1849 (97), n'a fait qu'aggraver le mal auquel on a voulu porter remède en modifiant la loi de 1835. Aujourd'hui l'élève est interrogé directement par son professeur, sous le contrôle du professeur d'une Université rivale, chargé du même cours. La combinaison est telle, que les deux Universités de l'Etat ne se rencontrent jamais au jury, non plus que les deux Universités libres on a voulu sans doute, pour ces dernières, éviter les froissements. Qu'on se figure Krause appelé à contrôler Tongiorgi, les idées de M. Altmeyer aux prises, en plein jury, avec celles de M. de Gerlache! On a donc pris la précaution, pour conduire les récipiendaires au port, de ne jamais laisser le loup avec la chèvre, ni la chèvre... Les Universités de l'Etat, considérées comme neutres, sont tour à tour en présence de Bruxelles et de Louvain. La position n'est fausse, en définitive, que pour elles; mais elle est peu digne pour tout le monde. On est placé dans cette alternative collision ou collusion. Avec le temps, il est vrai, on s'habitue à ce mariage forcé; mais le niveau des examens baisse, parce que chaque professeur est en droit de dire à son confrère: ceci n'a pas été enseigné. Que faire alors? Il suffit qu'un élève sache bien son cahier pour être admis: aussi, que de fruits secs parmi les distinctions! Dans les quatre Universités, aux Chambres, partout, on est convaincu. de l'influence délétère du système: on n'a trouvé, après mûre réflexion, d'autre moyen de relever les études, que de simplifier les examens au lieu de relever des études, on les a matérialisées en considérant officiellement comme accessoires toutes les sciences dont l'utilité professionnelle n'est pas immédiate, toutes celles qui élèvent l'esprit, qui lui ouvrent un vaste champ, celles mêmes qui contribuent le plus directement à l'éducation du citoyen. Le temps est venu de brûler la vieille idole: il est urgent de rayer une fois pour toutes de notre Credo ce malheureux article: Le jury est le gouvernement de l'enseignement supérieur.
La science ne peut être gouvernée: c'est à elle de gouverner les esprits, sous peine de mort pour la civilisation. Mais elle ne peut gouverner si elle n'est libre, et elle ne sera libre en Belgique que quand le jury usurpateur aura disparu.
Alors seulement notre Université aura son esprit de corps scientifique; alors seulement les résultats seront en raison directe des efforts; alors seulement l'enseignement supérieur belge, ofliciel ou privé, sera digne des institutions nationales.
On veut la liberté des études, la liberté de la pensée, et le jury nous dit chaque année Vous n'irez pas plus loin! Il est logique, dès lors, qu'on s'effraye de nos moindres audaces. Laissez chacun libre, mais que chacun soit seul responsable de ses actes, devant le public d'abord, et devant l'autorité dont il relève alors nous serons stimulés, et nous n'en serons pas moins sages. Le jury isole les professeurs; il est nécessaire de les rapprocher, de leur inspirer la noble ambition de faire école. Laissez-nous graviter dans notre orbite: plus de systèmes de transactions, d'équilibre apparent, de concessions aux majorités. La formule est bien simple: Le jury doit être séparé de l'enseignement, comme l'Etat est séparé de l'Eglise.
Cette séparation, nous l'attendons Liège comme la manne du ciel, et nous la réclamons depuis longtemps, parce que la liberté nous est chère comme aux populations qui nous environnent, et parce que sans la responsabilité directe des professeurs, l'enseignement de l'Etat, dans l'esprit de notre Constitution, ne saurait légitimement exister. L'Etat n'a point par lui-même de doctrine; en revanche, il doit à la nation des moyens de s'instruire. Mais sous peine de monopole, il doit aussi respecter le droit imprescriptible de la science, qui est d'être pleinement libre. De là c'est à nous, qui représentons la science, et non pas à l'Etat, qui ne fait qu'en garantir par nous la propagation, que doit revenir toute la responsabilité.
De ce que l'enseignement est constitutionnellement libre et de ce que l'Etat belge ne peut être juge en matière doctrinale, il résulte immédiatement que le système préconisé par l'Université de Liège est le seul justifiable. Les lois qui nous régissent ont consacré un privilège eu faveur des Universités de Bruxelles et de Louvain; les intéressés s'en prévalent; nous le concevons. Mais il y a aussi d'autres institutions non moins respectables, pour n'être pas complètes, auxquelles on a jeté en quelque sorte en pâture ce qu'on appelle actuellement le jury central (98), et qui ne doivent être satisfaites que tout juste de n'avoir aucune influence directe sur la confection des programmes d'examen (99). Celles-là aussi ont droit à une pleine satisfaction; et après tout, les professeurs ou répétiteurs privés qui préparent isolément des élèves aux examens ne sont pas de ces minima dont le préteur est dispensé de se préoccuper. Or, tant que les jurys actuels existeront, tous les Belges ne seront pas égaux devant la loi de l'enseignement supérieur. Monopole ou non monopole, il n'y pas de milieu. Le système de Liège, c'est l'abolition de tout monopole. Qu'on le complète, qu'on l'amende, qu'on le modifie; nous ne tenons qu'au principe: point de monopole!
Puisque l'État n'est pas juge en matière doctrinale, il est évident qu'il n'a pas le droit d'instituer des jurys scientifiques. Ce droit appartient naturellement et pleinement à qui enseigne; et comme en Belgique tout le monde peut enseigner, ce droit appartient donc à tout le monde. Mais le certificat de capacité ou le diplôme ne peut conférer par lui-même aucune prérogative dans l'État, puisque l'État n'a pas lui-même le droit d'en apprécier la valeur ou seulement la sincérité (100). Ce diplôme ne saurait être autre chose qu'un titre scientifique, dont le relief sera en raison du renom de l'Université ou du corps quelconque, ou du simple professeur qui l'aura délivré. Par parenthèse, ce serait là un puissant stimulant pour les Universités: si elles se livraient à un honteux trafic, elles seraient bientôt discréditées; elles auraient tout intérêt à se montrer sévères, et libres qu'elles seraient les unes comme les autres dans leur sphère d'activité respective, leur concurrence prendrait le caractère d'une généreuse émulation: engagées dans des voies différentes, mais poursuivant un but unique et haut placé, elles travailleraient fraternellement et sans arrière-pensée à l'émancipation intellectuelle de la jeune Belgique.
Les passions du jour et les intérêts privés mal entendus, tels sont les obstacles à vaincre: ils sont redoutables sans doute; mais nous croyons au progrès irrésistible de la justice et de la vérité.
Le devoir de protéger la société contre les charlatans, les faiseurs de dupes et tutti quanti, d'autre part, ne peut nécessairement incomber qu'à l'État. - M. Ad. Bartels fait remarquer spirituellement que ni Galien ni Cicéron, ni Hippocrate ni Démosthènes n'avaient pris leurs grades ou couvert leur chef d'un bonnet carré, et il se demande si les plaideurs en étaient plus grugés et les malades plus assassinés que de notre temps. « Ne semble-t-il pas, ajoute-t-il, que les individus ne sachent gouverner aussi bien leur santé et leur prospérité que le gouvernement, et que nous ayons tous besoin, dans nos intérêts les plus chers et les plus personnels, d'être défendus contre notre propre imbécillité comme des enfants en tutelle? (101) » Comparaison n'est pas raison. Il ne s'agit pas de tutelle, mais de légitime défense. En Angleterre, un empirique pratiquant sans diplôme peut être attrait devant le jury: le voilà condamné du chef d'ignorance; la famille qu'il a décimée en sera-t-elle moins en deuil? En serez-vous moins ruiné parce que la vindicte publique atteindra le mauvais agent d'affaires qui aura compromis votre cause? Les expériences in anima vili sui la vie et sur la fortune des citoyens peuvent-elles donc être permises? Si les cas d'empoisonnement par les débitants de drogues sont rares, n'est-ce pas grâce à la double garantie du diplôme et de la surveillance exercée par les Commissions médicales? La manie de supprimer toute police nous ramènerait finalement à la barbarie; de déductions en déductions, tous en viendrions à être obligés de nous armer chacun pour notre défense personnelle et d'avoir recours à la loi de Lynch. La suppression des garanties contre les abus de la liberté serait attentatoire à la liberté même, qui est inséparable de l'ordre et de la sécurité des personnes; autant vaudrait déchirer tout contrat social. Enfin, les institutions qui conviennent à un peuple ne conviennent pas toujours à un autre: l'exemple de l'ancienne Rome ou de l'Angleterre ne prouve nullement que nos moeurs et nos habitudes puissent de longtemps s'accommoder d'un système qui consacrerait la liberté de tuer les gens au préalable.
Quoi qu'il en soit, ce qui nous paraît hors de doute, c'est que si l'État a ici un devoir à remplir ou s'il peut revendiquer un droit, ce qui revient au même, ce ne peut être qu'un droit de police. Le jury ne doit avoir rien de commun avec l'enseignement. Les Universités ont un but scientifique; le jury professionnel n'aura jamais qu'à répondre à cette question : « Y a-t-il ou n'y a-t-il pas danger de confier à tel récipiendaire la vie ou la fortune des citoyens? (102) » - Mais, en attendant qu'une solution définitive soit donnée au grave problème des examens, comment vivons-nous ?
V.
Le grand travail de M. Nothomb, déjà tant de fois cité, les premiers volumes des Annales des Universités de Belgique, les Rapports triennaux publiés par le département de l'intérieur, enfin, contiennent tous les éléments d'une histoire administrative de notre Université, aussi bien que de celle de Gand. Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à ces documents précieux, plus riches en renseignements qu'aucun recueil analogue édité, à notre connaissance, dans les pays étrangers: il nous a paru que les questions financières, l'organisation de Ia caisse des pensions, les mesures relatives aux bourses d'étude ou de voyage, etc., ne pouvaient attirer notre attention dans cet ouvrage, tout entier consacré à la vie intérieure de notre institution. Qu'il nous suffise de rendre hommage, en passant, au zèle et à la sollicitude de l'administration centrale, qui, dans les circonstances les plus difficiles, n'a cessé de contribuer, par sa vigilance et par son attitude impartiale, au maintien de la prospérité des Universités de l'État et à la défense de leurs légitimes intérêts (103).
Aussitôt après la promulgation de la loi du 27 septembre 1835, le gouvernement se préoccupa de pourvoir aux chaires vacantes. On n'était plus sous l'empire des préjugés de 1817 et de 1830; personne ne trouva mauvais que le ministre fit appel à des savants étrangers. L'affaire Gibon (v. ci-après, col. 337 et suiv.) faillit cependant mettre encore une fois le feu aux poudres. La nomination de l'excellent professeur Tandel la chaire de philosophie calma les esprits; le gouvernement n'eût pu faire un choix plus heureux et plus prudent.
Un autre incident, la querelle du baron de Reiffenberg et d'Ed. Lavalleye (104), au sujet d'un manuscrit de S.-P. Ernst, que le premier avait publié sous son propre nom, défraya pendant quelque temps la presse militante: de Reiffenberg devint impossible à Liège. Cette dernière agitation fut au reste sans importance; en somme, à partir de 1835, l'Université entra dans une période de paix studieuse et féconde. Le corps enseignant était renforcé et se montrait animé d'une généreuse ardeur; les étudiants partageaient le zèle de leurs maîtres. Les inconvénients inhérents au nouveau système d'examen ne s'étaient pas encore révélés. Les premiers actes du jury avaient inspiré une terreur salutaire; enfin, la liberté laissée aux élèves de ne pas fréquenter tous les cours, loin de produire les effets qu'on lui attribua plus tard, empêchait les professeurs de s'endormir sur un doux oreiller et disposait les jeunes gens à travailler par eux-mêmes. Leurs études n'étaient uniformes que tout juste assez pour répondre aux exigences du jury. Celui qui écrit ces lignes était alors sur les bancs: il sait à quoi s'en tenir.
On a vu qu'avant la révolution, les circonstances extérieures avaient contribué à mettre particulièrement en relief la Faculté de droit. Soit que la carrière du barreau parût pour un temps encombrée et que la magistrature, dont les cadres avaient été récemment renouvelés, offrît peu d'avenir à la jeunesse; soit que l'essor vigoureux que commençait à prendre l'industrie nationale fît réfléchir les familles; soit enfin que le courant des idées eût pris une direction nouvelle, et que l'enthousiasme pour, les sciences morales et politiques se fût refroidi après la conquête de nos libertés, toujours est-il que les études juridiques furent graduellement délaissées. La Faculté de droit comptait d'aussi bons professeurs que jamais: elle continua de former d'excellents élèves; mais elle n'était plus poussée par un vent favorable. La Faculté de philosophie, où elle se recrute, se trouva réduite à sa plus simple expression jusqu'en 1842, date à partir de laquelle on commence à constater un mouvement ascendant. La Faculté de médecine souffrit aussi, mais relativement moins, et surtout à cause de l'érection des deux Universités libres. Le flot des étudiants envahit les auditoires de la Faculté des sciences ou plutôt des Ecoles spéciales, dont la première réorganisation remonte à 1836. Ne résistèrent au torrent que ceux qui se sentaient une vocation véritable; de là, si les trois Facultés délaissées n'eurent à inscrire pendant quelques années qu'un petit nombre d'élèves, la qualité suppléa à la quantité. Tel tut le premier engouement pour les sciences appliquées, qu'on vit entrer aux Ecoles maints aspirants sans aucune aptitude, quittes à en sortir au bout d'un an, tout étonnés d'y avoir été dépaysés, et à reprendre ensuite, quelques-uns avec grand succès, des études dont l'entraînement irrésistible de l'exemple avait seul pu les détourner. Cet empressement ne fut pas sans influence sur l'organisation intérieure des Ecoles, et plus tard sur l'institution d'un sévère examen d'admission.
Ce qui a contribué, d'autre part, au crédit et à la prospérité des Ecoles, c'est la circonstance qu'on n'a pu leur contester le droit de délivrer elles-mêmes des diplômes de capacité. Ces diplômes, à l'exception de celui d'ingénieur des mines, qui est conféré au nom de l'État par des représentants de l'administration, n'ont aucune valeur officielle, et il semble que les sociétés industrielles n'en fassent que plus de cas. La renommée des Ecoles de Liège est devenue universelle: les jeunes gens qui y ont été reconnus capables sont partout recherchés des quatre points cardinaux, des deux hémisphères, on est venu, on vient encore solliciter leur parchemin. C'est que, encore une fois, tant vaut l'institution, tant vaut le diplôme. On a fait ici une première expérience heureuse de la liberté des études telle que nous l'entendons; il dépendrait de nous seuls, si le jury d'examen n'avait plus qu'un caractère professionnel, de rendre également enviables les diplômes scientifiques de Liège!
Les Ecoles spéciales, se dirigeant elles-mêmes sous le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire indépendantes d'un jury et d'un programme étrangers, ont trouvé dans leurs anciens élèves le plus solide de leurs points d'appui. Les ingénieurs qu'elles ont formés portent leur cocarde; leur nom est pour eux une lettre d'introduction dans le monde. Ils ont donc à coeur l'honneur de l'établissement. Ils se regardent comme les premiers intéressés à la continuation de ses succès; ils aplanissent volontiers l'entrée de la carrière aux nouveaux diplômés. Ainsi se nouent des relations durables; ainsi se développe un esprit de confraternité qui est pour tous, et pour les Écoles ellesmêmes, un principe de force et de progrès. Ces dispositions se sont hautement manifestées par la fondation d'une Association des ingénieurs sortis des Écoles de Liège, qui compte aujourd'hui dans son sein la plupart des chefs de nos grands établissements d'industrie, et dont le rayonnement s'étend chaque année (105). Indépendamment des services que rend cette excellente institution à l'industrie nationale tout entière, en entretenant chez ses membres le goût des études solides, c'est surtout grâce à elle que les efforts des débutants ne restent pas isolés ni méconnus. Elle réagit en outre indirectement, par ses travaux et par sa vigilance, sur les Ecoles elles-mêmes, et en plus d'une circonstance son influence y a provoqué d'utiles améliorations.
De tels résultats seraient difficilement atteints dans les Facultés universitaires proprement dites.
D'abord les étudiants y travaillent chacun pour soi, à domicile, tandis que le régime intérieur auquel les Ecoles sont soumises met incessamment les élèves-ingénieurs en contact les uns avec les autres. Ensuite, ils n'ont guère l'occasion d'être interrogés pendant l'année, ce qui les laisse plus ou moins dans l'incertitude, jusqu'au jour de l'examen, sur leurs chances de réussite. Tout au plus se réunissent-ils par petits groupes, pour revoir ensemble les matières du programme. Cet isolement n'est pas un mal en ce sens, qu'il développe le sentiment de la responsabilité personnelle; il répugne d'ailleurs l'essence des études libérales que ceux qui s'y livrent soient enrégimentés d'une manière quelconque, et la régularité des interrogations n'est guère de mise, au degré supérieur de l'enseignement, que dans le domaine des sciences tout à fait positives. Cependant il est permis de recommander un terme moyen. Quelques professeurs ont obtenu d'excellents résultats en ouvrant de temps en temps des conférences, où les élèves traitent tour à tour soit des sujets de leur choix, sur les matières du cours, soit des questions qui leur ont été posées d'avance et sur lesquelles s'engage, au besoin, une discussion générale. C'est là une excellente mesure, mais une simple affaire de méthode, sans influence sur les rapports des étudiants entre eux.
Il serait à coup sûr très-avantageux de resserrer leurs liens et de les rapprocher de leurs professeurs; seulement, il faut se garder de peser sur eux, ou même d'avoir l'air de le faire. Il n'est pas moins dangereux de les abandonner tout à fait à leurs enthousiasmes irréfléchis. Leur nature généreuse et expansive leur fait un besoin de se voir et de s'entendre: les plus entreprenants proposent la création d'une société dont le but sera littéraire et scientifique; on s'assemble, on réglemente, tout marche admirablement pendant quelques mois; puis la discorde s'introduit au camp d'Agramant; les orages des débats font oublier la fin qu'on s'était proposée; la société devient un club où l'on va s'exalter et voter la régénération de l'espèce humaine, ou perdre tout bonnement son temps, sous prétexte de se reposer de fatigues qu'on n'a point subies. Enfin tout s'évanouit: les esprits sérieux se remettent au travail, les autres vont s'amuser ailleurs; tous quittent finalement l'Université et se perdent de vue; à peine reste-il un souvenir des bruyantes soirées où l'on renouvelait vingt fois des serments de fraternité.
Dans toutes les Universités de l'Europe ces choses se sont passées: il faut être indulgent pour ces associations éphémères, et peut-être faut-il voir un avertissement dans leur renaissance périodique. Peutêtre, à côté de ces réunions libres et dans lesquelles on doit bien se garder de s'immiscer, serait-il éminemment avantageux d'instituer, dans nos Universités de l'Etat, quelque chose d'analogue à la Société littéraire de l'Université de Louvain, à laquelle restent affiliés les anciens élèves. Il existe aussi, sous une autre forme et dans d'autres conditions, une solidarité entre les professeurs et les anciens élèves de Bruxelles. Des séances consacrées à des lectures, des concours, des discussions scientifiques, il ne serait pas au-dessous de la dignité professorale d'organiser tout cela et d'y imprimer un caractère sérieux. On publierait, régulièrement un Annuaire ou des Mémoires; on resterait en rapport avec l'Université après avoir quitté ses bancs; 0n y reviendrait de temps en temps, aux assemblées générales, pour retremper les vieilles amitiés et en former de nouvelles; en attendant, on aurait vécu dans une atmosphère studieuse, et bien des jeunes gens qui ne travaillent aujourd'hui que pour les examens acquerraient, d'abord parce que leur amour-propre serait stimulé, ensuite parce qu'il suffit le plus souvent d'essayer ses forces pour devenir désireux de les déployer tout entières, le goût du travail pour la science, qui est le plus doux de tous les fruits malgré l'amertume de son écorce.
Une institution semblable nous animerait d'une vigueur nouvelle et remplacerait avec avantage le Concours universitaire, qui, dans les conditions où il est établi, n'a obtenu qu'une assez mince popularité parmi les étudiants (106).
Hâtons-nous d'ajouter que le zèle individuel, au service de talents supérieurs, a plus ou moins compensé l'absence d'une institution que nous ne cesserons jamais de considérer comme un important desideratum. Un Dumont se rencontre-t-il, son influence familière prend les proportions d'une royauté scientifique: comme la nuée du désert, sa trace lumineuse guide la foule des chercheurs vers la terre promise. Un Dupret ne forme pas seulement des avocats, mais des jurisconsultes. Des herborisations de Ch. Morren, on revenait passionné pour la botanique. Tandel, avec sa gravité modeste, a fait vibrer dans bien des âmes des cordes jusque là muettes; le nom de Brasseur vivra non seulement dans la science, mais dans les annales de l'enseignement, parce que son enseignement était comme une révélation. Nous nous arrêtons, de peur de parler des vivants... Mais, avec de telles ressources, à quels progrès ne pourrait-on pas prétendre si, grâce à la mise en commun et en lumière de tous les efforts, on en venait à se connaître de plus près et à s'organiser véritablement, nous tenons à ce mot, en corps scientifique! On s'élèverait graduellement aux hauteurs de la science comparée, la seule qui, dans un avenir dont on entrevoit déjà l'aube, méritera définitivement le nom de science. Malgré tous les obstacles, malgré les jurys, malgré les systèmes de tâtonnements, nous pourrions enfin remplir notre rôle d'Université, universitas scientiarum.
Il règne dans le public, en ce temps d'utilitarisme, des idées assez fausses sur la nature des Universités. Elles ne sont ni de simples écoles, ni des Compagnies savantes au sens des Académies. Elles participent de la nature des premières, puisqu'elles enseignent; de la nature des secondes, en ce qu'elles doivent cultiver et honorer la science pour elle-même, et non pas seulement à cause des avantages matériels qu'elle procure. A la différence des écoles dites spéciales, elles ne se contentent pas de frayer la voie aux jeunes gens qui se proposent d'aborder telle ou telle carrière; leur enseignement doit avoir une portée philosophique et sociale; elles sont tenues d'apprendre à leurs élèves à penser et à travailler pour leur propre satisfaction et en vue du perfectionnement de leurs semblables; enfin, elles ont mission de former de bons citoyens: sous tous ces rapports, elles ont à remplir une tache éducative. Sur le terrain de la science pure, d'autre part, elles se proposent une fin analogue à celle des Académies; mais leur façon de procéder est toute différente. Que sont les Académies? Des réunions de savants et de gens de lettres, groupés dans le but de se communiquer réciproquement leurs découvertes, de juger des concours ouverts sur des sujets imposés, d'encourager les travaux isolés de quelques néophytes. Elles ont des couronnes pour le talent ; elles ont un champ clos pour les luttes courtoises que se livrent, au profit de tout le monde, les chercheurs de la vérité. Cependant, par la force des choses, l'arène est assez peu fréquentée; le sanctuaire de l'érudition est réservé aux seuls initiés; la publicité des Mémoires est plus officielle que réelle; le choix des questions à traiter tient ordinairement aux prédilections de quelque spécialiste; l'universalité des recherches, l'esprit de suite, sont pour ainsi dire impossibles. L'utilité, l'importance des Académies ne sauraient être révoquées en doute; il faudrait les créer si elles n'existaient pas; les objections de leurs détracteurs nous touchent peu. Mais les Universités sont appelées à coopérer d'une manière plus efficace ou du moins plus directe au développement intellectuel des populations. Elles n'ont pas seulement pour mandat de dogmatiser et d'exiger de leurs élèves qu'ils satisfassent à un programme: elles manqueraient à leurs devoirs si elles ne cherchaient pas, elles aussi, à faire avancer la science. Leurs moyens d'action résultent de leur constitution même. Ce serait se méprendre du tout au tout que de les considérer seulement comme des êtres collectifs: elles sont par essence de véritables personnes morales, ayant leur individualité propre, leur unité irréductible: n'en est-il pas ainsi, Non ragioniam di lor... Une Université digne de ce nom constitue un tout organique, dont chaque organe, en remplissant à sa manière les fonctions qui lui sont assignées, concourt à entretenir la vie de l'ensemble et à réaliser une fin unique. Elle représente l'arbre entier du savoir humain, dont les branches s'atrophient quand la sève qui monte du tronc ne circule plus dans leurs canaux. La sève, c'est ici l'esprit philosophique, l'esprit de synthèse, qui conduit à cette science comparée dont nous parlions tout à l'heure. Que le physicien, le chimiste, le physiologiste poursuivent isolément le cours de leurs expériences, sans s'inquiéter de faire tort ou non aux théories reçues: nous l'entendons bien ainsi. Mais qu'ils se gardent de prétendre qu'eux seuls possèdent tous les éléments des problèmes de la nature ou de l'esprit: c'est ce que nous exigeons également. L'enseignement universitaire est organisé de manière à faire ressortir la dépendance mutuelle des sciences, tout en assurant à chacune liberté pleine et entière dans sa sphère d'activité. Que les Universités modernes se rendent bien compte de cela, elles travailleront plus sûrement que les Académies à répandre le véritable esprit scientifique. Avant tout elles disciplineront les intelligences; elles renouvelleront l'apostolat de Socrate. Les Académies constatent des résultats; les Universités sont instituées pour rendre ces résultats possibles et pour en assurer le retour de plus en plus régulier. Or, pour cela, elles sont en mesure d'opérer sur la plus large échelle et de stimuler à la fois toutes les capacités, puisque leur caractère propre est d'être des encyclopédies vivantes et parlantes. Tel est l'idéal qu'ont poursuivi avec une constante énergie les Universités allemandes, par exemple; et c'est ce même idéal qui a présidé en 1817, sans contredit, à la première constitution des Universités belges. Les questions politiques l'ont fait perdre de vue: mais à nous prendre chacun isolément, qui parmi nous a renoncé à lui vouer un culte secret? Nous ne demandons qu'une chose: c'est de pouvoir, sous notre responsabilité exclusive, travailler à sa réalisation et répondre ainsi, dans des conditions normales, à la légitime attente du gouvernement et du pays.
VI.
Il y aurait injustice à ne pas reconnaître qu'on a fait tout ce qu'il était possible de faire pour tirer bon parti de la situation. Une excellente mesure prise en 1849, par exemple, c'est la création de l'examen d'élève universitaire, remplacé depuis, après une suppression de quelques années, par l'épreuve de gradué en lettres. L'institution du jury offre moins d'inconvénients pour les élèves sortant de rhétorique que pour ceux qui ont décidément abordé les hautes études; dans tous les cas, on a fait preuve de sagesse en donnant un avertissement aux familles trop aisément tentées, de nos jours, d'engager leurs enfants dans les carrières libérales, alors qu'ils ne pourraient qu'y végéter, en supposant qu'ils parvinssent à terminer leurs études. On a vu aussi un danger social dans l'encombrement de ces carrières; on s'est dit que la seule, ressource des avocats sans clientèle était de se joindre quand même aux mécontents, dans un pays de liberté où cette attitude, à elle seule, peut être un moyen d'acquérir du relief. Ce sont les mêmes vues qui ont déterminé en 1850 l'institution des écoles moyennes, établissements tout pratiques destinés à la classe qu'on est convenu d'appeler la petite bourgeoisie. Soumettre à un même programme d'études tous les élèves pour lesquels l'instruction primaire n'est pas suffisante, c'est exposer ceux qui doivent, le plus tôt possible, racheter les sacrifices de leurs parents, à n'aborder la vie pratique qu'avec des connaissances incomplètes dont ils ne sauront que faire; c'est aussi induire en erreur ceux qui, séduits par des succès de collège, se trompent sur leur vocation et sont aisément disposés à rougir de la condition où ils sont nés. Offrir à chaque catégorie de jeunes gens le genre d'éducation qui lui convient, arrêter au seuil de l'Université ceux qui ne le franchiraient qu'au détriment de la société et d'euxmêmes, rien ne pouvait être plus opportun et plus prudent. La loi de 1849 sur l'enseignement supérieur et la loi de 1850 sur l'enseignement moyen, ne fut-ce qu'à cet égard, doivent être accueillies comme de véritables bienfaits.
L'enseignement supérieur n'a point tardé à se ressentir de leur influence, notamment les Facultés de philosophie. Comme il est convenu qu'il n'y a plus d'enfants, on avait vu sur nos bancs des phénix sortant de troisième ou de quatrième : fort heureusement la loi n'a point eu égard à leur précocité, et les professeurs ne se sont pas plaints de n'avoir plus pour auditeurs que des rhétoriciens éprouvés.
Cependant, comme le bienfait d'une réforme ne se fait pas immédiatement sentir, il est arrivé qu'en 1849, sous l'impression des derniers résultats fournis par le jury central, on s'est tout d'un coup jeté dans un courant d'idées justes en elles-mêmes, mais paradoxales quand on s'y abandonne sans réserve. Les programmes des examens étaient surchargés; en les simplifiant outre mesure, on a perdu de vue que les sciences isolées brûlent et dessèchent l'esprit (107). Il est de fait que les élèves ne connaissent pas mieux le droit positif depuis qu'ils négligent le droit naturel, et que leur quasi-nullité en histoire ne les rend pas plus forts en philosophie. Ils possèdent mieux leur examen, peut-être; mais l'organisme des sciences n'existe point pour eux; ils vont droit au but immédiat sans s'élever, par la comparaison, à un point de vue philosophique, et l'étude des sciences morales elles-mêmes, réduite à sa plus simple expression, n'éveille pas en eux des méditations fécondes.
Le programme condensé auquel ils ont à satisfaire, en revanche, ils doivent le posséder tout entier tel qu'il a été enseigné, parce que, dans le système du jury combiné, c'est à leurs professeurs qu'ils ont à répondre. Une conséquence inévitable de la loi nouvelle a donc été l'inscription globale. On peut défendre cette dernière mesure au nom d'un intérêt disciplinaire; en elle-même, elle n'est propre à stimuler ni les professeurs ni les élèves. Elle rapetisse l'enseignement supérieur; elle transforme les Universités en fabriques de diplômes.
Pour ne pas emprisonner tout-à-fait la jeunesse dans un cercle de Popilius, on a institué des cours libres, sur des matières non portées au programme. Quelques cours ont réussi comme ils méritaient de réussir; mais il n'y a guère à compter, l'expérience l'a prouvé, sur un zèle durable de la part des auditeurs. Le fantôme du jury suit partout l'étudiant, qui en vient presque à se reprocher d'avoir meublé son esprit d'autre chose que de ce qu'il doit savoir.
Qu'arrive-t-il alors? Que les jeunes docteurs qui brûlaient du désir de faire preuve de talent, pour conquérir tôt ou tard une chaire académique, finissent par changer de mobile, et que le recrutement du corps professoral n'est pas moins difficile qu'autrefois. Ce ne sont point des critiques que nous voulons formuler: mais il nous paraît utile de profiter de l'occasion qui se présente à nous, pour insister sur l'importance des questions qui sont encore à résoudre.
Malgré les entraves au progrès, résultant de ce que le titre III de la loi qui nous régit n'a pas encore reçu sa rédaction définitive, ce serait une erreur de s'imaginer que nous roulons le rocher de Sisyphe. Ce n'est pas seulement à raison du chiffre de sa population qu'on peut dire de notre Université qu'elle a suivi, depuis un quart de siècle, une marche ascendante. L'arrêté du 3 novembre 1847, prescrivant l'institution de cours normaux pour les humanités, n'a fait qu'aller au devant des voeux de la Faculté de philosophie, fidèle à ses traditions. Ce sont encore ses professeurs qui entretiennent le feu sacré à l'Ecole normale, en même temps que le doctorat en philosophie et lettres, si rarement ambitionné autrefois, est régulièrement sollicité, depuis vingt ans, même par des jeunes gens qui ne se destinent pas à l'enseignement. Les diplômes de docteur en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques sont aussi beaucoup plus nombreux qu'autrefois: c'est un autre fait significatif. Le cours facultatif de droit international compte un noyau d'auditeurs assidus; le diplôme de docteur en sciences politiques et administratives a cessé d'être une rareté. En médecine, non seulement le doctorat spécial (108) est en vogue, mais à peine diplômés, nos jeunes praticiens apportent leur contingent aux publications académiques et se constituent en société (109) pour s'entretenir dans l'habitude du travail scientifique et se communiquer leurs observations. La Faculté des sciences a fondé la Société royale, dont les Mémoires sont estimés dans les deux mondes. Les Ecoles spéciales ont la Revue universelle et les Bulletins de l'Association des ingénieurs. Les premiers succès des laboratoires de recherches (110) sont du meilleur augure; les études physiologiques sont plus encore l'objet d'un zèle désintéressé. Il ne nous manque, en physique et en chimie surtout, que des ressources matérielles moins limitées, pour prendre insensiblement place à côté des Universités d'Outre-Rhin, où il est possible, jusque dans les plus petites villes, d'atteindre des résultats d'une immense portée.
Ici comme ailleurs, le nombre des sujets d'élite sur lesquels on peut compter pour l'avancement des sciences est évidemment restreint; il a été jusqu'ici, il est encore tel cependant, que le moment approche sans doute où ils n'auront plus à compter exclusivement, pour trouver les moyens de perfectionner leurs études, sur les Universités étrangères.
Si nous considérons en général le mouvement de la population universitaire, nous trouverons qu'elle s'est accrue depuis 1854 dans des proportions qui ont dépassé toute prévision. Ce n'est pas un fait isolé: les quatre Universités belges ont pu constater la même chose; mais chez nous, à coup sûr, cette progression a été particulièrement rapide. En décomposant les chiffres, on remarque que ce sont surtout nos Ecoles spéciales qui ont acquis une vogue inouie dans le pays; une telle vogue, que l'Université de Louvain, s'inclinant devant les tendances du siècle, a pris à son tour la résolution de fonder une Ecole des mines. Nous n'avons pas, jusqu'ici, beaucoup souffert de la réalisation de son projet; nous en souffririons, que nous ne nous en plaindrions pas. On doit ici se placer à un point de vue élevé: nous n'avons pas un intérêt d'entreprise; l'abondance des moyens d'instruction ne saurait nous offusquer, et la concurrence est avantageuse pour tout le monde. Mais ceci à part, une telle extension donnée à l'enseignement industriel est-elle aussi opportune aujourd'hui qu'elle l'était il y a trente ans? Alors, il s'agissait de pourvoir nos usines de directeurs capables; aujourd'hui, elles n'en manquent pas, et les jeunes ingénieurs, même les plus méritants, ne trouvent pas toujours immédiatement à utiliser leurs talents, même à l'étranger (111), au sortir des Ecoles. Il est à craindre (ou plutôt c'est déjà un fait) que cette carrière ne s'encombre comme d'autres se sont encombrées, et dans l'intérêt général, il ne paraît pas désirable qu'on y pousse trop exclusivement la jeunesse.
La réaction s'est du reste opérée d'elle-même: ce n'est pas l'influence de l'Ecole naissante de Louvain; ce ne sont pas les besoins de l'armée, qui en 1868, nous a enlevé une trentaine d'élèves, entrés dans le génie ou dans l'artillerie avec des avantages particuliers; ce ne sont pas ces causes ou quelques autres très accessoires qui ont diminué, dans ces derniers temps, l'empressement des étudiants à s'engager dans la haute industrie: le fait est qu'ils ont aujourd'hui plus de chances de se frayer un chemin dans le barreau, dans la magistrature ou dans d'autres carrières autrefois trop courues, puis momentanément délaissées. La loi sur l'éméritat des magistrats, entr'autres, y est certainement pour quelque chose. Nous subissons ainsi le contre-coup des revirements sociaux; hâtons-nous d'ajouter que ces oscillations sont on ne peut plus avantageuses à la civilisation elle-même. La jeunesse n'est pas seulement guidée ici par un intérêt immédiat, mais par un noble instinct dont elle a peut-être à peine conscience. Elle recommence à songer, en un mot, aux choses de l'esprit.
Nos Ecoles spéciales restent aussi florissantes qu'il est souhaitable qu'elles le soient; mais, au rebours de ce qui s'est passé sous la loi de 1835, nos Facultés se repeuplent graduellement. On ne peut que se féliciter à tous égards de ce résultat, qui rétablira un équilibre nécessaire au progrès normal de nos populations.
La prospérité de l'Université de Liège est due avant tout à la solidité de son enseignement: pourquoi ne le dirions-nous pas? Mais elle est due aussi, répétons-le encore, à son esprit de modération et à sa répugnance pour les aventures scientifiques aussi bien que pour les préjugés d'école. Comme par un accord tacite, ses professeurs se tiennent en garde contre toutes les exaltations malsaines et contre tous les fanatismes; chacun enseigne comme il l'entend, mais tous se rallient autour de notre pacte constitutionnel, dont l'esprit les a profondément pénétrés.
C'est incontestablement à cette attitude, à cette alliance des idées de liberté et d'ordre dont ils ont fait, par instinct ou avec conscience, le but éloigné de leur apostolat, que sont dues en grande partie les dispositions de notre jeunesse, dont le bon sens s'est révélé jusque dans ses égarements passagers. Mais ces dispositions sont dues aussi à l'influence du milieu liégeois, où l'attachement aux institutions nationales repose sur l'indépendance même des caractères. Ainsi s'explique l'élan spontané, irrésistible, l'enivrement d'enthousiasme des étudiants, lors de la dernière visite à Liège du fondateur de notre dynastie. Comme leurs ainés, ils voyaient en Léopold I le gardien de toutes les libertés publiques et pour ainsi dire la personnification de la patrie elle-même.
Ainsi s'explique également la confiance accordée à l'Université de Liège dans quelques pays lointains, dont les enfants viennent apprendre chez nous comment on devient digne d'être libre.
Nos prédécesseurs nous ont assigné nos devoirs; ils nous ont montré la bonne voie. Pour y rester, nous n'avons qu'à suivre leurs traces et à prendre soin de conserver de l'huile dans notre lampe.
*
* *
L'auteur dépose enfin la plume. Il a grand besoin d'indulgence: ce livre a été écrit au milieu d'occupations multiples, et il a fallu de longues et pénibles recherches pour en rassembler les éléments (112). On est venu de toutes parts au devant de nous; nous avons contracté de nombreuses dettes de reconnaissance; qu'on nous tienne du moins compte de notre zèle à les acquitter.
Qu'on nous pardonne aussi la franchise avec laquelle nous avons exprimé notre opinion sur des questions actuellement pendantes: nous avons cru pouvoir parler sans réticence, parce que notre responsabilité personnelle était seule engagée. En nous honorant d'une mission, on n'a point entendu enchaîner notre liberté de conscience et d'appréciation: c'est pour l'Université, ce n'est pas au nom de l'Université que ces pages ont été écrites.
Rendre hommage aux anciens maîtres, tel était notre premier, mais non pas notre seul devoir l'essentiel était bien plutôt de dresser une sorte de statistique intellectuelle de nos quatre Facultés. En mettant la main à l'oeuvre, nous avons aussitôt reconnu que le but serait imparfaitement atteint si, par un scrupule de délicatesse, nous nous contentions de rappeler les services des collègues que la mort nous a enlevés. Plusieurs de leurs collaborateurs sont encore debout, et, plaise à Dieu, resteront longtemps encore nos doyens d'âge. Les passer sous silence, c'eût été tronquer notre sujet, c'eût été rompre arbitrairement la chaîne des traditions. Enfin, en nous abstenant de parler des derniers venus, nous nous serions condamné à ne point établir le bilan de l'Université nouvelle, ce qui n'était point assurement dans la pensée du Conseil académique. Nous avons donc osé entreprendre le dénombrement général de nos forces, nous imposant la plus grande réserve, bien entendu, quant aux personnes vivantes, et n'émettant des appréciations que sur leurs prédécesseurs.
Un grand nombre de renseignements dont les historiens des sciences apprécieront la valeur sont ici rassemblés pour la première fois. C'est le seul mérite de ces recherches, où nous avons surtout visé à l'exactitude. - Quant au sentiment qui nous a dominé, il est tout entier dans cette parole du poète:
Et Pius est patriae facta referre labor.
|
(1) Paroles du baron Vincent, gouverneur-général des Pays-Bas pour les puissances alliées.
(2) Magistros studiorum, doctoresque excellere oportet moribus primùm, deindè facundia. Sed quia singulis civitatibus ipse adesse non possum, jubeo quisquis docere vult, non repente nec temerè prosiliat ad hoc munus, sud judicio ordinis probatus, decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore, nostro judicio, civitatibus accedat.. C. THEOD, t. 5 De medicis et professoribus, ap. Troplong.
(3) Troplong, Du pouvoir de l'État sur l'enseignement. Paris, 1844, in-8°, p. 58.
(4) Sur l'histoire des anciennes écoles de Liège, on peut consulter CRAMER, Gesch. der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden. Stralsund, 1843, in-8°; Stallaerl et Vander Haeghen, De I'instr. publique au moyen-âge. Brux., 1854, in-8°, et Lebon, Hist., de l'enseignement populaire en Belgique. Brux., 1869, in-8°.
(5) Tout le pays se couvrit d'écoles: les maîtres faisant défaut, Eracle imagina un système qui ressemble beaucoup à notre enseignement mutuel. - Eracle était un des hommes les plus instruits de son temps; il connaissait les auteurs anciens et les citait volontiers; on vante en outre ses connaissances en mathématiques et en astronomie.
(6 Leodium, Lotharingiae civitas, studiis etiam litterariis pree cœieris famosa, dit l'abbé d'Ursperg.
(7) Vulgari plebem, clerum sermone latino
Erudit et satiat, magna dulcedine verbi,
Lac teneris praebens, solidamque valentihus escam.
(8) De Villenfagne, Rech. sur l'hist. de Liège. Liège, 1817, in-8°, t. II, p. 207.
(9) Ce ne fut pas cette foraneitas qui les détourna plus tard des sciences: ce furent les séductions du luxe et de la mollesse.
(10) Vidi Leodium insignem clero locum (lettre à Jean Colonne).
(11) Rerum Senil. XV, ép. 1.
(12) Peut-être ne faut-il voir là qu'une de ces boutades auxquelles certains écrivains français nous avaient habitués, il y a quelque trente ans.
(13) DELPRAT, Die Brüderschaft des geminsamen Lebens, trad. du holl, par Mohnike. Leipzig, 1840, p. 69.
(14) Parmi les élèves des Hiéronymites de Liège, on cite encore Placentius, historien et poète (son curieux poème Pugna porcorum, dont tous les mots commencent par la lettre P, a été récemment réédité par M. Ul. Capitaine); Jean de Panhausen, vicaire-général des Prémontrés pour l'Allemagne et la Pologne, écrivain érudit et vigoureux défenseur des droits de l'Eglise;Jean de Glen, professeur à Paris et historien du christianisme d'Orient, etc.
(15) De là leur surnom de Fratres ad pennam. Ils fondèrent aussi des imprimeries: on leur doit l'introduction de la typographie à Bruxelles.
(16) V. RAUMER, Gesch. der Poedagogik, t. I.
(17) Les Hiéronymites sont souvent désignés sous ce nom.
(18) Delprat (p. 68) rapporte que Canisius avait fait ses études chez les Hiéronymites de Nimègue.
(19) V ci-après col. 1067.
(20) Becdelièvre, Biographie liégeoise.
(21) Il entretenait dans son palais deux observateurs des phénomènes célestes. Gérard Stempel de Gouda et Adrien Zeist, qui rédigèrent à son intention et sous son patronage un Traite de l'astrobobe. Il s'occupait aussi très activement de chimie: on lui doit une analyse des eaux de la Fontaine de Pline près de Tongres (Alph. Le Roy, La philosophie au pays de Liège, Litige 1860, in-8° p. 46).
(22) Pawilhar cité par M. F. Henaux, Hist. du pays de Liège, 2e éd., t. Il, p. 139.
(23) Sur le Litre des livres corrupteurs, on lisait le nom de Genève ou de quelque ville de Hollande: c'était un passeport dont on ne prenait pas la peine de contrôler l'authenticité.
(24) Parmi les membres fondateurs de la Société, on remarquait bon nombre d'élèves des Oratoriens de Visé. Les Oratoriens, comme on sait, ne repoussaient pas l'esprit d'examen mais s'en servaient dans l'intérêt du catholicisme. - V. A Morel, Annuaire de l'Université de Liège (l1860), p. 21 et suiv.
(25) V. ci-après, col. 42 et 111.
(26) Ferd. HENAUX, ouv. cité, t. II, p. 263. - BORGNET, Histoire de la révol. liégeoise de 1789, Liège, 1865, in-8°, t. I, p. 9.
(27) BORGNET, ibid.
(28) C'était simplement un collége d'humanités. L'enseignement philosophique avait été supprimé à Liège en 1774; il est vrai que ce coup n'était tombé que sur la vieille scolastique.
(29) MOREL, p. 27 et suiv.
(30) Les premiers élèves du Lycée furent envoyés de France et choisis parmi les jeunes gens qui avaient droit à une bourse d'études: nous tenons ce détail du plus ancien d'entr'eux, M. Montalant-Bougleux, de Versailles, à qui sa verte vieillesse permet encore de venir revoie de temps en temps la ville où il a fait ses études. M. Montalant s'est plus dune fois souvenu de Liège dans ses poésies; il est aussi l'un des correspondants le plus assidus de notre Société d'Emulation.
(31) V. ci-après, col. 267.
(32) A Liège, 38 voix pour, 31 contre; à Huy, 11 pour, 14 contre; à Verviers, 32 pour. Sur 116 voix limbourgeoises, 19 seulement furent négatives. Dans tout le Luxembourg (73 voix), il ne se rencontra pas un seul opposant (V. VAN DE WEVER, La Belgique et la Hollande (Opusc,, t. II, Londres. 1869, in 12°, p. 60).
(33) De Gerlache, Hist. du roy. des Pays-Bas. Bruxelles, 48, in-8°, t. 1, p. 309 et suiv.
(34) Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold I, éd. Louvain, 1861, in-8°, t. II, P. 4.
(35) De Gerlache, l. c. - Carlo Gemelli, Hist, de la révol. Belge Bruxelles, 1860, in-8°, p. 37.
(36) Ducpétiaux, cité par M. Th. Juste, Hist, de l'instruction publique en Belgique. Brux. 1844, in-8°, p. 282.
(37) Les temps sont bien changés, à preuve le mouvement flamand. - Aujourd'hui que le calme est rentré dans les esprits, on reconnaît volontiers que l'opposition avait singulièrement exagéré ses griefs. La langue française étant étrangère à la grande majorité des habitants des Pays-Bas, il était assez rationnel qu'elle ne fut pas choisie pour être la langue des affaires. Mais Guillaume oublia qu'on ne gouverne plus les peuples sans compter avec eux; que, dans son intérêt, il devait ménager les provinces wallonnes; et qu'enfin
Le temps n'épargne pas ce que l'on fait sans lui.
L'adage: Quid leges sine moribus ? est toujours vrai: le Compelle intare désaffectionne inévitablement les peuples. Il aurait fallu laisser d'abord s'éveiller chez les Belges le désir de connaître le hollandais, et l'on ne peut douter qu'ils n'en seraient venus là. N'avons-nous pas vu, cette année même, un grand nombre d'étudiants de Liège demander qu'il fût pourvu sans retard au remplacement de M. le professeur émérite Bormans, pour le cours de langue flamande? (*)
(*) Il a été fait droit sans retard â cette reclamation; M. Stecher a été chargé du cours de flamand par arrêté royal du 15 juin 1869.
(38) F. Capitaine, Notice sur H.-J. Ornau Procès-verbal de la Séance publique de la Soc. d'Emudation de Liège, 31 mai 1858, p. 40).
(39) DE GERLACHE, THONISSEN, etc. - GERVINUS, Gesch. des XIXten Jahrhunderts. Leipzig, in-8°, t. VII, p. 582 et suiv.
(40) Il faut faire exception pour quelques-uns, notamment pour les Athénées de Bruxelles, de Maestricht et de Luxembourg.
(41) V. notamment t. IX, p. 353 et suiv.
(42) JUSTE, p. 302.
(43) Etat de l'instruction supérieure en Belgique (1794-1835). Bruxelles, 1844, in 8°, t. I, p. XXVIl et suiv. - V. aussi Th. JUSTE, p. 292 et suiv.
(44) Malheureusement la modération de ce digne conseiller ne tarda pas à déplaire au roi. Lorsque Guillaume prit ses arrêtés concernant la langue hollandaise, le ministre de l'instruction publique, après avoir fait vainement tout son possible pour détourner le roi de son dessein, résolut du moins d'apporter un retard à l'exécution des nouvelles mesures. M. Juste rapporte à ce sujet (p. 303) l'anecdote suivante: Le professeur de littérature hollandaise de l'Athénée de Bruxelles s'étant présenté un jour à l'audience du roi, celui-ci lui demanda comment allait la langue nationale depuis les derniers arrêtés. Le professeur, qui était un Batave fanatique, répondit que le ministre tenait encore les arrêtés dans son portefeuille. A la suite de cette audience, Guillaume eut une explication avec M. Falck; et le fidèle ministre fut envoyé à Londres. » - M. Quetelet a publié une intéressante biographie de Falck dans l'Annuaire de l'Acad. royale de Bruxelles, année 1844, p. 79-107.
(42) v. ci-après, col. 71, 307, 368, etc.
(43) Il y avait alors une table de roulette installée à Chaudfontaine; le Conseil académique s'en émut. Le directeur des jeux se tira d'embarras en interdisant aux élèves de l'Université la fréquentation de son établissement.
(44) V. l'art. Kinker
(45) V. Ad.BARTELS, Doc. hist. sur la révolution belge, édition. Bruxelles, 1836, in-8°.
(46) V. le recueil intitulé: Opinion de quelques publicistes sur le collège philosophique, etc. Bruxelles, 1826, in-8°.
(47) N° du 28 décembre 1825.
(48) v. la circulaire du 5 octobre 1817.
(49) Gervinus, t. VII, p. 581. - Les arrêtés de 1829, modifiant, à certains égards ceux de 1825, ne satisfirent nullement l'opposition. On peut s'en convaincre en parcourant la brochure menaçante de l'évêque de Liège, Van Bommel, intitulée: Trois chapitres sur les deux arrétés du 20 juin 1829, relatifs au Collège philosophique par un père de famille pétitionnaire. Bruxelles, septembre 1829, in-8.
(50) V. l'art. J.-G.-J ERNST.
(51) V. l'art. F. VAN HULST.
(52) Ul. CAPITAINE, Rech. sur les journaux liégeois. Liège, 1850, in-12°, p. 181 et suiv.
(53) V. ci-après, col. 479.
(54) Expression dont se servit plus tard M. Nothomb dans son Essai sur l'histoire de la révolution belge.
(55) Rapport der Commissie, bijeenqeroepen door K. besluit van 13 april 1828, n° 400, ter raadpleqing over sommiqe punten betreffende het hooger onderwijs. La Haye, 1830, in-fol.
(56) Allusion à une brochure de J. Lebeau.
(57) « La rivalité entre trois Universités s'est bornée jusqu'à ce jour à la facilite des admissions », écrivait en 1828 Ch. de Brouckere. L'honorable publiciste exagérait; cependant l'adage a raison il n'y a pas de fumée sans feu.
(58) Hist. du roy. des Pay-Bas. t. 1. p. 370.
(59) L'art. 469 du règlement organique était ainsi conçu Les fonctions et le pouvoir confiés aux curateurs sont
1° Le soin de surveiller la stricte observation de tous les règlements et arrêtés sur la haute instruction et surtout le présent règlement;
2° Le soin de veiller à ce que toutes les branches de l'enseignement soient et restent confiées à un nombre suffisant de professeurs;
3° Le soin de veiller à la conservation de tous les bâtiments académiques, collections, cabinets, et de tout ce qui appartient directement ou indirectement à l'Université;
4° Le soin de former, d'arrêter, de modifier on étendre toutes les instructions des employés qui dépendent de I'Université. L'avis du Sénat sera demandé lorsqu'il s'agira des appariteurs; l'avis des directeurs des collections ou cabinets, lorsqu'il s'agira des personnes qui y sont employées, et enfin celui du professeur de botanique, lorsqu'il s'agira des employés du Jardin botanique
5° La surveillance des finances de l'Université, ainsi que de la bonne administration les legs ou donations, qui pourraient être faits en faveur des Universités, excepté seulement les donations ou legs dont l'administration serait confiée spécialement par le fondateur a quelque autre collège ou à des particuliers;
6° La formattion d'un budget annuel où doivent être portées toutes les dépenses présumées nécessaires pour l'année suivante, afin que, par là, déduction faite des revenus particuliers de chaque Université, si elle en a, on puisse fixer le montant de ce que le trésor public devra fournir en faveur de l'Université. Ce budget sera envoyé par eux au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences, pour être soumis par lui avec ses considérations à l'approbation du roi, et, après avoir été approuvé par S. M., servir de règle pour les dépenses à faire pour chaque Université, et dont le soin est confié au département susdit;
7° La formation d'un rapport annuel et détaillé de l'état de l'Université, lequel rapport, avant le commencement de chaque année académique, devra être envoyé par eux au département de l'instruction, des arts et des sciences
8° Enfin, ils prendront à coeur tout ce qui, selon leur avis, pourrait contribuer à entretenir ou à augmenter le bien-être et l'honneur de l'Université, dont ils ont la surveillance.
Une chaire venait-elle à vaquer, les curateurs proposaient au gouvernement deux candidats et indiquaient les raisons qui avaient motivé leur choix; il formulaient aussi leur avis sur la création de chaires nouvelles, sur la suppression ou la division de certains cours, etc. Enfin, ils distribuaient les bourses d'études après avoir pris l'avis des Facultés et au besoin soumis les postulants à un concours. - Ils avaient chaque année deux réunions ordinaires, en octobre à cause du changement de recteur, en juillet pour dresser le budget de l'exercice suivant: en dehors de leurs sessions, le président et le secrétaire expédiaient les affaires courantes. Le mandat de curateur était gratuit, sauf des jetons de présence. Deux cinquièmes seulement des membres du collège pouvaient être choisis en dehors de la province où l'Université était établie: on leur allouait des frais de voyage. Le président de la Régence municipale de chaque ville universitaire faisait partie de plein droit du collège des curateurs pendant la durée de sa dignité (art. 167).
(60) V. le Rapport de M. NOTHOMS, t. 1, p, cxlvi.
(61) Le baron de VILLENFAGNE, né à Liège en juin 1733 et mort dans la même ville le 23 janvier 1826, a laissé un nom comme historien. Plus instruit que la plupart de ses compatriotes, il revint de France, ses études achevées, épris d'une belle passion pour les lettres en général et plus particulièrement pour les recherches historiques. Il débuta par une édition des Oeuvres du baron de Walef, poète liégeois du siècle de Louis XIV, estimé de Boileau lui-même et trop oublié depuis. Il fut un des promoteurs les plus actifs de la Société d'Emulation et l'un des collaborateurs de l'Esprit des journaux. Insensiblement son attention se concentra sur les choses liégeoises; il mit au jour, en 1788, des Mélanges de littérature et d'histoire, où l'on remarqua un Essai sur Notger, une notice sur l'auteur du Miroir des nobles de la Hesbaye et une étude sur les guerres d'Awans et de Waroux, qui ensanglantèrent notre pays au XIIIe siècle. Les fonctions publiques auxquelles il fut appelé ne le détournèrent pas de son but, qui était surtout d'étudier à fond la constitution politique de notre ancienne principauté. En 1792, étant bourgmestre, il fit paraître ses Recherches sur l'ordre équestre; l'année suivante parurent ses Eclaircissements sur Raês de Dammartin, chevalier français, deux écrits estimables, mais publiés à une époque où l'on ne s'intéressait guère à ces sortes de sujets. Villenfagne émigra; sa riche bibliothèque, qu'il avait emportée avec lui, fut brûlée à Dusseldorf, où les Français avaient jeté quelques bombes. Il rentra dans sa patrie dès qu'il le put et se retira dans son château d'lngihoul-sur-Meuse, pour se consacrer tout entier à l'éducation de ses enfants et à ses études chéries. Il mit sous presse en 1803 l'Histoire de Spa (2 vol. in-12°), où il soutint, contre le docteur de Limbourg, la prétention de Tongres à posséder la véritable fontaine de Pline. Les Essais critiques sur l'histoire civile et littéraire de la ci-devant principauté de Liège (1808), les nouveaux Mélanges (1810), enfin tes Recherches sur l'histoire de la même principauté (1817), acquirent à Villenfagne un crédit considérable comme érudit et comme critique. Sur ces entrefaites, il était sorti de sa solitude pour accepter le double mandat de membre de la Députation des Etats et du Collège des curateurs de l'Université. « Son affabilité, son esprit de justice et son désir d'obliger, dit Ch. de Chênedollé, son biographe, le firent chérir de tous ceux qui eurent des relations avec lui. Il n'avait jamais pu se rallier aux idées modernes: mais il respectait autant les opinions d'autrui qu'il tenait aux siennes; sa loyauté était absolue et la passion ne dictait point ses jugements: on n'en remarquera pas moins que Guillaume I ne fut pas exclusif dans le choix des personnes qu'il attacha à notre Université. - M. de Gerlache tient en haute estime les travaux de Villenfagne; il lui reproche seulement de n'avoir en quelque sorte travaillé que pour les auteurs et pour les savants. L'historien liégeois fut reçu à l'Académie de Bruxelles en 1816: le t. II des Nouveaux Mémoires de cette compagnie contient un travail de lui, Sur la découverte du charbon de terre dans la principauté de Liège. On cite encore sa notice sur un beau MS. de la vin de St-Hubert, qui a appartenu à Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne (Extr, du Courrier de la Meuse, n° du 21 septembre 1825), et quelques éloges d'artistes, discours, etc. lus dans les séances publiques de la Société d'Emulation. Il travailla pendant plus de trente ans à une Biographie liégeoise: cette oeuvre considérable est restée inédite. - V. Ch, de Chênedollé, Notices nécrologiques sur G.-J.-E. Ramoux et sur H.-N. baron de Villenfagne. Liège, Desoer, 1826, in-8° (partiellement reprod. dans la Biogr. liégeoise de Bec-de-Lièvre, t. I).
(62) Denis-Marie, chevalier de MÉLOTTE d'Envoz, né à Liège le 6 novembre 1780, mourut à son château d'Envoz la 17 mai 1856. Il avait commencé ses études en Allemagne pendant l'émigration; il les acheva dans sa ville natale, à l'Académie anglaise. Successivement maire de Couthuin, membre de la commission municipale qui administra Liège de 1814 à 1817, bourgmestre de la même ville de 1817 à 1824 avec de Bex et A. Lesoinne, puis seul chef de la commune jusqu'à la révolution, et depuis 1820 membre des Etats provinciaux, enfin député à la seconde Chambre, il se distingua par un attachement à ses devoirs et par une loyauté à toute épreuve, dont ses adversaires politiques ont été les premiers à faire l'éloge. Sincèrement dévoué à la maison de Nassau, il n'en déplora pas moins, d'abord en secret, puis ouvertement, la marche que le roi Guillaume avait fini par imprimer aux affaires. « Consulté par le prince d'Orange qui l'aimait et faisait grand cas de sa haute probité et de son caractère loyal, il ne lui cacha point son opinion et alla jusqu'à dire à l'héritier du trône néerlandais: Prince, le roi vient par les dernières lois de se désaffectionner le coeur de tous les Belges; si ces lois ne sont retirées ou profondément modifiées, j'ose prédire à V. A. R. une révolution dans un très prochain avenir. - L'avenir était proche en effet. Moins d'une année après, en sortant pour la dernière fois de son cabinet à Anvers, le prince d'Orange trouva sur son passage le député-bourgmestre de Liège, mêlé à quelques serviteurs fidèles. L'âme de de Mélotte se peignait tout entière sur son visage. Le prince l'étreignit en passant et laissa tomber ces paroles: Vous me l'aviez dit et vous aviez bien raison! (UI. Capitaine, Necr. liégeois pour 1856, p.38). De Mélotte resta fidèle au gouvernement déchu, mais déclina toutes les offres brillantes qui lui furent faites en Hollande; il se retira dans son château et n'en sortit plus. C'est sous son administration qu'ont été créés à Liège l'Université, l'Ecole roy. de musique, l'institut des sourds-muets et des aveugles, etc. (V. la Gazette de Liège du 8 juillet 1856).
(63) Le nom de Frédéric Rouveroy est un de ceux dont s'honore la littérature nationale; ajoutons que celui qui le porta ne fut pas seulement un poète, mais un excellent citoyen, tout dévoué à la chose publique et en particulier à l'instruction des masses. En mettant son Eloge au concours, la Société d'Emulation ne se montra pas seulement reconnaissante envers un de ses bienfaiteurs, elle remplit un des premiers devoirs que lui impose sa charte.
Rouveroy naquit à Liège le 19 septembre 1771 et y mourut le 4 novembre 1850. II fit ses études au Collège de sa ville natale jusqu'au 18 août 1789, jour où éclata la révolution liégeoise. Son père, greffier des Etats, le destinait au barreau; la vocation lui manquant, il résolut d'aller étudier la médecine à l'étranger. L'approche des Français ayant déterminé ses parents à passer le Rhin, il les suivit en Allemagne le 21 juillet 1794. C'est pendant cette période d'exil volontaire que se développa son goût pour la poésie. II était né fabuliste: l'apologue répondait d'ailleurs à sa préoccupation dominante; il voulait éclairer le peuple pour le rendre meilleur. Rentré dans son pays en 1795, il eut l'occasion d'administrer des communes rurales; il se hâta d'y réorganiser l'instruction primaire et d'y propager la vaccine. Nommé adjoint au maire de Liège en 1808, ensuite échevin de l'instruction publique pendant 21 ans, il eut l'occasion, sans dire adieu aux muses, d'exercer sa propagande sur un plus grand théâtre. Au milieu du tracas des affaires, il trouva le temps de compléter le recueil de ses charmantes Fables, et d'écrire toute une série de petits livres populaires qui obtinrent le plus légitime succès. Le Manuel des plantations, l'Emploi du temps, M Valmore ou le maire du village, l'Essai de physique rappellent les entretiens de Maitre Pierre et ne sont pas trop indignes du Bonhomme Richard. Le Petit Bossu, ouvrage destiné à combattre les préjugés populaires, prit place dès son apparition parmi les meilleures productions du genre. Il eut éditions sur éditions, et jusqu'à l'honneur d'être contrefait en France. L'administration communale de Liège l'a fait réimprimer à ses frais dans ces dernières années encore, pour nos écoles communales. - Rouveroy se retira de la vie publique en 1830, et ne s'occupa plus guère que de littérature. L'ancien Théâtre du Gymnase était sa propriété; il fut naturellement amené à s'intéresser à l'art dramatique; il publia même (sous l'anonyme) un livre intitulé Scénologie de Liège (v. J. Delecourt, Dict, des anonymes, n° 2299). La Revue de Liège (v. l'art. VAN HULST) contient un grand nombre de pièces de vers de Rouveroy, datant de cette seconde partie de sa vie. - L'enseignement moyen, comme l'enseignement primaire, se ressentit de la vigilance éclairée de cet homme d'élite. A l'Université, il fut un des membres les plus influents du Collège des curateurs; sans être un savant, il prisait haut la science, mais il lui assignait avant tout un but pratique. Ce n'était pas au reste un utilitaire à vues étroites; disciple de Franklin, il était en même temps poète; un idéal de l'ordre le plus élevé planait au-dessus de ses théories américaines. - V. Bec-de-Lièvre, Biogr. liégeoise, t. II (supplément).
(64) V. ci-après, col. 1.
(65) Olivier LECLERCQ, né à Herve le 31 décembre 1760, mourut à Bruxelles le 1 novembre 1842. Il fit ses humanités en Allemagne, sa rhétorique au Collège Thérésien de Herve, puis se rendit à Louvain pour y étudier la théologie. Il n'avait pris ce dernier parti que par déférence pour son père: il y renonça au bout de deux ans pour s'attacher à la jurisprudence, et se fit recevoir docteur en droit civil et en droit canon. Etabli ensuite comme avocat dans sa ville natale, il joignit bientôt à sa profession les fonctions, compatibles avec elle, de juge à la Chambre des domaines et tonlieux. La révolution française et la conquête de la Belgique ayant amené la suppression du duché de Limbourg et de ses tribunaux, Leclercq se vit forcé de s'établir à Liège. Il s'y était fait une position distinguée au barreau, quand le premier consul Bonaparte, réorganisant le personnel de toutes les institutions et y appelant les notabilités de chaque département, le nomma président du tribunal de première instance, Il hésita d'abord et finit par accepter. C'est dans l'exercice de ces fonctions qu'il eut l'occasion d'émettre un vote sur le Consulat à vie, puis sur l'Empire: il se prononça contre l'un et l'autre. Il occupa plus tard un siège de juge au tribunal d'appel de Liège; la réorganisation décrétée le 20 avril 1810 lui valut le poste de premier avocat-général près la Cour impériale, qu'il occupa jusqu'à l'arrivée des armes étrangères et la chute de l'Empire en 1814. Dans l'intervalle, il avait été présenté deux fois par les électeurs de Liège comme candidat au Corps législatif. N'ayant pas cru pouvoir, avant qu'un traité de paix ne l'eût délié de ses serments, continuer ses fonctions de magistrat au nom des puissances alliées, il fut tenu pour démissionnaire. Il reparut alors au barreau; sa clientèle commençait à se reformer, lorsque le roi des Pays-Bas le nomma membre de la Commission chargée de réviser la loi fondamentale en vigueur dans les provinces septentrionales, pour la rendre applicable au royaume tout entier. Cette mission le retint trois ou quatre mois à La Haye. Peu de jours après sa rentrée à Liège, un arrêté royal le nomma procureur-général près la Cour supérieure de justice de cette ville. Au mois de février 1816, une nouvelle mission l'appela à Paris, où les traités de 1814 et de 1815 avaient institué un tribunal d'arbitres, à l'effet de prononcer sur les contestations qui s'élèveraient entre les commissaires français et étrangers, réunis pour liquider les créances des sujets des pays auparavant conquis par la France envers ce pays. Leclercq ne put revenir à Liège qu'en 1818; il y remplit les fonctions de procureur-général et de curateur de l'Université jusqu'en 1829, date de sa nomination de conseiller d'Etat en service ordinaire. En cette qualité, il dut résider alternativement, d'année en année, à Bruxelles et à La Haye. Député à la seconde Chambre des Etats-généraux de 1823 à 1829, il prit une part très active aux travaux de cette assemblée, ainsi qu'aux études de la Commission chargée, par arrêté royal du 13 avril 1828, de réviser les lois organiques de l'instruction publique. Les événements de 1830 ne permirent pas à cette Commission d'aboutir et mirent fin du même coup à la carrière publique d'Olivier Leclercq. Lorsqu'éclata la révolution, il était retenu à La Haye par ses devoirs de conseilter d'Etat. En cette qualité, avec ses collègues belges, il accompagna l'héritier présomptif à Anvers, où ce prince essaya vainement, comme on sait, de s'entendre avec les chefs du mouvement; les conseillers d'Etat qui appartenaient à nos provinces rentrèrent alors dans leur patrie. Olivier Leclercq obtint une pension de retraite et passa le reste de ses jours dans la vie privée à Bruxelles, où sa famille était établie. - On lui doit un ouvrage considérable intitulé Le droit romain dans ses rapports avec le droit français et les principes des deux législations (Liège, 1810, 8 vol. in-8°); une Lettre du clergé catholique des provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas au clergé catholique des provinces méridionales (1815); enfin, une brochure contre l'union des catholiques et des libéraux. Olivier Leclercq n'était pas seulement un profond jurisconsulte; il possédait aussi des connaissances étendues en littérature et dans les sciences historiques, philosophiques et politiques. Il avait pour maxime principale de ne jamais prendre de résolution de quelque importance sans avoir la certitude de pouvoir sûrement en soumettre les raisons à l'approbation publique. Il a laissé deux fils qui suivent dignement ses traces; l'aîné, procureur-général à la Cour de cassation, membre de l'Académie royale de Belgique, vice-président du Conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur, a rendu d'éminents services au pays à ces divers titres; d'autre part, membre actif de la Commission chargée de publier les monuments de notre ancien droit, il a récemment édité les Coutumes de Luxembourg et de Chiny. Son frère, général du génie, est actuellement directeur des fortifications d'Anvers.
(66) Lambert Jean-Louis JAMME, né à Liège le 15 octobre 1779, y mourut le 12 février 1848, après avoir fourni une carrière utile et laborieuse. La mémoire de Jamme est restée chère aux Liégeois; son nom est synonyme de bon citoyen, d'administrateur éclairé et dévoué au bien général. Jusqu'en 1830, rien de plus paisible et de plus étranger aux affaires publiques que sa vie. Il faisait le commerce par raison et consacrait ses loisirs à la peinture, qu'il avait apprise sans maitre. C'était chez lui une véritable vocation intime et passionnée; s'il n'avait eu une jeune famille à élever, nul doute qu'il ne s'y fût adonné entièrement et qu'il n'eût pris rang parmi nos premiers paysagistes. Après bien des années d'interruption, la bonne et fructueuse impulsion donnée à ses affaires lui avait cependant permis, au commencement de 1830, de remettre un tableau sur le chevalet. Il s'était construit un atelier dans les combles de sa maison de campagne de Fragnée; il y passait avec bonheur toutes les heures qu'il pouvait dérober à ses occupations; la révolution le trouva le pinceau à la main; c'est dire qu'il ne fut pas, comme on l'a quelquefois prétendu, l'un des auteurs du mouvement, Il ne s'y mêla que dans des voies d'ordre et d'humanité, et seulement quand la sécurité publique fut compromise. Le 27 août 1830, il prit le commandement d'une compagnie de la garde bourgeoise; le mois suivant, il conserva le, même grade dans la garde urbaine. Pendant toute la crise, il vécut pour ainsi dire sur la place publique; partout où il y avait des excès à prévenir, on pouvait être sûr de le rencontrer. Le 2 septembre, il était au pillage des magasins d'armuriers, tout occupé d'empêcher les actes de violence et de sauvegarder les légitimes intérêts de la propriété. La foule, qui s'était armée, bivouaqua au théâtre (*). Comme toujours dans les révolutions, cette, foule contenait toute espèce d'éléments. Il fallait apaiser les exaltés, contenir les mauvais, donner une direction à cette force effrayante. Louis Jamme et M. Ch. Rogier se chargèrent de ces soins. Toute la nuit fut employée à des mesures d'organisation et de discipline ; on régularisa la distribution des armes, on fournit des vivres; aucun malheur ne fut à déplorer. La nouvelle troupe se donna le nom de garde bourgeoise auxiliaire et reconnut pour chefs les deux citoyens qui l'avaient formée; dès le lendemain, cette élection fut ratifiée par le Conseil de régence. Sans attendre un jour de plus, M. Rogier partit pour Bruxelles à la tête de son monde; il était dans son rôle de révolutionnaire convaincu. Jamme jugea que le sien était de rester à Liège et de tirer parti de l'immense popularité qu'il avait acquise en quelques jours, pour assurer le maintien du bon ordre et le respect des personnes. Le 15 septembre, il fut nommé chef de la légion de l'Ouest de la garde urbaine; le 11 octobre, membre de la Commission des secours et indemnités. En présence de l'exaltation des esprits, il eut plus d'une fois besoin de déployer toute son énergie. Nous rappellerons seulement une scène qui eut lieu dans la cour du Palais, où étaient remisés des canons que le peuple voulut enlever. Le commandant hollandais de la citadelle avait déclaré que si l'on touchait à ces pièces, il bombarderait la ville. Jamme résista courageusement aux impatiences de la foule imprudente et aveuglée; la cause de la révolution, à laquelle il était sympathique, ne lui paraissait pas dépendre de ce petit nombre de bouches à feu, et il pensait aux habitants paisibles, aux femmes, aux enfants menacés d'un massacre. Un patriote furieux se précipita sur lui le sabre levé. On le retint, on entoura Jamme, on subit son ascendant et les canons restèrent. Un jour ou deux plus tard, ils furent emmenés pendant la nuit et sans bruit - Vint la période de réorganisation. Les corps communaux furent choisis par élection. Jamme fut nommé bourgmestre aux acclamations de la ville entière. Pour en finir avec les événements de la révolution, nous mentionnerons encore la belle conduite que tint l'honorable magistrat en 1831, lors de la déroute de l'armée de la Meuse. Le général Daine, arrivé à Liège avant la nouvelle de sa défaite, s'était enfermé à l'hôtel du Pavillon anglais. Impossible de parvenir jusqu'à lui. Les bruits les plus sinistres se propageaient; le mal, bien assez grand déjà, était exagéré par les fuyards; l'inaction du général, qui ne donnait aucun ordre, autorisait toutes les appréhensions. Louis Jamme, homme de paix, se mit en route à travers les troupes débandées et se rendit an quartier général du roi vers Diest ou Louvain, pour l'avertir des dangers que couraient Liège et la province. L'arrivée des Français mit fin à cette débacle. - La paix publique une fois rétablie, Jamme consacra tout son temps et toutes ses pensées à l'administration de la ville. Il rendit d'éminents services à l'instruction publique; il se préoccupa surtout, comme Rouveroy, d'améliorer les écoles primaires et d'imprimer une vigoureuse impulsion à l'Académie de dessin, dont il comprenait toute l'importance au peint de vue de l'émancipation intellectuelle et artistique des classes ouvrières (**). Rien n'échappait à sa vigilance; son désintéressement absolu, son affabilité lui gagnaient l'affection générale et réveillaient chez tous ceux qui l'approchaient, le sentiment du devoir; il faisait apprécier l'excellence de nos institutions nationales par la manière dont il les pratiquait lui-même. Son activité était incessante; il s'épuisait en efforts surhumains pour suffire à la fois à ses obligations de père de famille et aux exigences de sa charge. Une affection de la moelle épinière, résultat de tant d'inquiétudes et d'insomnies, avait entrainé un commencement de paralysie. Ses affaires commerciales, si prospères avant 1830, commençaient à souffrir de son dévouement à la cité. Sous le coup de pertes importantes, il résolut de renoncer à l'administration, comme il avait, dans sa jeunesse, renoncé à la peinture. Il résigna son mandat; mais il lui fallut plus d'un an pour vaincre les instances de ses collègues, celles de la ville entière et celles du Roi. La démission de Jamme ne fut acceptée que le 19 juin 1838. Il quitta l'hôtel de ville au milieu de témoignages universels de regrets et de sympathie, et resta des lors étranger aux affaires publiques, si ce n'est qu'il prit une part active aux élections, aussi longtemps que sa santé le lui permit. - L'entreprise industrielle qu'il avait trop délaissée finit par échouer complètement: la ville lui vota une pension civique, dont il vécut jusqu'à la fin. Il chercha des consolations dans l'affection des siens et dans la culture des arts, la passion de sa jeunesse: ses plus beaux paysages datent de sa retraite. Jamme avait refusé de faire partie du Congrès national; il fut membre de la première Chambre des représentants (1831); mais il déclina la continuation de ce mandat. Dans sa carrière administrative, il fit profession d'un sage libéralisme; il soutint avec une conviction très arrêtée la théorie de la liberté du commerce et combattit avec ardeur pour la défense des prérogatives communales vis-à-vis du gouvernement. L'affaire Dejaer (v. ci-après, col. 144) est l'épisode le plus important de ces luttes. - La ville de Liège a érigé un beau monument à Louis Jamme dans le cimetière de Robermont; la Société d'Emulation a mis son Eloge au concours,, sous le patronage de l'administration locale. - L'Université lui doit de son côté un souvenir, à cause du vif intérêt qu'il porta comme curateur et comme bourgmestre à sa prospérité, à une époque de transition où elle n'était pas même sûre du lendemain. Il prit Imitative, le 10 janvier 1831, des réclamations qui eurent pour objet le rétablissement de la Faculté des lettres; lorsqu'il fut question, plus tard, de n'entretenir aux frais de l'Etat qu'une seule Université, on le retrouva encore sur la brèche. Son attitude ferme et ses arguments pressants nous ont peut-être sauvés du naufrage. - Sur l'ensemble de la carrière administrative de Jamme, v. le Journal de Liège du 16 février 1848.
(*) Nous devons ces détails, et la plupart de eux qui vont suivre, à l'obligeance de M. Emile JAMME, commissaire de l'arrondissement de Liège, fils de l'honorable bourgmestre.
(**) Une medaille d'or lui fut offert, le 23 août 1834, par un grand nombre d'amis de l'instruction publique et des arts, comme expression de leur gratitude.
(67) V. le Rapport de M. NOTHOMB, t. 1 p. cv.
(68) Considérants de l'arrêté du 16 décembre (NOTHOMB, t. I, p. 671).
(69) Ouvr. cité, p. 338.
(70) V. les art, de CHÈNEDOLLE. DENZINGER, FUSS, GALL, BOUILLE, FASSIN et WURTH.
(71) Ouvr, cité, t. Il. p. 216.
(72) t. I, p. CXVII.
(73) Ibid. p. CXVIII.
(74) Expression de Pasquier.
(75) V. ci-après, col. 411 et suiv.
(76) Elle aurait été établie à Louvain,
(77) Le projet de la Commission de 1833 fut considérablement amendé par M. de Theux, à ce point que le système proposé le 4 août 1835 peut être considéré comme nouveau.
(78) V. l'art. BARON.
(79) Disc. de la loi soi l'enseignement supérieur. Bruxelles, 1844, in-8°, p. XIX.
(80) Fred. Thiersch.
(81) Ouv. cité, p. 401.
(82) V. SPRING, La liberté de l'enseignement, la science et les professions libérales. Liége, 1854, in-8°, p. 14.
(83) Ibid. p. 16.
(84) SPRING, p. 16.
(85) V. l'Exposé des motifs du projet de loi de 1844, dans le recueil intitule Discussion de la loi sur l'enseignement supérieur, etc., p. 205.
(86) V. la brochure de Louis Duperron (M. Trasenster): Réforme de l'enseignement supérieur et du jury d'examen. Liège, 1848, in-8°, p. 11.
(87) Circulaire de l'archevêque et des évêques de Belgique au clergé de leurs diocèses, février 1834.
(88) Qui ne se souvient des polémiques philosophiques de MM. Laforét et Tiberghien, et de l'Annuaire publié en 1840 par les étudiants de Bruxelles?
(89) Voir les discussions sur la proposition Brabant-Dubus, tendant à obtenir pour l'Université catholique la personnification civile, et sur le legs fait par Verhaegen à l'Université libre de Bruxelles.
(90) Belgien, etc. Pforzheim, 1848, in-8°, p. 209.
(91) Allusion au premier Congrès des étudiants (1865).
(92) M. Brasseur.
(93) Les Etudes sur l'histoire de l'humanité, par M. F. LAURENT.
(94) Il a été reconnu qu'elle ne l'était pas.
(95) V. la brochure citée de M. SPRING p. 27. On ne saurait trop attirer l'attention sur l'argumentation puissante de notre honorable collègue.
(96) Nous renvoyons le lecteur au recueil très-instructif intitulé: l'Enseignenent supérieur devant le Sénat. Paris, 1868, in-12°.
(97) V. ci-après, dernière partie, p. XLIV.
(98) V. ci-après dernière partie, p. XLV.
(99) Ces programmes sont déterminés par la loi mais qui fait la loi? Les Universités libres, pour une certaine part, puisqu'elles comptent au parlement un certain nombre de leurs professeurs. Quant aux Universités de l'État, depuis la loi des incompatibilités parlementaires, elles n'ont plus voix au chapitre.
(100) Il serait possible de soutenir que les professeurs des Universités de l'État, en vertu de leur caractère officiel, sont dans une position toute particulière; mais nous ne voulons pas donner prise à la moindre objection.
(101) Ouv. cité, p. 402.
(102) SPRING, p. 102.
(103) « A l'origine du royaume des Pays-Bas, dit M. Th. Juste (Hist. de l'instr. publ. en Belgique, p. 379), l'instruction publique forma un département dont le chef portait le titre de commissaire-général; plus tard, elle devint, par l'adjonction de deux autres services, le ministère de l'instruction publique, de la marine et des colonies; en 1830, elle était, depuis plusieurs années, réunie au département de l'intérieur, dont elle formait une des principales administrations.
Au sortir de la crise de septembre, le gouvernement provisoire créa une Commission d'instruction; mais peu de jours après, une administration générale fut substituée à la Commission. M. Ph. Lesbroussart, un des hommes les plus distingués et les plus honorables du pays, fut nommé, le 14 octobre 1830, administrateur-général de l'instruction publique.
A cette époque, les départements ministériels portaient le nom de Comités, et les chefs des Comités le titre d'administrateurs-généraux: c'est celui que portèrent M. Nicolai bord, et ensuite M. Tielemans, comme chefs du département de l'intérieur.
Jusqu'à la fin du mois de décembre, il y eut beaucoup de vague relativement à l'étendue et même à la nature des attributions de l'administration générale de l'instruction publique; le titulaire se considérait comme chef de Comité, au même litre que ceux de l'intérieur, de la justice, etc., qu'il regardait comme des collègues; en effet, le Comité central du gouvernement provisoire prenait des arrêtés sur la proposition de l'administrateur général de l'instruction publique, et chargeait ce fonctionnaire de leur exécution.
L'arrêté du 16 décembre sur les Universités est le premier acte dans lequel l'intervention du Comité de l'intérieur est constatée; encore y est-il dit dans le préambule: « Sur la proposition du Comité de l'intérieur et de l'administration générale de l'instruction publique », et à l'art. 21: « le Comité de l'intérieur et l'administrateur-général sont chargés de l'exécution du présent arrêté ».
La situation fut enfin nettement décidée par un arrêté du 24 décembre, qui porte « L'administrateur-général de l'instruction publique est attaché au Comité de l'intérieur ». - Mais ce même arrêté disait plus bas: « Le gouvernement se réserve de demander des rapports et avis directs à l'administrateur-général de l'instruction publique ».
Les affaires concernant l'instruction publique formèrent donc à elles seules une administration générale ayant, au moins en apparence, son existence spéciale, bien que dépendante du ministère de l'intérieur. Tous les chefs de ce département devaient, s'ils voulaient prendre au sérieux la responsabilité constitutionnelle, s'efforcer d'annuler l'action de l'administration de l'instruction publique, dont les actes devaient leur être imputés. - Ce service ne fut donc bientôt plus, de fait, qu'une division, dont le chef conservait un titre tout à fait illusoire.
Le 18 novembre 1833, une Commission fut nommée par le Roi, sur la proposition du ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier), à l'effet de préparer un projet de loi sur l'instruction publique. Non seulement on ne jugea pas à propos de placer l'administrateur-général dans cette Commission où siégèrent plusieurs de ses subordonnés, mais on fit à ce fonctionnaire une position tout à fait subalterne, en insérant dans l'art. 3 de l'arrêté la disposition suivante: « La Commission est autorisée à requérir, toutes les fois qu'elle le jugera convenable, la présence de l'administrateur-général de l'instruction publique ». - Heureusement que les membres de la Commission comprirent que les convenances ne leur permettaient pas de faite usage de cette faculté: jamais l'administrateur ne fut mandé par elle; il est permis d'ailleurs à ceux qui connaissent le caractère loyal et indépendant de M. Lesbroussart, de douter qu'il eût accepté une pareille situation.
Au mois d'avril 1834, le personnel des employés de l'administrateur-général de l'instruction publique, soustrait jusque là au contrôle du secrétaire général, fut soumis au règlement du ministère de l'intérieur.
Il y avait donc déjà longtemps que l'importance et l'influence de l'administrateur-général de l'instruction publique étaient annulées, lorsque le ministre de l'intérieur (M. de Theux), par lettre du 24 août 1834, décida que désormais toute la correspondance de l'administration de l'instruction publique serait soumise, en minute, à l'approbation du ministre, et expédiée par le bureau général d'expédition du ministère, - C'est l'administration ainsi réduite que M. Lesbroussart échangea, le 5 décembre 1835, contre une chaire à l'Université de Liège.
Le secrétaire de l'administrateur, M. L. Alvin, nommé aussi en 1830, continua à traiter les affaires de la division jusqu'au 26 mai 1836, époque à laquelle l'instruction publique devint un bureau d'une division confiée à M. le baron Dellafaille, qui, avec le titre de directeur, réunissait déjà dans ses attributions les arts, les sciences, les lettres, le service de santé, les cultes et les archives.
Lors de la composition du cabinet, du 18 avril (Lebeau et Rogier), l'instruction publique, les arts, les sciences et les lettres passèrent au département des travaux publics. M. le baron Dellafaille, ayant été nommé sénateur, donna sa démission de directeur.
La portion de son administration transférée aux travaux publics y forma d'abord deux divisions distinctes. L'une d'elles, l'instruction publique, resta confiée jusqu'au milieu du mois de septembre 1840 au même secrétaire de l'administrateur-général dont, sous le ministère précédent, le titre avait été échangé contre celui de chef de bureau.
Par arrêté royal du 30 août 1840, M. Dequesne, ancien membre de la Chambre des représentants (*), fut appelé au poste de directeur de l'instruction publique, des arts, des sciences et des lettres. Il ne prit possession de ses fonctions que vers le milieu du mois de septembre; il fit à la distribution des prix du concours des athénées et des collèges, le rapport officiel sur cette institution, créée par M. Rogier le 4 juillet précédent et organisée par la division de l'instruction publique pendant l'intérim de M. Alvin. A la retraite du cabinet, M. Dequesne donna sa démission.
En l'appelant l'instruction publique, les arts et les sciences au département de l'intérieur, le cabinet du 13 avril fit de l'instruction publique une administration spéciale qui devint une des six divisions du ministère. L'arrêté royal du 18 mai 1841, qui créa cette division, porte qu'elle pourra être confiée à un fonctionnaire ayant le titre de directeur ou de chef de division. M. Alvin fut nommé le même jour, sous cette dernière dénomination; démissionnaire au bout de neuf ans, la mort du baron de Reiffenberg (v. ce nom), décida le gouvernement a lui confier le poste de conservateur en chef de la Bibliothèque royale, fonctions qu'il occupe encore aujourd'hui.
M. L.-J. ALVIN, membre de l'Académie royale de Belgique, s'est fait connaître par plusieurs écrits estimés, notamment sur des questions d'art. Il a pris une grande part à la reforme de l'enseignement des arts du dessin. On lui doit une tragédie Surdanapole; plusieurs notices littéraires, entr'autres sur la Divine épopée d'Alexandre Soumet, et une série d'intéressantes biographies d'écrivains belges: il compte au nombre de nos meilleurs prosateurs. Le grand recueil que M. Nothomb, ministre de l'intérieur, a publié en 1844 sur l'histoire et la statistique de l'enseignement supérieur en Belgique, est dû en grande partie aux soins de M. L. Alvin.
Depuis 1830, la direction administrative de l'instruction publique est confiée à M. C.-F. THIERY. Né à Ath, le 24 février 1805, M. Thiéry, après avoir fait de brillantes études humanitaires au Collège de cette ville, alla fréquenter l'Université de Louvain d'où il sortit en 1829 avec le grade de docteur en philosophie et lettres, après avoir soutenu une thèse sur Diogéne de Babylone. Becker (v. ce nom) le compta parmi ses élèves les plus distingués. Il passa ensuite quatre années dans l'enseignement: nommé professeur de poésie latine an Collège de Soignies, en octobre 1829, il y obtint la chaire de rhétorique l'année suivante. En 1833, il retourna à Louvain et s'y fit recevoir, au bout de deux ans, docteur en droit. Il est attaché au département de l'intérieur depuis le mois de septembre 1835. De 1849 à 1850, il a rempli les fonctions de chef du service des affaires provinciales et communales. Comme chef de division de l'instruction publique, il s'est vu appelé, à peine entré en fonctions, à organiser l'enseignement moyen, régénéré par la loi du 1 juin 1850; il a aussi rendu de grands services à l'enseignement supérieur. M. Thiéry a obtenu en 1852 le titre de directeur; en 1859, ii a été promu au rang de directeur général de l'instruction publique, mesure devenue nécessaire à raison du développement de plus en plus considérable de nos institutions scolaires. L'administration de M. Thiéry comprend aujourd'hui deux divisions: les affaires de l'enseignement des deux degrés supérieurs relèvent immédiatement de M. RENSING, chef de division (**); celles de l'enseignement primaire sont traitées par M. JAMAR, qui porte le titre de directeur.
(*) M. Dequesne fut renvoyé plus tard à la chambre, par les électeurs de Thuin. En 1850, il redigea, au nom de a section centrale, un rapport sur la toi de l'enseignement moyen; il présida ensuite pendant quelques années le conseil de perfectionnement institué par cette même loi.
(**) Et sténographe de la chambre des représentants.
(104) V. ci-après, col. 177 et 701. - Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que Ed. Lavalleye est décédé à Liège, le 18 septembre 1869.
(105) Le désir de former, entre les anciens élèves des Ecoles, une association « qui contribuat à maintenir les relations d'amitié contractées pendant les études et à développer entre eux une solidarité plus étroite était nourri depuis longtemps dans la pensée d'un grand nombre de jeunes gens. Il trouva finalement sa réalisation en 1847. Une réunion d'amis (*), dont plusieurs n'étaient pas encore ingénieurs et quelques-uns avaient terminé leurs études, crut le moment opportun et convoqua une assemblée pour le 2 janvier 1848. Dès le 12 décembre 1847, vingt-neuf anciens élèves habitant la province de Liège répondirent à cet appel; le jour même, ils adressèrent une circulaire à leurs amis dispersés sur toute la surface du pays, chargèrent une Commission (**) de préparer un projet de règlement et fixèrent au 26 décembre l'assemblée générale. Le succès répondit à leur attente l'Association fut immédiatement constituée dans le but: 1° d'établir entre ses membres des relations régulières et intimes; 2° d'encourager parmi eux les publications et inventions utiles. - Font de droit partie de la société tous les élèves diplômés des Ecoles de Liège, et tous les membres du corps des mines qui y ont étudié depuis 1835; les membres de l'Association qui ne résident pas en Belgique portent le titre de correspondants. Le siege social est à Liège. Il y a, dans chaque centre industriel, une section scientifique, chargée de s'occuper des questions théoriques ou industrielles qui lui sont soumises par un ou plusieurs associés. Dans l'assemblée générale annuelle, le trésorier rend ses comptes et il est donné lecture des pièces communiquées à l'Association et présentées par le Conseil. La cotisation annuelle est de 10 frs.; le produit en est affecté aux frais de bureau et de correspondance, et à l'impression des documents administratifs ou scientifiques dont l'assemblée juge la publication utile. La séance générale annuelle est suivie d'un banquet: pas n'est besoin de se demander si cette agape fraternelle est animée et joyeuse. L'Association a publié, de 1851 à 1868, dix Annuaires in-8°; depuis 1861, elle édite un Bulletin trimestriel (***) recueil des plus importants au double point de vue des questions qui y sont traitées et des renseignements intéressant les associés. Le t. IX est en cours de publication. - Depuis 1860, des concours ont été ouverts et ont donné de brillants résultats. Ont été couronnés les Mémoires suivants:
1° En 1861 Jos. Franquoy, Fabrication des combustibles agglomérés dans le district de Charleroi (Ann. des trav. publics et Annuaire de l'Assoc., t. V); 2° En 1862: M. Cahen, Métallurgie du plomb Revue univ., t. XIII; Ann. t. VI); 3° En 1863 J. Fayn, Mém. sur la vie et les travaux d'André Dumont (R. unir., t. XV et XVI; Ann., t. VI); 4° En 1864: P. Marlin, Examen comparatif de la fabrication des produits chimiques en Belgique et en Angleterre (R. univ., t. XVII; Ann., t. VII; 5° et 6° En 1866 a. E. Harzé, De l'aérage des travaux préparatoires dans les mines à grisou (R. univ., t. XX; Ann., t. VII); 7° E. Urbin, Guide pratique pour le puddlage du fer et de l'acier (Ibid., ibid.); 7° et 8° En 1867 a. Spineux, Sur les distributions de la vapeur (sous presse chez J. Baudry, éditeur); b. Léon Jacques, Sur le gisement des houilles grasses du bassin de Liège (R. unie., t. XXII; Ann., t. IX); 9° En 1868: F. Franquoy, Sur le gisement des minerais de fer de la province de Liège (R. univ., t. XXV et XVI; Ann., t. X). - L'Association se composait, en 1868, de 119 membres (L'Annuaire mentionne en outre, à cette époque, deux membres décédés); au commencement de 1869, ce nombre s'élevait à 454. - Le Conseil d'administration était composé comme suit en 1851: Présidents honoraires, MM. Ad. De Vaux et D. Arnould; membres honoraires, MM. Lesoinne, André Dumont et Chandelon; membres effectifs: MM. Trasenster, président; Gilon, vice-président; Dupont, secrétaire; Letoret, L. Renard, L. Goret, G. Dumont, administrateurs; Stouts, trésorier. Le Conseil de discipline était formé de MM. Letoret, Trasenster, Gendebien, Gilon et Smits. - En 1869, les membres honoraires sont MM. Chandelon, de Cuyper, de Koninck, Gernaert, Rucloux et Jochams; les membres effectifs du Conseil d'administration sont: MM. Trasenster, président; Ch. Lambert, vice-président; R. Malherbe, trésorier; P. Paquet, L. Taskin, Jules Ziane, Ed. Despret, J. Letoret, Ad. Urban et Halbrecq, administrateurs; Oscar Rongé, secrétaire et directeur du Bulletin. Le Conseil de discipline se compose de MM. G. Dumont, Trasenster, Letoret, Jos. Descamps et Ad. de Vaux. - Les Comités scientifiques sont an nombre de quatre, à Liege, à Charleroi, à Mons et à Bruxelles. Ils ont pour présidents respectifs, MM. R. Paquot, Ch. Lambert, H de Simony et Hancart-Ortmans.
(106) V. ci-après, dernière partie, p. xx et suiv. - En somme, la décentralisation du concours constituerait déjà par elle-même un grand progrès.
(107) Expression du P. GRATRY.
(108) V. dernière partie, p. xxix.
(109) La Société medico-chirurgicale de Liège,
(110) V. ci après. col. 1047 et 1121.
(111) Sans compter que les pays étrangers où l'industrie a pris du développement commencent à être pourvus de bons ingénieurs sortis de nos Écoles.
(112) Les renseignements bibliographiques ont été très-difficiles à recueillir pour certaines notices. Nous nous empressons de rappeler à l'attention de qui de droit un voeu exprimé par M. UI. Capitaine dans son Nécrologe liégeois, art. Fuss (1860) « La bibliothèque de l'Université de Liège, fait remarquer ce publiciste, ne possède qu'une faible partie des travaux de Fuss; cette observation s'applique aux oeuvres de plusieurs membres du corps enseignant, notamment à ceux qui ont professé sous le gouvernement des Pays-Bas, et dans les premières années de notre réorganisation politique. Ne pourrait-on former, dans ce vaste dépôt, une collection académique spéciale, dans laquelle on réunirait indistinctement toutes les productions littéraires ou scientifiques émanées de l'Université et de l'Ecole des mines? Chacun, nous n'en doutons pas, s'empresserait d'enrichir cette collection, qui résumerait l'histoire intellectuelle d'un établissement qui fait honneur à la Belgique. »
|
|



